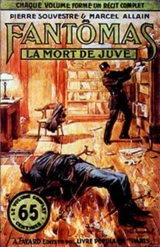
Текст книги "La mort de Juve (Смерть Жюва)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
– Non, j’ai mieux que lui.
Pastel, dont l’inconnu venait de parler était un bonhomme au caractère bizarre qui, depuis son arrivée à Cherbourg, faisait le désespoir d’Hervé Martel.
Pastel était en effet un des gros entrepreneurs français spécialisés dans les opérations de renflouement, de sauvetage des bateaux naufragés. Ancien matelot qui, chose curieuse, avait renoncé à son métier parce qu’il n’avait jamais pu dominer les terribles souffrances du mal de mer, il était devenu un excellent scaphandrier d’abord, un intrépide sauveteur ensuite. Là où d’autres avaient échoué, il avait réussi brillamment. Sa renommée petit à petit avait grandi et de la sorte, devenu universellement réputé dans les milieux maritimes, il avait pu, grâce à un labeur acharné secondé par une folle témérité, monter une véritable entreprise de sauvetage, utilisant de nombreux employés, disposant d’un matériel perfectionné, de pontons submersibles, de grues puissantes, de chaînes, de dragues, de tous les outils enfin qui peuvent concourir à la remise à flot d’un navire englouti. C’était à Pastel que le courtier maritime avait tout de suite songé lorsqu’il avait appris que le Triumphavait sombré.
« La rade du port de guerre n’est pas si profonde, avait estimé Hervé Martel pour qu’il soit impossible, vraisemblablement de renflouer le cargo boat. De plus si le renflouement du Triumphen lui-même est une opération trop difficile, c’est bien le diable si Pastel ne parvient pas à extraire de la cale les caisses d’or qui seules m’intéressent, et qu’il faut que je sauve, coûte que coûte, ou c’est la ruine. » Ce n’était évidemment pas mal raisonné et cependant Hervé Martel, escomptant le secours de Pastel, avait été au-devant d’une terrible désillusion. Non seulement Pastel avait haussé les épaules quand on lui avait parlé de renflouer le Triumph, mais encore il avait nettement déclaré que toute tentative de sauvetage des caisses d’or était vouée d’avance à l’insuccès.
– C’est pas de veine, avait affirmé Pastel, demeurant inébranlable devant les objurgations du courtier, mais c’est indiscutable. Là où le Triumpha coulé il y a un trou de près de quarante ou cinquante brasses et de plus, je m’en suis assuré moi-même par des sondages, le malheureux bateau est sur le flanc, dans un équilibre si précaire qu’il n’y a pas moyen d’y envoyer des scaphandres. Ce serait exposer la vie des hommes et cela pour rien, je vous le répète.
Hervé Martel, épouvanté à l’idée qu’on ne pouvait même rien tenter pour arracher aux flots les fameuses caisses d’or, avait insisté tant qu’il avait pu, Pastel était demeuré inébranlable.
– Rien à faire, s’était-il contenté de répéter.
Et force avait bien été le matin même, à Hervé Martel d’abandonner tout espoir de le faire revenir sur ses décisions.
– Vous voyez, cher monsieur, conclut le courtier qui venait de raconter les refus du sauveteur à l’infortuné manchot, vous voyez que j’avais raison de vous le dire, Pastel est un imbécile. Sa réputation de sauveteur est usurpée. J’aurais donné pour l’opération que je lui proposais une grosse somme. Il la perd bêtement.
Le manchot, cependant, n’était pas de cet avis :
– Hé, répondait-il en riant, vous en parlez à votre aise et, pardonnez-moi de vous le rappeler, comme un homme qui a ses deux bras, si vous aviez été comme moi victime d’un accident, vous comprendriez peut-être mieux qu’il y a des entreprises téméraires qu’il est préférable de ne pas tenter, surtout lorsqu’elles sont impossibles.
– Vous parlez un peu au hasard, cher monsieur, puisque vous ignorez autant que moi les difficultés réelles de l’entreprise et nous tomberons certainement d’accord lorsque vous apprendrez qu’un Norvégien m’a fait des propositions que je me suis empressé d’accepter. Où Pastel a échoué, sans même avoir rien tenté, quelque idée me dit que mon Norvégien va réussir. D’ailleurs, continuait-il, quand on songe aux merveilles que réussit la science moderne, il semble bien inadmissible qu’on ne puisse pas, avec le temps, réussir à retirer une fortune sous trente mètres d’eau.
Le manchot répondit simplement :
– Croyez bien que je vous souhaite d’avoir raison. Mais j’ai grande confiance en Pastel.
Le manchot allait continuer lorsqu’un homme à casquette galonnée approcha :
– Monsieur a-t-il besoin de mes services ? Monsieur veut-il que je lui passe son pardessus ?
C’était évidemment le domestique mis aux ordres de l’infirme. Hervé Martel se tourna vers son compagnon :
– Vous connaissez la ville, monsieur ?
– Assez bien. Oui. Pourquoi ?
– Moi-même, je connais très mal Cherbourg, si vous n’avez rien de mieux à faire, voulez-vous que nous fassions un tour ensemble ?
– Très volontiers. Vous êtes infiniment aimable de m’offrir votre compagnie, j’ai l’habitude de ne solliciter la compassion de personne, mais croyez que je suis sensible à la sympathie. Voulez-vous me permettre de renvoyer mon domestique ? Je serais heureux de donner une heure de liberté à ce pauvre homme qui m’aide à vivre.
– Je passe au fumoir prendre mon chapeau, dit Martel.
– Je vous suis. Pour moi, je reste toujours coiffé. Il est trop compliqué d’avoir à demander l’aide d’un serviteur.
Hervé Martel, précédant l’infirme, ouvrit la porte. La fenêtre était ouverte et un courant d’air fit voltiger les papiers.
– Entrez, proposa Hervé Martel à son compagnon. Sans cela nous allons briser les carreaux.
Le manchot pénétra dans la pièce, Hervé Martel referma la porte, cependant que la caissière de l’hôtel qui avait elle-même senti le courant d’air traversait la salle à manger pour aller fermer les fenêtres. Or, la caissière n’était pas encore au milieu de la salle, qu’elle s’arrêtait net dans sa course, cependant que les maîtres d’hôtel, déjà occupés à desservir, s’arrêtaient eux aussi, cloués sur place.
Une terrible clameur venait de s’élever :
– À l’assassin.
Bruit d’un corps qui tombe. Nouveaux appels. Violents coups de pieds contre la porte du fumoir.
– Ouvrez. Ouvrez. Au secours ! On l’assassine !
Brouhaha épouvantable.
Cris, clameurs, coups de pieds qui résonnent dans les salles attirent domestiques et clients. La caissière hurle. Les garçons attendent, bouche bée.
Le portier du palace, important personnage vêtu d’une redingote bien chamarrée de galons d’or larges de cinq centimètres, retrouva le premier sa présence d’esprit. C’était le Saxon, il bégaya avec un fort accent :
– Chûr et chertain qu’il se passe un grime là-tetans. Je vais aller foir.
Et très brave, le grave portier courut à la porte du fumoir, ouvrit, cependant que d’un même mouvement chacun des assistants se précipitait vers le seuil de la pièce.
La porte ouverte, il suffisait d’un coup d’œil pour examiner en entier la petite pièce tendue de bleu clair, d’ordinaire si paisible. Deux hommes. L’un était l’infirme, le manchot, les yeux dilatés d’horreur, tapait à grands coups de pied contre la porte pour prier que l’on ouvrît, l’autre était Hervé Martel, couché de tout son long sur le sol et dont la poitrine, trouée d’un coup de poignard, laissait échapper des flots de sang qui dessinaient une grande flaque rouge déjà.
Le manchot, défaillant, sortit en courant. Un médecin parut, se pencha sur le courtier maritime pour se relever aussitôt en déclarant :
– Trop tard, cet homme est mort.
Des gens se bousculaient autour de l’infirme qui, tombé dans un fauteuil semblait prêt à s’évanouir…
Dans le couloir on interrogeait le manchot qui répondait sans suite :
– Je ne sais pas. Un homme caché dans la pièce. Il avait un poignard à la main. Ah, c’est horrible. Le malheureux était devant moi. En plein cœur. Il a sauté par la fenêtre. Il faut courir. Il faut prévenir la police. Mon Dieu, mon Dieu, quel malheur !
***
– Vous ne voulez pas me croire ? Vous êtes persuadé qu’Hervé Martel, c’est mon père ? Venez voir mon patron, vous pourrez vous convaincre que vous êtes dans l’erreur. Suivez-moi.
Lentement, Hélène et Fandor regagnèrent le Palace-Hôtel. Mais quand ils atteignirent celui-ci, un véritable tohu-bohu s’y manifestait.
– Seigneur, dit Fandor, qu’est-ce qu’ils font donc dans ce caravansérail-là ?
L’émotion des passants qui les croisaient, ayant l’air de se précipiter vers le centre de la ville, était si visible que le journaliste ajouta :
– Il y aurait le feu à la maison que ces gens-là n’auraient pas d’autres figures.
Fandor et Hélène n’avaient pas fait trois pas dans le vestibule qu’ils furent au courant :
– C’était un courtier maritime, avait expliqué quelqu’un, sur les registres de l’hôtel, il était inscrit sous le nom d’Hervé Martel.
Fandor, en entendant ces mots, arrêta Hélène :
– Ne venez pas.
La jeune fille fit non de la tête :
– Je vous en supplie, retournez dans les jardins, vite, vite, dépêchez-vous, c’est providentiel que nous arrivions à ce moment et il n’y a vraiment aucune utilité à ce que vous voyiez ce que je vais voir. Allez m’attendre sur la jetée, allez où vous voudrez, n’entrez pas, je ne sais pas ce qui s’est passé, mais je le devine. Ce n’est pas un spectacle pour vous.
Fandor, resté seul, se précipita dans la salle à manger d’où venaient les éclats de voix.
Fandor, à cet instant, ne doutait pas qu’Hervé Martel fût réellement Fantômas. À coup sûr, c’était Fantômas qui venait de se livrer à l’un des terribles exploits et si l’on avait annoncé sa mort, c’est que peut-être il avait trouvé son maître.
D’autorité, le journaliste bouscula un groupe de personnes qui stationnaient à la porte de la salle à manger mais qui s’écartèrent, le voyant si assuré.
– La victime ? demanda-t-il. Où est la victime ?
On devait le prendre pour quelqu’un de la police, car on le conduisit dans le petit fumoir où le corps était encore étendu.
– Voici ce malheureux Martel.
Fandor ne répondit rien. Hervé Martel, si ce mort était bien Hervé Martel, n’était pas Fantômas. Le maître d’hôtel qui le guidait ajoutait :
– Si maintenant monsieur veut interroger le témoin, le principal témoin, le manchot, il attend dans la salle à manger.
– Je vous suis.
La salle à manger était vide.
– Qui était-ce, ce monsieur ?
On le lui dit.
***
– Bizarre, pensait le jeune homme, cette mort d’Hervé Martel, la mort de ce monsieur chez qui il s’est passé déjà tant d’affaires extraordinaires et qui semble avoir été visé par les mystérieux bandits. Bizarre en vérité cette mort à la suite d’un coup de poignard donné avec une extrême vigueur… par qui ? Par un manchot, absent d’ailleurs ? Non. Pas possible.
Fandor qui avait tiré son calepin et hâtivement tracé le plan sommaire du fumoir où le courtier avait trouvé la mort, incarnait de mieux en mieux son personnage de la police. Il quitta la salle à manger, regagna le fumoir.
– Évidemment, avait repris le jeune homme, contemplant la fenêtre donnant sur les jardins, évidemment, il est très facile à quiconque le désire de pénétrer dans cette pièce, mais, tiens, tiens…
Fandor avait brusquement interrompu ses réflexions. La fenêtre qu’il considérait était en effet à si peu de hauteur du sol, un mètre peut-être, qu’il était facile de l’escalader. Elle donnait sur une très large corbeille de terreau, ratissée avec un soin extrême.
– Si quelqu’un est monté par cette fenêtre, se disait Fandor, si quelqu’un en est descendu, étant donnée la largeur de la corbeille, on doit retrouver son empreinte.
Et Fandor tirait de sa poche l’inséparable petite lampe électrique qui au cours de sa vie aventureuse lui avait déjà rendu tant de services.
Rien.
– C’est déconcertant, murmura le journaliste, ou c’est tout ce qu’il y a de plus simple.
Après avoir donné un nouveau regard au corps du malheureux courtier que nul n’osait relever sans ordre, Fandor revint dans la salle à manger et avisa la caissière :
– Deux mots, madame ? Vous avez vu, si mes renseignements sont exacts, la malheureuse victime entrer dans le fumoir en compagnie du manchot ?
– Oui, monsieur.
– Combien de temps s’est-il passé à peu près avant que vous ayez entendu la chute du corps de la victime ?
– À peine une seconde, monsieur. Le temps de traverser la salle à manger, et encore pas complètement.
– Madame, encore un renseignement ? Le monsieur infirme qui accompagnait la victime lorsqu’elle est entrée dans la pièce tragique, ce monsieur infirme, êtes-vous certaine qu’il était bien infirme, toujours infirme, encore infirme lorsqu’il a quitté la pièce ?
– Mais oui, monsieur, mais oui, bien entendu. Que voulez-vous dire ?
Fandor grommelait quelque chose, puis enfin se décidait à répondre :
– Je veux dire, madame, qu’on ne relève pas de traces sous la fenêtre. Donc, il est certain que personne n’est entré dans le petit fumoir et que personne n’en est sorti par là. D’autre part, étant donné qu’Hervé Martel a été tué d’un coup de poignard, il est bien évident que l’on ne peut pas attribuer le meurtre au manchot qui l’accompagnait. Un manchot ne donne pas de coups de poignard. Enfin, étant donné qu’il a fallu deux secondes à peine pour que le crime ait lieu, pour que l’on vienne au secours de la victime, il est bien difficile d’admettre que le manchot ait été un faux manchot. Il n’aurait pas eu le temps matériel de dissimuler ses bras, son crime une fois commis. Et pourtant, crédibisèque, comme Hervé Martel ne s’est pas tué tout seul, comme il n’avait personne avec lui que le manchot, la logique conduit bien à considérer que c’est le manchot qui est l’assassin.
La caissière produisit des bruits indistincts.
– Comment était-il ce manchot ? grand ? petit ? brun ? blond ?
– C’était un bel homme, répondit la caissière. Quant à ses cheveux, il m’est impossible de vous dire leur couleur car il gardait son chapeau haut-de-forme sur la tête.
– Mais où peut-il bien avoir passé, ce monsieur, je voudrais bien le voir.
Une demi-heure plus tard, Fandor quittait l’hôtel sans avoir vu l’extraordinaire manchot. L’infirme avait disparu, il n’était nulle part, personne ne l’avait vu sortir dans le brouhaha des premières minutes d’affolement.
– J’en donnerais ma tête à couper, disait Fandor, c’était Fantômas. Bon travail. Comment diable s’y est-il donc pris ?
13 – IRMA DE STEINKERQUE
À première heure, Nalorgne avait été convoqué à la Sûreté générale par M. Havard.
Enfin, le directeur de la Sûreté leva les yeux :
– Monsieur, dit-il, nous avons une mission à vous confier. Pour vos débuts dans la police active vous allez être chargé d’une opération assez délicate qui nécessite du flair et de l’intelligence. Toutefois si vous réussissez je vous en saurai gré et, suivant la façon dont vous procéderez, vous obtiendrez dans le personnel des inspecteurs une situation tout à fait avantageuse.
– Je vous suis reconnaissant, monsieur le directeur, de la confiance que vous m’accordez, j’espère m’en rendre digne, répondit Nalorgne.
– Depuis quelque temps, expliquait déjà M. Havard, nous avons reçu pas mal de plaintes émanant de maisons de commerce de la place de Paris. Un individu, un voleur, se présente aux caisses de ces maisons, le jour d’échéance, porteur de quittances fort bien imitées. Pour ne déterminer aucun soupçon il a l’audace de revêtir l’uniforme d’un garçon de recettes. Il s’est procuré, on ne sait pas comment, le détail exact de certaines grosses sommes régulièrement dues par ces maisons, il présente une quittance ayant toutes les apparences de l’authenticité, on effectue entre ses mains le versement de la somme, puis, quelque temps après, arrive le véritable encaisseur et l’on s’aperçoit que l’on a été victime d’une escroquerie.
Le cœur de Nalorgne s’emplit d’une joie secrète, celle du policier qui connaît l’affaire. M. Havard poursuivit :
– J’avais chargé l’inspecteur Léon de m’arrêter ce voleur, mais vous n’ignorez pas, monsieur Nalorgne, l’épouvantable accident dont il vient d’être victime. Notre infortuné collaborateur en a pour plusieurs mois avant de se remettre et il restera infirme toute sa vie. J’ai donc décidé de vous confier la suite des affaires qu’il avait entreprises. Mon secrétaire, tout à l’heure, vous remettra un dossier concernant ces vols et voici un mandat d’amener que je vous délivre avec le nom en blanc. Nous ne sommes pas, en effet, très fixés sur la personnalité du coupable. Toutefois, je vous signale, à titre d’indication, que les soupçons de Léon s’étaient portés sur un individu assez connu en ce moment dans le monde de la galanterie pour y dépenser pas mal d’argent et que l’on croit avoir été domestique autrefois dans des maisons bourgeoises. Ce serait peut-être un certain cocher du nom de Prosper dont la dernière place aurait été celle qu’il occupait chez un courtier maritime, précisément chez M. Hervé Martel, vous êtes au courant, n’est-ce pas ? Vous saisissez, n’est-ce pas, le rapprochement ? Vous vous rendez compte de la délicatesse qu’il faut employer dans cette affaire ? Si vous n’êtes pas absolument édifié sur la culpabilité de l’individu, sans le perdre de vue, évitez de l’arrêter tout de suite, pour ne pas l’effaroucher. Pour ma part, je ne vous cache pas que j’ai la conviction intime que cet individu, ce Prosper est non seulement l’auteur des vols dont se sont plaintes certaines maisons de commerce, mais que c’est encore lui qui a organisé l’extraordinaire guet-apens dont ont été victimes d’abord M. Hervé Martel, ensuite votre infortuné collègue, Léon. Ceci prouverait donc que nous avons à faire à forte partie.
Il faut bien vous convaincre de la culpabilité, si elle existe, du nommé Prosper, et ensuite établir s’il est l’auteur des vols et des crimes que nous recherchons.
Nalorgne baissa la tête. Il était si absorbé dans ses réflexions que M. Havard s’en aperçut :
– Eh bien, fit celui-ci, à quoi pensez-vous ?
Nalorgne se ressaisit :
– Je réfléchis, monsieur le directeur.
– Eh bien, allez réfléchir ailleurs, car j’ai du travail.
– Bien, monsieur le directeur.
***
– Sale affaire, grommelait, en quittant la Sûreté, l’inspecteur Nalorgne qui sauta dans un fiacre pour se faire conduire à son bureau de la rue Saint-Marc.
Il avait encore quelques affaires à régler avant de quitter définitivement, ainsi que Pérouzin, le local qu’ils avaient loué et dans lequel ils s’étaient livrés à diverses opérations plus invraisemblables les unes que les autres, jusqu’au jour où les deux associés avaient enfin obtenu ce qu’ils appelaient une « position sociale stable ».
– Sale affaire, grognait encore Nalorgne en montant l’escalier.
Lorsqu’il pénétra dans son cabinet, Pérouzin était au téléphone.
– Quelle gaffe est-il encore en train de commettre ? se demanda Nalorgne.
Pérouzin raccrocha le récepteur, puis, se tournant vers son associé :
– Eh bien, déclara-t-il, en voilà une affaire, nous n’avons véritablement pas de chance lorsque nous entreprenons quelque chose et que nous ne sommes pas guidés par Fantômas.
– De quoi s’agit-il ?
– Voilà, je viens de téléphoner à Cherbourg, à M lle Hélène, pour insister auprès d’elle afin de conclure rapidement cette fameuse affaire de mariage. Vous comprenez bien, Nalorgne, que si nous pouvons traiter cela avant de quitter notre bureau il y aura une belle commission à toucher et je ne sais pas si vous êtes riche en ce moment, mais moi, j’ai joliment besoin d’argent.
– C’est absurde de continuer à s’occuper de cette affaire-là, elle ne réussira pas.
– Tiens, vous savez donc ?
– Je n’en sais rien, mais j’en suis sûr.
– Hélas, vous avez raison. Tout d’abord la jeune fille ne voulait pas venir à l’appareil, j’ai tellement insisté qu’elle a fini par s’y décider. Eh bien, comme vous le supposiez elle m’a envoyé promener, m’a déclaré que le moment n’était pas venu, mais là, pas du tout, de s’occuper de cette chose.
– Qu’est-ce que je vous disais ?
– Seulement, reprit Pérouzin, elle m’a appris du nouveau. Figurez-vous qu’Hervé Martel a été assassiné hier soir.
– Assassiné, par qui ?
– On n’en sait rien.
– Mon Dieu, songea l’ancien prêtre, pourvu que nous ne soyons pas encore chargés de cette affaire.
Cependant Nalorgne avait tiré de sa poche le mandat d’amener que lui avait remis M. Havard :
– Savez-vous, demanda-t-il, quel nom je dois mettre là ?
– Non, le mien ?
– Celui de Prosper.
– Sous quelle inculpation ?
– Les vols des maisons de commerce, et peut-être l’affaire de l’avenue Niel.
– Si vous arrêtez Prosper, il mangera le morceau.
– Que faire ? dit Nalorgne.
– Que faire ? répéta Pérouzin.
***
Une heure après cet échange de vues, Nalorgne et Pérouzin arrivaient rue Saint-Ferdinand et montaient à l’appartement loué au nom d’Irma de Steinkerque et dans lequel l’ancien cocher Prosper avait élu domicile, passant le plus clair de son temps avec sa nouvelle maîtresse.
Il était onze heures du matin lorsqu’ils sonnèrent. Une vieille femme de ménage qui venait leur ouvrir demeurait interdite à la vue de ces deux personnages, gravement boutonnés dans leur redingote et coiffés de chapeaux hauts-de-forme surannés.
– Des huissiers, dit-elle, et elle allait leur claquer la porte au nez.
Mais Nalorgne l’en empêcha :
– N’ayez aucune crainte, ma bonne dame, lui dit-il, nous sommes des amis de Madame et de Monsieur, nous voudrions bien les voir. Annoncez-nous.
Ils furent introduits au salon et, un instant plus tard, la femme de ménage revenait.
– Madame va venir. Monsieur est absent.
– Bonne affaire, dit Nalorgne, si Prosper n’est pas là nous gagnons du temps.
Irma de Steinkerque apparut enveloppée d’un grand peignoir rose, le visage couvert de poudre de riz.
– Excusez mon négligé, mes chers amis, déclara-t-elle, en saluant d’un bienveillant sourire Nalorgne et Pérouzin qui s’étaient levés, comme mus par un ressort à l’entrée de la majestueuse personne.
Celle-ci, après avoir reçu les hommages qui lui étaient dus en sa qualité de jolie femme, sonna la bonne :
– Apportez donc l’apéro, ordonna-t-elle, c’est le meilleur moyen de causer.
Puis, se tournant vers Nalorgne et Pérouzin, elle minauda :
– Vous prendrez bien un petit vermouth, n’est-ce pas ?
Irma de Steinkerque ajoutait :
– C’en est du bon. Prosper me l’a fait acheter et il s’y connaît. Au fait, c’est lui que vous veniez voir, sans doute ?
– Oui, mais vous aussi…
– Écoutez, fit-elle, ce n’est pas pour vous renvoyer, bien au contraire, vous me feriez même grand plaisir en acceptant de déjeuner avec moi, mais je dois vous dire que je serai toute seule, car Prosper est absent, absent de Paris.
– Ah, s’écrièrent ensemble Nalorgne et Pérouzin, qui se regardèrent alarmés.
Une même pensée, en effet, leur venait à l’esprit : du moment que Prosper était absent, cela corsait singulièrement les soupçons que les deux amis pouvaient avoir à son sujet, relativement à l’assassinat de M. Hervé Martel.
Diable, l’affaire devenait de plus en plus grave et Nalorgne, d’un signe imperceptible, fit comprendre à Pérouzin que celui-ci désormais devait se taire, éviter de prononcer la moindre parole compromettante.
Irma de Steinkerque, cependant, se faisait de plus en plus aimable. Et après avoir offert l’apéritif à ses hôtes, elle insista tellement que ceux-ci, qui n’étaient jamais hostiles aux économies, acceptèrent de déjeuner en sa compagnie.
– D’ailleurs, leur avait déclaré la jolie femme, avec une nuance de tristesse, croyez que votre présence me fera bien plaisir, car je vous avoue que je m’ennuie toute seule et je le suis souvent. Prosper est un drôle de type, c’est un gentil garçon, sans doute, mais enfin, il a des manières si bizarres.
Lorsque le déjeuner, un peu avancé, eut délié les langues et mis de la cordialité dans l’air, Irma reparla de son amant :
– Mais au fait, déclara-t-elle soudain, puisque vous êtes venus le chercher ce matin, c’est que vous aviez sans doute quelque chose à lui dire. Je ne sais pas exactement où il est, mais cependant, si vous y teniez, on pourrait savoir.
– Non, ne nous dites rien.
– Pourquoi ? demanda Irma.
– Parce que, dit Pérouzin, nous avons tout intérêt à ne pas nous rencontrer.
– Eh bien, vous êtes de drôles de types, vous. Vous venez, censément, pour voir un ami, vous avez l’air enchantés de ne pas le rencontrer, vous ne voulez pas savoir où il se trouve.
– Ça, dit alors Nalorgne, ce sont des mystères qu’il ne vous appartient pas d’approfondir. Je vous demande même une chose, c’est de garder le secret sur notre visite.
Steinkerque était de plus en plus intriguée. Nalorgne se rendait compte que pour ne pas éveiller les soupçons de son esprit, il fallait à toute force trouver un motif à leur venue. Mais ce motif ne se précisait pas nettement à son esprit. Et cette fois, ce fut Pérouzin qui sauva la situation :
– Vous nous disiez tout à l’heure, chère madame, combien l’existence perpétuellement seule vous était désagréable ?
– Oh, ce n’est pas tant d’être seule qui m’ennuie, c’est surtout de changer. Vous comprenez bien dans mon métier l’existence n’est pas toujours drôle. On fait sa vie avec un homme, on s’y habitue pendant huit jours, puis tout est à recommencer avec un autre. Moi qui suis au fond une femme tranquille, une femme d’habitudes, il me faudrait une affection durable.
– Je vois ce que c’est, il vous faudrait un mari ?
– Ça serait le rêve, naturellement, mais ça ne se trouve pas comme ça sur un bord de trottoir, les maris.
– Qui sait, on pourrait peut-être vous trouver ça.
Tant et si bien que les deux associés en vinrent à lui parler du vieux M. Ronier.
– Un petit vieux bien propre, voilà ce qu’il me faut, vous avez tout à fait raison, s’écria Irma enthousiasmée.
Et Pérouzin qui ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, donnait à la demi-mondaine tous les renseignements possibles et imaginables sur le futur mari qu’il lui destinait. Mais, se disait Nalorgne, pendant ce temps, était-ce bien prudent de mettre en rapport Juve et la cocotte ? D’ailleurs, tant pis, le vin était tiré et Irma leur déclarait :
– Je vous jure bien que si cela réussit, je vous ferai un royal cadeau. Dix mille francs, au moins.
Pour remercier ses amis, elle voulait de toute force leur communiquer l’adresse de Prosper, et elle cherchait fébrilement dans un paquet de lettres, une enveloppe dont le timbre de la poste lui aurait indiqué la région tout au moins où il se trouvait.
Les deux autres ne voulaient rien entendre :
– Non, non, nous n’avons pas besoin de savoir où est Prosper, nous ne le voulons même pas.
***
Le lendemain, Jean vint dire à Juve :
– Patron, c’est une dame qui désire vous voir, elle prétend, comme ça, qu’elle est envoyée par l’agence Nalorgne et Pérouzin. Ce serait pour une affaire confidentielle.
– Parbleu, Jean, je sais qui c’est : une charmante jeune fille que m’envoient mes amis au sujet d’un mariage, car je ne t’ai pas encore annoncé, Jean, que je vais me marier. Comment la trouves-tu ?
– Qui, patron ?
– Eh bien, la charmante jeune fille qui demande à me voir ?
– Charmante, enfin, et jeune fille, c’est à savoir. Pour moi, j’aime autant vous dire, cette personne qui vous demande, avec les panaches qu’elle a sur la tête et le plâtre de toutes les couleurs qu’elle se colle sur la figure, je crois plutôt que c’est une vieille grue.
– Ah ? fais-la donc monter.
– Dans votre chambre ?
– Dans ma chambre. Tu ne voudrais tout de même pas que je descende la recevoir au salon ?
Quelques instants plus tard, le vieux domestique introduisait dans l’appartement de Juve une personne élégamment vêtue, à la silhouette un peu trop majestueuse sans doute.
– C’est bien à M. Ronier à qui j’ai l’honneur de parler ? demanda-t-elle.
– En personne.
D’un coup d’œil, le policier avait donné raison à Jean : la personne n’avait rien de la « charmante jeune fille » qui était en réalité la fille du Roi de l’Épouvante. Juve, certes, ne s’était pas attendu à voir paraître celle-ci, qu’il savait à Cherbourg, mais comment et pourquoi s’en présentait-il une autre ? Décidément, ces Nalorgne et Pérouzin étaient de véritables agents d’affaires de comédie. Allaient-ils faire défiler ainsi chez Juve toutes les célibataires de Paris ?
La visiteuse, toutefois, se présentait avec son plus aimable sourire :
– J’ai appris, monsieur, déclarait-elle, que vous vivez seul et retiré et que bien souvent l’existence vous paraît pénible. Je m’intéresse, par pure sympathie d’ailleurs, aux personnes souffrantes, isolées, malades et c’est pourquoi je me suis permis, sur la recommandation de mes amis, Nalorgne et Pérouzin, de venir vous rendre une petite visite.
La visiteuse tendait à Juve une lettre, que celui-ci, vu la faiblesse de ses mains, ne parvint pas à décacheter.
– Voulez-vous me permettre ?
– Volontiers. Si j’osais vous prier, madame, de me lire ce que m’écrivent nos amis, j’ai si mauvaise vue.
Elle s’assit et lut à haute voix :
Cher monsieur Ronier, La personne qui vous apportera cette lettre se recommande à toute votre sympathie. Comme vous vous en apercevez facilement elle est jeune et belle et son caractère a la qualité de ses traits charmeurs.
Vous qui rêvez d’une paisible existence conjugale, vous trouverez auprès d’elle tous les avantages de la vie bourgeoise. Nous vous la recommandons en toute connaissance de cause, c’est une amie de nos familles, nous la connaissons depuis son enfance…
Juve faillit rire à ce passage, mais Irma, elle, ne put se contenir :
– Ah les vaches, s’écria-t-elle, toujours des vannes.
Puis, se rendant compte de l’impair qu’elle commettait, elle rougit.
– Pardonnez-moi, monsieur, dit-elle, mais ça m’a échappé.
Juve, d’un ton affectueux, mit la demi-mondaine à son aise :
– Mais je vous assure que ça ne me choque pas du tout. La qualité que j’apprécie le plus chez une femme, c’est le naturel. Mais au fait, pourquoi vous êtes-vous interrompue ?
– Ah c’est que, Nalorgne et Pérouzin ont mis sur moi des choses que j’aurais peut-être mieux aimé… qu’il aurait mieux valu…
– Mais non, mais non, poursuivit Juve, je suis sûr qu’elles n’ont aucune importance, vous comprenez bien qu’un homme de mon âge n’est pas comme un collégien, que je puis entendre, que je dois savoir.
– Ma foi, pensa la demi-mondaine, il n’a pas l’air mauvais, cet homme-là, et après tout, qu’est-ce que je risque ?
Bravement, elle continua la lecture de la lettre :
… Pour tout vous dire, monsieur Ronier, la personne que nous vous recommandons n’est pas précisément ce que l’on appelle « une vertu farouche », elle passait pour assez farceuse dans sa jeunesse, mais avec l’âge qui vient, elle s’est tait une raison et veut désormais vivre autrement. C’est d’ailleurs une personne qui fait honneur, car non seulement, elle présente bien, mais encore elle est connue dans le monde parisien. Inutile de vous dissimuler plus longtemps son nom : Irma de Steinkerque…







