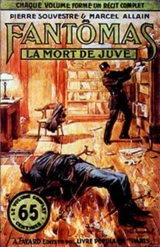
Текст книги "La mort de Juve (Смерть Жюва)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
– Ma foi, oui, j’ai été notaire dans cette région. Le pays est pittoresque, les habitants cossus, un peu avares…
– Suffit. Les affaires sérieuses : à cinq cents mètres avant la gare de Sottevast, il est une aiguille que les trains venant de Cherbourg prennent en pointe. On peut, à cette bifurcation, diriger un train qui, normalement, suit la grande ligne sur une voie de garage qui passe derrière la gare des marchandises de Sottevast. Voyez-vous ça d’ici ?
– Mais oui, s’écria Pérouzin, et je comprends bien ce qu’il va falloir faire. Lorsque le train arrivera, au lieu de le laisser filer droit son chemin, il faudra le lancer sur cette voie de garage.
– Imbécile. C’est la plus sûre façon pour faire un accident formidable et attirer, dans l’espace d’une seconde, autour du wagon chargé d’or, tout ce que la région compte d’habitants valides.
– Mais, pourtant, j’avais cru…
– Vous n’avez ni à croire ni même à comprendre. Écoutez, et quand vous saurez, vous obéirez.
Le Génie du Crime, qui était aussi le plus extraordinaire metteur en scène des plus audacieux cambriolages, précisa avec une clarté lumineuse, son projet :
– Le train, avant d’arriver à l’aiguille, ralentit et se maintient à une allure moyenne de quinze kilomètres à l’heure. Le règlement est observé depuis plusieurs jours déjà, eu égard aux réparations que l’on fait au ballast. Pérouzin, vous vous tiendrez près de l’aiguille, qui, comme vous le verrez, se commande simplement avec un levier à main. Vous laisserez tout le train poursuivre son parcours normal, mais, lorsque le wagon chargé d’or, c’est-à-dire l’avant-dernier du convoi, approchera de l’aiguille en question, vous le ferez bifurquer sur la voie de garage.
– Mais ce wagon déraillera ? dit Nalorgne, muet jusque là.
– Non, déclara Fantômas, il ne déraillera pas. Ses attaches se rompront simplement, et, vu la pente de la ligne à cet endroit, vu également la vitesse acquise, il continuera dans la direction que nous lui aurons indiquée.
Pérouzin ne paraissait pas convaincu :
– Les attaches se rompront, c’est vite dit. Les chaînes sont robustes. Elles résisteront.
Fantômas haussa les épaules :
– Imbécile, ne comprends-tu pas que j’ai tout prévu, et que les anneaux des chaînes seront aux trois quarts sciés à l’avance ? Sitôt le wagon arrêté sur cette voie de garage, je me précipite avec des amis sûrs, et naturellement les caisses pleines d’or tombent entre nos mains.
– Bien, dit Nalorgne, mais, j’y pense. D’ordinaire, dans le dernier wagon, se trouve une guérite, et dans cette guérite, un chef de train. Ce dernier wagon viendra, je le suppose, avec le véhicule chargé d’or.
– Naturellement. Je réponds à l’avance à votre objection en vous disant que le chef de train est un homme à nous.
– Je n’aime pas beaucoup ça. Lorsqu’on se sera aperçu du vol, ce chef de train sera interrogé ; s’il paraît suspect, on le bouclera, et, alors, s’il parle.
– Vous n’avez rien compris, dit le Maître : il ne manquera rien au chargement du wagon d’or, une fois notre vol commis.
– Comment ? s’écrièrent ensemble Nalorgne et Pérouzin. Que voulez-vous dire ?
– Je veux dire, articula Fantômas, que, si on vérifie les contenus des caisses une fois que nous serons passés, on pourra se rendre compte qu’il ne manque pas une seule pièce de monnaie à l’expédition faite par les États-Unis au Gouvernement autrichien.
Abasourdi, Pérouzin déclara :
– J’avoue que je ne comprends pas.
– Cela n’a aucune importance.
Mais soudain, incapable de dissimuler sa surprise, le bandit se dressait tout debout, non sans avoir, un instant auparavant, prêté l’oreille et entendu quelque chose qui le faisait tressaillir. Puis, d’un ton impératif, sans même se préoccuper de la surprise que son attitude provoquait au milieu des consommateurs, Fantômas, avisant le couple d’ivrognes, ordonnait :
– Approchez ici, vous autres.
Et comme les deux individus hésitaient, ne sachant si c’était à eux que l’on destinait cette apostrophe comminatoire, Fantômas, bousculant la foule, arrivait jusqu’à eux, prenait le grand Dégueulasse par le col, et, l’attirant auprès de lui, interrogea :
– Que viens-tu de dire, sinistre farceur ?
– Moi ? demanda le pochard abasourdi, si tu crois que je me souviens de ce que j’ai jaspiné cinq minutes après.
Mais Fantômas, rudement, le secouait :
– Allons, répète, tu as parlé tout à l’heure, à ton copain, d’un accident à Cherbourg, d’un navire qui venait de couler ?
– Ah, si ce n’est que cela répondit Dégueulasse, j’peux bien t’en raconter plus long encore, sur ce chapitre-là. Des fois que tu voudrais être renseigné, t’aurais qu’à payer un verre, mais, comme je suis un bon zigue, j’m’en vas tout de même te répéter pour rien ce que j’ai dit à Fumier. Pour lors, censément, je disais à Fumier : Mon vieux poteau, faut lâcher tes poubelles et tes tas d’ordures de Paris et t’amener avec Dégueulasse travailler à Cherbourg. Va y avoir du boulot ces jours-ci. Un grand navire s’est foutu au fond de l’eau, juste à l’entrée de la passe ; or, paraît qu’il’ est bourré de marchandises qu’on va aller chercher avec les godasses de plomb et la cloche à air sur la caboche.
– Ce navire, interrogeait-il anxieusement, lequel est-ce ? comment s’appelle-t-il ?
– J’devrais le savoir, fit-il, je viens de le dire y a pas deux minutes.
Fantômas, malgré son sang-froid extraordinaire, bouillait d’impatience :
– Son nom ? te dis-je.
Dégueulasse rassembla ses esprits, jeta à Fantômas, d’un air détaché, cette information, qui bouleversa le bandit :
– Le navire coulé dans le port de Cherbourg, c’est un cargo-boat anglais, le Triumph.
***
Fantômas et ses deux complices quittèrent L’ Enfant Jésus, dont le séjour, par suite de la présence de Dégueulasse et de Fumier, devenait de plus en plus insupportable.
Fantômas avait un air sinistre, sa mauvaise figure des grands jours.
Nalorgne et Pérouzin veillaient au grain, gardant bouche close, lorsque soudain Fantômas leur frappa sur l’épaule.
– Eh là, vous autres, fit-il, d’une voix vibrante qui correspondait assurément à son état d’âme. (Tout d’un coup, en effet, le visage de Fantômas s’était transfiguré). Hé, là, vous autres, fini le désespoir. Notre premier projet échoue, par suite d’un cas de force majeure dont nous ne sommes pas responsables, mais ne croyez pas que Fantômas consente à abandonner si vite une fortune aussi belle que celle qu’il a décidé de prendre. Les millions de l’Autriche, nous ne pouvons pas les enlever à terre, comptez sur moi, nous irons les chercher au fond de l’eau.
– Au fond de l’eau ?
– C’est une façon de parler. En attendant, demain soir, à pareille heure, vous me retrouverez à l’usine du Grand-Montrouge.
Il dit, et s’éclipsa.
9 – FANDOR ENQUÊTE
Nalorgne et Pérouzin, dans leur louche étude de la rue Saint-Marc, avaient chambré M lle Hélène, la dactylographe. Ils s’efforçaient de lui présenter ce projet de mariage sous les aspects les plus flatteurs.
Pérouzin :
– Plus que distingué, mademoiselle, bien plus.
Nalorgne :
– Il a de la fortune.
Pérouzin :
– Fortune colossale.
Nalorgne :
– Vous vivrez dans une superbe villa.
Pérouzin :
– Un château, un château.
Pérouzin :
– Il n’a que soixante ans environ.
Ce qui fait que M lle Hélène ne put dissimuler une légère moue.
– Enfin, qu’en pensez-vous ? demanda Nalorgne.
La jeune fille ne disait ni oui ni non, c’était l’essentiel et déjà Nalorgne, homme adroit, posait les jalons pour la première entrevue des « fiancés ».
– Vous savez, mademoiselle, le mariage est souvent une école de sacrifice. Il ne faut pas exagérer les choses cependant. Un mari actif et remuant a son charme, mais il vaut beaucoup mieux, pour une femme comme vous, souhaiter un époux aux mœurs casanières et qui reste chez lui, qui aime son intérieur. Vous aurez toute satisfaction avec M. Ronier, car une légère infirmité, toute passagère, l’empêche en ce moment de beaucoup circuler.
Pérouzin, ami des précisions, se hâta d’ajouter :
– Oui, mademoiselle, M. Ronier est absolument paralysé.
Nalorgne foudroya du regard son associé. M lle Hélène ne put s’empêcher de sourire. Enfin la jeune fille se leva :
– Messieurs, je vous remercie, dit-elle, de l’amabilité avec laquelle vous vous occupez de moi, mais, je vous le répète, je n’étais pas venue vous trouver pour vous demander de me marier. J’espérais simplement que, eu égard à vos relations nombreuses, vous seriez à même de m’indiquer, oh, très discrètement, où je pourrais retrouver une certaine personne à laquelle je m’intéresse.
– En effet, dit Pérouzin, nous savons que vous voulez rencontrer ce M. Jérôme Fandor. Évidemment, nous nous occuperons de le rechercher pour vous être agréable, mais nous vous conseillons aussi de bien réfléchir. Un mariage avec M. Ronier serait beaucoup plus avantageux.
– Mais je ne vous ai pas dit, messieurs, que je désirais rechercher M. Fandor pour l’épouser.
***
Dix minutes plus tard, Nalorgne et Pérouzin arrivaient au Faisan Doréet demandaient à être conduits au salon retenu par M. Prosper.
Il était sept heures moins le quart à peine, et le rendez-vous avait été fixé pour six heures et demie, mais déjà l’ancien cocher, sans la moindre considération pour ses invités, s’était attablé et avait vidé les raviers de hors-d’œuvre.
En face de lui, Irma de Steinkerque, elle aussi, faisait honneur à ce commencement de repas.
– Vous savez, s’écria Prosper, en voyant arriver ses amis, l’heure c’est l’heure, n’est-ce pas ? C’est mon patron qui m’a appris cela quand j’étais en place, eh bien, c’est une bonne habitude que je conserve, de même que celle de dîner tôt dans les restaurants à la mode, vous comprenez pourquoi ?
– Ma foi, pas particulièrement, déclara Pérouzin qui, machinalement, lustrait son chapeau haut de forme de la manche.
– Quand on s’amène de bonne heure, on est certain d’avoir tous les bons morceaux. Maintenant que vous avez compris, à table, et ne perdons pas de temps, car le dîner peut faire attendre les dîneurs, mais les dîneurs ne doivent pas se permettre de retarder le dîner.
***
À huit heures du soir, Nalorgne et Pérouzin, échauffés par les vins capiteux que généreusement Prosper leur avait payés, quittaient le restaurant du Faisan Doréet s’acheminaient vers le boulevard.
De nouveau, l’heure les talonnait. Pérouzin, pour activer sa digestion pénible et diminuer la congestion qui lui montait aux tempes, aurait volontiers fait un bon kilomètre à pied, mais Nalorgne, exsangue et blafard, ne souffrait pas d’un semblable excès de santé et, tout au contraire, l’esprit très net, il disait à son compagnon :
– Prenons une voiture pour nous faire conduire là-bas.
Pérouzin allait faire signe à un taxi-auto, mais Nalorgne l’en empêcha :
– Inutile, dit l’ancien prêtre, de prendre un véhicule aussi cher, un fiacre ordinaire suffira bien. Il ne nous faudra pas plus d’une demi-heure pour aller d’ici à la barrière de Montrouge.
Les deux associés firent donc signe à une voiture à cheval et donnèrent l’adresse, ce qui détermina une sourde colère chez le cocher, peu satisfait à l’idée de s’en aller à cette heure déjà tardive à l’autre bout de Paris.
La décision prise par Nalorgne, si elle ne contentait qu’à moitié Pérouzin, satisfaisait en tout cas un troisième personnage que les deux associés n’avaient point remarqué, bien que cet individu les eût immédiatement suivis depuis leur sortie du restaurant. Dans la foule des promeneurs qui allaient et venaient sur le boulevard, ce personnage pouvait passer inaperçu. C’était un jeune homme d’une trentaine d’années, dont la mise correcte, mais modeste, n’attirait pas l’attention. Comme il tenait à la main une bicyclette, il était obligé, perpétuellement, de demeurer à l’extrémité du trottoir pour que sa machine pût rester sur la chaussée.
Lorsque le cycliste vit que les deux associés prenaient un vulgaire fiacre, il poussa un soupir de satisfaction :
– Pour une fois, j’ai de la chance. S’il m’avait fallu, avec mon manque d’entraînement, suivre une automobile, je n’aurais jamais pu y parvenir. Mais où diable ces gaillards vont-ils m’emmener ?
L’inconnu se résigna à se laisser guider, enfourcha sa machine et se faufilant, non sans difficulté, au milieu des encombrements, ne perdit pas de vue le véhicule dans lequel étaient montés les deux agents d’affaires de la rue Saint-Marc.
Si ces deux nigauds de Nalorgne et Pérouzin avaient porté leur regard autour d’eux, c’eût été l’occasion pour eux de retomber une fois de plus sur cette sagesse des nations chère au moins au second nommé, pour dire : le monde est petit, seules, les montagnes, ne se rencontrent pas. Le jeune homme qui les suivait, en effet, n’était autre que celui qu’ils avaient mission de retrouver pour leur cliente M lle Hélène, la dactylographe d’Hervé Martel.
Qu’était donc devenu le journaliste, depuis les heures tragiques où, s’efforçant de prendre Fantômas, il avait dû abandonner la poursuite du sinistre bandit pour ramasser son malheureux ami Juve, tombé sous les coups de l’ennemi ?
Préoccupé par la santé de Juve, Fandor, pendant de longues semaines, n’avait pas quitté le chevet de son ami. Mais bientôt, il avait dû se remettre à son métier de journaliste. S’il était revenu à son ancien journal, La Capitale, il avait, sur le conseil de Juve, décidé de garder l’anonymat. Désormais, ses articles paraissaient non signés.
Cependant, le mauvais état de santé du policier s’éternisait. Un jour, avec une force de caractère admirable, il avait déclaré à Fandor :
– Mon pauvre petit, je crois bien que la paralysie ne me quittera plus.
Ce qui ne l’empêchait pas de continuer à travailler une dizaine de jours auparavant. Juve avait dit au journaliste, à propos des affaires mystérieuses de l’avenue Niel :
– Il y a dans l’entourage d’Hervé Martel des gens suspects et des événements mystérieux. Occupe-toi donc un peu de connaître les tenants et aboutissants de tout ce monde-là.
Or Fandor avait appris, dès qu’il avait commencé ses enquêtes, qu’il y avait, faisant partie du personnel de la charge d’Hervé Martel, une certaine jeune fille du nom d’Hélène. Certes, il en existait d’autres, du moins on le disait, mais pour Fandor, il n’en était qu’une. Le hasard, ou sa bonne étoile, ou simplement encore la perspicacité de Juve, allait-il le mettre sur la trace de la fille de Fantômas ?
Sur ce, Jérôme avait reçu un mot de Jean, porte-plume de son maître, le priant de surveiller le cocher Prosper et les individus qu’il fréquentait. C’est ainsi que Fandor, tout naturellement, était tombé sur Nalorgne et Pérouzin, ce qui explique qu’on le retrouve en train de les filer.
Le fiacre s’arrêta enfin aux fortifications. Et Fandor, décrivant avec sa bicyclette un virage savant, s’éloigna du véhicule pour se dissimuler dans l’ombre des fossés. Les parages de la porte de Montrouge étaient déserts en effet, à cette heure de la soirée. Cependant Nalorgne et Pérouzin, après avoir réglé leur fiacre, franchirent la barrière et s’acheminèrent à pied vers le sinistre quartier du Grand-Montrouge, dont les misérables habitations, mêlées à de vagues ateliers, à de sombres usines, donnent à l’ensemble de la région un aspect redoutable, lugubre.
– Où diable vont-ils ? se demandait Fandor, derrière eux, le guidon à la main.
Soudain, les deux associés s’arrêtèrent devant une masure surmontée d’une haute cheminée, ce qui lui donnait une allure d’usine. Ils frappèrent à une porte basse, attendirent quelques instants. La porte s’entrebâilla. Les deux hommes pénétrèrent dans la propriété, entrant dans le noir, et Fandor se retrouva dans une petite ruelle aux pavés inégaux.
Cependant aux coups frappés par Nalorgne et Pérouzin, quelqu’un était venu ouvrir. Les deux associés avaient reconnu Fantômas. Le bandit verrouilla soigneusement derrière lui, puis fit signe de le suivre aux agents d’affaires.
Nalorgne et Pérouzin n’étaient pas autrement rassurés. Jusqu’à présent, ils avaient trouvé profit à travailler pour Fantômas. Mais ils étaient loin d’avoir le tempérament énergique et combatif du Génie du Crime. Nalorgne et Pérouzin n’étaient mûrs que pour les petites escroqueries, les modestes indélicatesses, les ignominies restreintes. L’audace de Fantômas les terrorisait, mais, timides à l’extrême et perpétuellement inquiets, aussi bien du châtiment que de la vengeance, ils n’osaient réagir. Situation étrange que la leur, du reste. Ils faisaient des démarches pour être accrédités dans la police et faire partie de la Sûreté parisienne. En ce même temps, ils se trouvaient embauchés par le plus redoutable des criminels, et depuis quelques jours étaient devenus ses complices. Nalorgne et Pérouzin se demandaient fréquemment depuis quelques jours comment tout cela finirait. Pour l’instant toutefois, ils restaient plantés là, yeux écarquillés devant le spectacle que leur montrait le Maître. Après leur avoir fait traverser quelques pièces encombrées de caisses de toutes sortes, ils les avait introduits dans un vaste atelier où une odeur d’acide prenait à la gorge et vous arrachait des larmes brûlantes. Quelques ouvriers. Des caisses.
Un homme allait et venait de l’établi à la caisse ouverte. À chaque voyage, il portait des rouleaux d’or, qu’il déposait dans la seule caisse qui fût encore ouverte.
Fantômas expliquait :
– Voilà les caisses qui seront repêchées du navire coulé à Cherbourg. Vous voyez ce qu’elles contiennent ?
– Naturellement, fit Pérouzin, des louis d’or, dame !
Fantômas ricana, puis, haussant les épaules :
– Imbécile, c’est de la fausse monnaie. Vous Nalorgne, qui connaissez la musique, vérifiez donc si les marques, les désignations que je viens de faire reproduire sur les caisses que nous avons ici sont conformes aux connaissements.
– Ah çà ! dit Pérouzin, mais vous avez vos entrées partout. Ces papiers-là devraient être en la possession de la Compagnie d’assurances qui a garanti le risque, ou tout au moins entre les mains du courtier.
– Imbécile, fit Fantômas, ils étaient peut-être, ces jours derniers, dans les dossiers d’Hervé Martel. Mais j’en ai eu besoin, et les voilà.
Les deux associés, interdits, se taisaient, admirant l’imperturbable calme de Fantômas.
Dans l’atelier, silencieux, discrets et actifs, trois hommes s’empressaient. Un graveur donnait le dernier coup de poli aux pièces d’or qu’un autre ouvrier mettait en rouleaux, portait dans les caisses, cependant que le troisième ternissait le bois neuf où il portait les signes convenables. À n’en pas douter, on préparait la substitution. Mais comment allait procéder Fantômas ? C’est ce que Nalorgne et Pérouzin auraient bien voulu savoir. Fantômas, cependant, au lieu de les renseigner, les questionna :
– Qu’y a-t-il de nouveau avenue Niel ? Les inspecteurs de la Sûreté, Léon et Michel, y sont-ils toujours ?
– Ma foi, oui, déclarèrent ensemble Nalorgne et Pérouzin, voilà près d’une semaine qu’ils ne quittent pas le domicile du courtier. Cela menace de durer.
– Cela ne durera pas. Demain, tout sera fini. Tant pis pour eux. Tant pis pour Léon et Michel. Ils devraient savoir que Fantômas n’aime pas qu’on se mêle de ce qui ne vous regarde pas. Demain, ils l’apprendront à leurs dépens.
***
– Ah ça grogna Fandor accoudé sur le parapet du pont Saint-Michel, est-ce que ça va durer toute la nuit, et va-t-il falloir qu’à l’aube je me déclare aussi peu renseigné que je le suis pour le moment ?
Il était onze heures du soir, et Fandor, s’il n’avait pas perdu la trace de Nalorgne et de Pérouzin, ne savait toujours absolument rien de ce qu’ils faisaient. Le journaliste les avait attendus dans le quartier désert du Grand-Montrouge pendant une bonne heure. Il avait vus sortir de la mystérieuse usine, puis regagner précipitamment la porte. Nalorgne et Pérouzin, ensuite, avaient pris le tramway Montrouge-Gare de l’Est pour descendre quai des Orfèvres, et Fandor, à sa grande stupéfaction, les avait vus pénétrer dans les locaux de la Préfecture de Police. Un quart d’heure plus tard, ils avaient reparu. Car, lorsqu’on y va de son plein gré, on a quelquefois la chance d’en ressortir.
Cette fois, Fandor n’hésita plus. Il fallait être renseigné, coûte que coûte. Le journaliste s’arrangea donc pour barrer la route des deux agents d’affaires qui venaient de tourner dans le boulevard du Palais.
– Ah, par exemple, messieurs, du diable si je pensais vous rencontrer ici.
Interloqués, Nalorgne et Pérouzin considéraient cet interlocuteur qu’au premier abord ils ne reconnaissaient pas. Mais Fandor leur rafraîchit la mémoire :
– Voyons, vous avez donc oublié Monaco ?
– Ah, par exemple, mais c’est M. Fandor ?
– M. Fandor, effectivement.
Le journaliste mima une grande satisfaction à retrouver les deux ex-inspecteurs de police de la Sûreté monégasque :
– Eh bien, s’écria-t-il, puisqu’on se retrouve ainsi, on ne se quitte pas comme ça. Moi, ça me fait plaisir de vous revoir, je vous invite à prendre quelque chose.
Nalorgne hésitait, mais Pérouzin, sincèrement, déclara :
– Eh bien, ma foi, ce n’est pas de refus. D’ailleurs, nous venons tous les deux, mon associé et moi, d’apprendre une bonne nouvelle, il faut l’arroser. Après votre tournée, ça sera la nôtre. Et enfin, ajouta l’incorrigible bavard, ce qui se passe depuis quelques jours n’est pas croyable. Quand je pense que, pas plus tard que ce soir, on nous parlait de vous.
– De moi ?
– Et une jolie personne, encore. Aïe, Nalorgne, mais faites donc attention, vous me marchez sur le pied.
Un regard de Nalorgne fit taire son associé. On parla d’autre chose. Et comme l’on trinquait autour de la table du café où l’on s’était installé, Nalorgne, répondant à la question du journaliste leur demandant quelle était l’heureuse nouvelle dont ils avaient, lui et son associé, à se féliciter, l’ancien prêtre, triomphalement, annonça à Fandor :
– Mon cher monsieur, puisque vous voulez bien vous intéresser à nous, sachez donc que nous sortons du cabinet de M. Havard. Eu égard à notre profession antérieure, nous avions sollicité l’un et l’autre, mon ami Pérouzin et moi, notre entrée dans la police. Or, Monsieur le Directeur de la Sûreté vient de nous aviser que notre demande était officiellement agréée. Nous appartenons désormais au service de la Sûreté générale, en qualité d’inspecteurs auxiliaires.
Fandor leva son verre et, cérémonieusement :
– Je vous félicite, messieurs, de cet heureux événement qui exauce vos vœux. Je félicite aussi la police française, d’avoir su s’attacher la précieuse collaboration de deux hommes aussi perspicaces que vous, monsieur Nalorgne, que vous, monsieur Pérouzin.
Achevant son petit discours, Fandor ne pouvait s’empêcher de se souvenir de la facilité avec laquelle, depuis plus de deux heures, il filait les deux phénix de la Tour Pointue.
10 – VENTOUSE
– Baptiste, frictionnez-moi plus fort.
– Monsieur m’excusera, mais j’ai peur d’écorcher monsieur.
– Eh marchez donc, puisque je vous le dis, j’ai la peau dure comme un vieux cuir !
Baptiste, avec une ardeur nouvelle, frictionnait de son long gant de crin les épaules d’Hervé Martel, qui sortait du tub et qui, depuis son réveil, était de très mauvaise humeur.
– Baptiste, quel temps fait-il dehors ?
– Il pleut, monsieur.
– Naturellement.
Hervé Martel alluma une cigarette, ouvrit le journal. Il ne s’était rien passé. Il rejeta la feuille dans le lavabo.
– Baptiste ?
– Monsieur ?
– Qu’est-ce qui trafique dans mon cabinet ? Depuis que je suis levé, j’entends remuer tout le temps. J’ai pourtant répété cent fois que je voulais que Rosalie fasse la pièce de bonne heure.
– Ce n’est pas Rosalie, monsieur, qui est dans votre cabinet.
– Qui donc ?
– Les Pieds-Crottés.
– Ils sont encore là ?
– Mais oui, monsieur.
– Et qu’est-ce qu’ils font ?
– Ils sont couchés sur le tapis de monsieur, ils salissent le plus qu’ils peuvent et ils fouinent partout.
– Passez-moi mon pyjama, Baptiste, je vais aller leur dire deux mots.
Ceux que Baptiste avait qualifiés irrespectueusement de « Pieds-Crottés » étaient en réalité deux hommes assez correctement habillés, sinon élégants, qui se trouvaient dans la pièce, à plat ventre sur le tapis, l’oreille collée au sol et semblant écouter.
– Encore vous, messieurs ? dit Martel.
Les deux hommes s’étaient relevés en faisant de grands gestes pour lui recommander le silence.
– Venez dans le corridor.
– Chut.
– Eh bien, avez-vous trouvé quelque chose ?
– Peut-être.
– Car je vous préviens que si vous n’avez rien trouvé ce matin, j’aime mieux ne rien apprendre du tout et être tranquille.
Les deux hommes échangèrent un regard navré, semblaient se consulter du regard, puis, le plus âgé d’entre eux prit la parole, comme à contrecœur.
– Monsieur, nous vous demanderons encore trois jours de patience. Diable. Cela vaut la peine. Vous avez perdu dix mille francs de titres. On a tout bouleversé chez vous. Puis on vous a encore volé cent billets de mille francs. Vous ne pouvez pas nous refuser encore trois jours ?
– Messieurs, commença le courtier, lorsqu’il y a huit jours, en désespoir de cause, je me suis adressé à la Préfecture pour demander deux inspecteurs, M. Havard m’a assuré qu’on chercherait le voleur avec tact, discrétion et célérité. Je ne dis pas que vous ayez commis une grosse gaffe. Je constate néanmoins que voici huit jours sans résultats, huit jours entiers que vous passez à vous traîner sur mon tapis, à regarder mes meubles par en dessous, et cela sans que l’enquête ait progressé d’un pas.
– Nous nous trouvons, monsieur, en présence d’un phénomène extraordinaire.
– Je ne dis pas le contraire. Je le crois même si extraordinaire que je suis persuadé que vous n’y comprendrez jamais rien. Vous me demandez trois jours de patience ? Soit. Mais que dans trois jours, cette comédie soit finie, ou alors, bonsoir ! J’aime mieux déménager et renoncer à connaître le mystère de mon appartement.
Il dit, et laissa les policiers.
Restés seuls, les deux hommes sourirent.
– Je crois, monsieur Léon, dit le premier, que les choses vont se gâter.
– Qu’est-ce que cela peut faire, Michel, lui répondit son compagnon, avant trois jours nous serons renseignés.
Et les deux inspecteurs regagnèrent le cabinet de travail où ils recommencèrent à faire la planche sur la carpette, et à se traîner comme le font les pinsons de pierre en pierre, d’un meuble à l’autre.
Il serait déloyal de dissimuler que l’avant-veille seulement, Léon et Michel avaient rendu visite à l’excellent Juve. Au Roi des Policiers, ils avaient confié leur extrême embarras, et c’est, semble-t-il en vertu des conseils, de leur ancien chef, qu’à présent, ils se livraient aux bizarres manœuvres qui indisposaient le maître de maison et son personnel.
Toutefois, alors que jusqu’ici, les deux inspecteurs avaient travaillé dans le doute, à présent ils échangeaient des regards radieux.
Au moment où on les saisit, Léon est à plat ventre, la tête engagée sous le canapé du coin. Quant à Michel, sur le dos, il disparaît sous la bibliothèque. Suit un échange de signes de sourds-muets, et ils finissent par sortir encore une fois :
– Vous avez entendu, Léon, ça ne va pas traîner.
– Oui, Michel, ça ronfle, ça ronfle. Quand même, ce Juve quel homme, faut-il qu’il soit fort pour avoir tout compris, sans rien voir, de son lit.
Ils causaient encore quand Hervé Martel apparut, habillé cette fois :
– Alors, messieurs, nous nous livrons à la même comédie que chaque matin ? Quelles paroles ridicules dois-je prononcer ?
Léon sourit. Michel protesta :
– Croyez bien, monsieur Martel, que ce ne sont pas des paroles si ridicules que ça. D’ailleurs, mon collègue et moi, nous sommes maintenant persuadés que d’ici quelques heures, nous vous expliquerons tout ce qui peut vous intriguer.
– J’en accepte l’augure. Que dois-je dire ?
– Exactement la même chose qu’hier.
Hervé Martel, l’air résigné, précéda les deux inspecteurs dans son cabinet de travail. Il alla s’asseoir à son bureau. Il parla, feignant de s’adresser à sa dactylographe, M lle Hélène absente d’ailleurs.
– Bonjour, mademoiselle. Oui, je vais bien. Ah, nous ne travaillerons pas ce matin. Je vais tout bonnement vous donner des expéditions à faire. Faites-y bien attention, par exemple. Je ne tiens pas à perdre encore de l’argent. Depuis quelque temps, j’ai vraiment trop de malheur.
Hervé Martel s’interrompit, haussa les épaules, et regarda dans les yeux Léon, qui, très calme, montre en main, chronométrait la durée.
Léon fit un signe. Le courtier recommençait :
– Vous affranchirez ces lettres, mademoiselle. Les voilà signées. Bien. Autre chose, maintenant. Je vais vous donner dix billets de mille francs que vous porterez cet après-midi, au bureau, place de la Bourse. Attendez une seconde.
Gardant toujours un air résigné, un air de contrainte, Hervé Martel tirait de sa poche son trousseau de clefs, ouvrait, à grands fracas, le tiroir-caisse de son bureau et il y prenait, liés ensemble par une épingle, dix morceaux de papier blanc de la grandeur et de l’épaisseur d’un billet de banque :
– Voici ces dix billets de mille, mademoiselle, je les pose sur l’étagère, vous les prendrez tout à l’heure. Venez s’il vous plaît au salon avec moi, je vais vous montrer les gravures qu’il faudra remettre à l’encadreur car je vais sortir et vous resterez seule ici.
Hervé Martel se leva, sortit encore une fois du cabinet de travail, Léon et Michel le rejoignirent dans la galerie.
– Vous êtes satisfaits, messieurs ? Vous n’avez plus besoin de moi ? J’ai bien fait le pitre. Oui ? Alors tout est pour le mieux. Et maintenant bonne chance. Je souhaite que les dix billets de mille francs vous mettent sur la piste. Mais je vous avoue que j’en doute. J’ai comme une idée que c’est un homme intelligent, et que votre piège est un peu grossier.
Hervé Martel, après un petit salut, abandonna les deux inspecteurs, prit son chapeau et sortit.
Depuis qu’ils enquêtaient au sujet des vols incompréhensibles, Léon et Michel contraignaient Hervé Martel chaque matin, à jouer la même comédie. Instruit par eux, Hervé Martel prononçait des phrases caractéristiques :
– Mademoiselle, voici dix mille francs que je mets sur cette table.
– Mademoiselle, vous expédierez ces titres de rente, que je pose sur la cheminée à l’adresse de mon agent de change.







