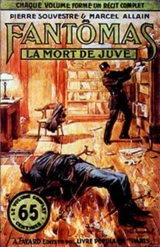
Текст книги "La mort de Juve (Смерть Жюва)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
– C’est que nous ne sommes pas architectes.
M. Hervé Martel fronçait le sourcil et Nalorgne, prévenant par son interruption la gaffe probable de son associé, déclara :
– Nous allons en parler au propriétaire, mais je vois ce que c’est : c’est le tirage qui ne marche pas, la cheminée tire mal, c’est un détail insignifiant, nous ferons le nécessaire.
Puis, feignant d’être un homme très occupé, et sans tenir compte des signes que lui faisait son associé qui réprouvait un tel bluff, Nalorgne, tirant sa montre, s’exclamait :
– Mon Dieu qu’il est tard, et nous avons encore cinq ou six clients à voir avant le dîner. Vous n’avez plus rien à nous dire ?
– Non, fit d’un ton bourru le courtier, du moment que vous allez faire arranger la cheminée, c’est l’essentiel.
Nalorgne poussait son associé vers la porte, mais soudain, comme ils en franchissaient le seuil, Hervé Martel les rappelait :
– Messieurs ?
– Qu’y a-t-il ?
Ils revinrent sur leurs pas, Hervé Martel s’en fut fermer lui-même la porte qui faisait communiquer son cabinet avec la galerie. Il abaissa même une portière, puis revenant auprès des deux associés, il leur demanda :
– Avant d’être dans les affaires, messieurs, vous étiez, dans la police, si je ne me trompe ?
– Pardon, nous étions inspecteurs généraux de la Sûreté générale de Monaco.
– Je me le rappelle, en effet, fit le courtier d’assurances. Vos silhouettes m’étaient familières, ces derniers hivers, lorsque j’allais dans les salles de la roulette à Monte-Carlo. Bien. Exercez-vous toujours ce… métier ?
– Nous faisons, en effet, déclara-t-il, des enquêtes discrètes, des recherches, dans l’intérêt des familles. Naturellement nous ne travaillons pas pour tout le monde. Mais lorsqu’il s’agit d’un client, d’un client important bien entendu…
– En somme, interrompit Hervé Martel, vous seriez disposés ?
Nalorgne cligna de l’œil, hochait la tête :
– Nous sommes à votre entière disposition.
Tant et si bien que le courtier leur raconta la disparition des dix milles francs de titres, la dactylo qui avait vu le paquet, l’ancien cocher Prosper qui était entré et sorti.
– Tout cela, dit Pérouzin, est extrêmement grave.
– Grave, peut-être. En tout cas l’aventure est compliquée.
– Plus que vous ne le croyez, poursuivit Hervé Martel. J’oubliais de vous dire qu’à un moment donné, nous avons entendu, M lle Hélène, la dactylographe, et moi, comme un profond soupir. J’ai même plaisanté à ce propos, M lle Hélène, lui demandant si elle avait des peines de cœur. Or elle n’avait poussé aucun soupir.
– Voilà, fit Nalorgne, qui est étrange.
– Extraordinaire, dit Pérouzin.
– N’est-ce pas, messieurs, fit le courtier. Pour ma part, je vous avoue que je ne comprends pas, mais là pas du tout. Je ne sais qu’une chose malheureusement, c’est que mes titres ont disparu et que je voudrais bien les retrouver.
– Et vous voulez nous charger de faire une enquête ?
– Ma foi, déclara franchement Hervé Martel, telle est en effet mon intention, mais vous comprenez comme c’est délicat. Je ne tiens pas du tout à ce que la chose s’ébruite. Il s’agit là d’une aventure désagréable qui s’est passée chez moi. Tâchez donc de faire la lumière, mais avec tact et discrétion. Si je ne m’adresse pas à la Préfecture de Police, c’est précisément pour éviter à ceux qui m’entourent, les brutalités de ces messieurs du quai des Orfèvres. Attention, n’est-ce pas, et du tact. Tenez, il y a aussi mon valet de chambre, le vieux Baptiste, qui depuis vingt ans est dans la famille. Bien entendu, je ne l’accuse pas. Mais enfin, l’enquête vous regarde. Agissez, et à bientôt.
– Ah, dit Nalorgne, une fois que les deux nouveaux détectives privés se retrouvèrent dans la rue, nous trouverons et ce n’est pas difficile de dire, dès à présent, quel est le coupable.
– Oui, dit Pérouzin, vous avez raison de dire « le » car dans cette affaire on ne peut pas dire : « Chercher la femme ».
– La femme, non, mais le cocher.
– Oui, nous sommes bien d’accord. Parbleu, la voilà la source inexpliquée de la soudaine fortune de Prosper. C’est lui qui, ce matin encore a dérobé les titres de son ancien patron. Bonne affaire, bonne affaire, nous avons à la fois sous la main le coupable et le plaignant. Et dans les quarante-huit heures, grâce à notre perspicacité, j’aime à croire que le sympathique Prosper couchera au Dépôt.
3 – L’INCOMPRÉHENSIBLE COUP DE VENT
– Vous direz tout ce que vous voudrez mais lorsqu’on sait s’arranger, prendre la vie du bon côté, ne jamais mettre midi à quatorze heures, se persuader que tout s’arrange, avoir le plus souvent possible le ventre à table et le dos au feu, connaître de bons amis, réussir dans sa profession, l’existence est encore une chose charmante. Je porte la santé de notre chère Irma.
Le courtier maritime avait réuni ce soir-là, chez lui, ceux qu’il appelait ses amis de plaisir, par opposition aux autres.
– Chaque jour, disait Martel, je suis obligé de fréquenter mes collègues, courtiers maritimes. Ce sont d’excellentes gens qui me parlent courtage maritime. Or, le courtage maritime m’intéresse de huit heures du matin à six heures du soir. Après il m’assomme. Donc, si j’ai des amis s’occupant de courtage maritime, ils ne m’intéresseront que jusqu’à six heures du soir. Passé ce moment, fini !
En conséquence de quoi, l’assistance, ce soir, ignorait tout des questions de fret, connaissements ou sinistres.
À sa droite, trônait Irma de Steinkerque, grosse bonne fille visant à la minceur demi-mondaine, au coup de fourchette fameux, présence obligatoire à tous les « balthazars ».
À côté d’elle, Maurice de Cheviron, titulaire d’une excellente charge d’agent de change, dont toute l’ambition était de mériter le qualificatif de boulevardier. Il savait les derniers potins du Tout-Paris, fredonnait le refrain en vogue, tutoyait la vedette du music-hall à la mode. Lui aussi possédait un coup de fourchette appréciable et de plus se connaissait en vins.
À gauche du maître de maison, Charley, un petit jeune homme d’un blond déteint, à la moustache tombante, artiste, mais personne ne savait si la musique, la littérature, la peinture, la sculpture, étaient l’occupation dont il attendait gloire et fortune.
Hervé Martel recevait parfaitement.
– Vrai, c’est rigolo, affirmait Irma de Steinkerque, souriant d’un râtelier superbe à une maigre jeune femme blonde coiffée à la Botticelli qui accompagnait Maurice de Cheviron. J’ai déjà remarqué ça. Quand on veut faire un bon dîner, il ne faut pas être plus de quatre ou cinq.
Mais on discutait de la représentation prochaine d’un cirque de gens du monde :
– Vous savez que la petite baronne dansera sur la corde raide ? demanda Cheviron.
– Parbleu, elle a l’habitude des faux pas.
Et comme on riait de cette rosserie non déguisée, Irma qui n’avait pas compris :
– Mais non, c’est pas vrai. Elle marche là-dessus tout à fait bien, comme sur un plancher.
– Décidément, mon cher Hervé, disait Charley, je commence à croire que le courtage maritime est une excellente classe. Depuis que vous avez acheté votre charge, on ne vous reconnaît pas. Auparavant vous étiez silencieux, triste, renfermé.
– Et maintenant, je suis gai comme une petite folle ? Parbleu, vous oubliez, mes amis, que vous me voyez toujours après l’heure fatidique où j’abandonne mes affaires. Moi, je fais de ma vie deux parts, l’une pour le travail, l’autre pour le plaisir.
– Et quelle est la plus grosse ?
Hervé allait répondre, Irma lui coupa la parole d’une plaisanterie, stupide à son ordinaire :
– Cela dépend des dames.
Sur quoi, avec un air de reproche et une face indignée, Rosalie, la vieille domestique, qui, les jours de réception intime, aidait Baptiste au service de la table, quitta la salle à manger après avoir jeté à son maître un regard dédaigneux.
Rosalie ne pouvait souffrir qu’Hervé Martel, un monsieur si bien, un monsieur, reçût de la sorte, « n’importe qui » chez lui.
– C’est des gens qu’on voit au restaurant, affirmait Rosalie.
Mais qui se souciait de ce que pensait Rosalie ?
– Vrai, demandait Irma de Steinkerque à Charley, vous croyez que je pourrais apprendre à danser ?
– Mieux que Terpsichore, affirma gravement le courtier maritime, d’ailleurs, je parie que vous valsez à ravir.
– Non, je ne sais pas.
– Allons donc.
– Allez, Charley intervint alors Cheviron, faites-nous l’invitation à la valse qu’Irma nous montre ses talents, je me charge de la musique.
On rit, on applaudit, Charley se leva pour inviter Irma de Steinkerque, l’enlaça et la fit tournoyer, tandis qu’avec un accord touchant, les autres convives bourdonnaient la valse lente.
Tandis que Rosalie murmurait :
– Si c’est pas honteux. C’est des orgies qu’ils font.
Or, au moment précis où Charles Charley, que l’on n’aurait pas cru si vigoureux, faisait pirouetter une Irma de Steinkerque tenue à bout de bras, un vacarme surprenant s’éleva dans l’appartement du courtier maritime. Comme si le plafond se fût écroulé. Comme si les meubles eussent dansé la polka. Comme si… Une seconde, deux secondes… Puis le silence.
– Hein ? Qu’est-ce qu’il y a ? Vous avez entendu ?
– Mes amis, commença Hervé Martel, excusez-moi quelques secondes, je vais voir…
– On vous suit.
***
– Qu’est-ce qui se passe, Rosalie ? qu’est-ce que c’est ?
Rosalie était à l’abri, derrière la silhouette bedonnante d’un superbe maître queux.
– Je ne sais pas, monsieur, répondait Rosalie, mais bien sûr que c’est le diable ou un démon, la maison en a tremblé.
– Vous savez, dit Martel, ne vous attendez pas à une surprise, ça ne fait nullement partie du programme des fêtes. Ah ça, par exemple, la porte est donc fermée ?
Mais Hervé Martel se trompait. Devant la résistance imprévue de la porte du cabinet de travail, il avait fait un violent effort et soudain elle s’ouvrit :
Le cabinet de travail si bien rangé il y a un moment, offrait un spectacle de champ de bataille.
L’étagère, chargée de petits vases précieux, était écroulée sur le sol, les coussins du canapé gisaient, éventrés, près de la cheminée, les chaises étaient renversées, les fauteuils crevés montraient le crin. Sur le bureau, les papiers en tas, en traînée, jonchant la pièce. Les tableaux arrachés, jetés sur le sol. Un rideau de la fenêtre accroché aux candélabres de la cheminée. La bibliothèque avait sa vitre lamentablement brisée. La corbeille à papiers était vidée de son contenu répandu à travers la pièce. Sur la petite table où d’ordinaire la dactylographe travaillait, le pot de colle perdait son liquide nauséabond.
Il semblait vraiment qu’on se fût battu dans la pièce, qu’on y eût cambriolé, qu’on l’eût mise au pillage, à sac.
– Nom d’un chien de nom d’un chien, disait le maître de maison.
Et il appela :
– Baptiste. Rosalie. Qui est entré ici ?
– Personne, monsieur.
– Personne ? Allons donc. Ça ne s’est pas fait tout seul tout de même.
– Non, monsieur, mais enfin…
– Enfin, quoi ? vous voyez bien que tout est cassé.
– C’est des esprits, dit la vieille Rosalie, le plus sérieusement du monde.
– C’est pas ordinaire, disait Irma de Steinkerque, dont le gros bon sens n’était qu’à demi rassuré, c’est pas ordinaire, qu’est-ce qui a pu flanquer tout ça par terre ?
Charley, les mains derrière le dos, méditait :
– Bougre, c’est qu’il y en a pour des sous dans le dommage causé. On a certainement voulu vous cambrioler, mon cher Hervé.
– En une minute ?
Charles Charley ne répondit point.
C’était exact, en effet. De la salle à manger ils avaient tous entendu le fracas causé par le bouleversement de la pièce. Ce fracas n’avait duré que quelques secondes. C’est en quelques secondes seulement que tout avait été bouleversé, mis sens dessus dessous.
Mais comment ? Cela dépassait vraiment les forces humaines.
Maurice de Cheviron, qui jusqu’alors n’avait rien dit, interloqué par ce qu’il voyait, essaya le premier d’apporter un peu de clarté dans les mystères présents :
– Ma foi, commençait-il, il faut bien pourtant que ce soit quelqu’un qui ait fait cela. Seulement comment a-t-il pu le faire ?
L’agent de change se tourna vers la vieille bonne :
– Dites-moi, Rosalie, vous êtes arrivée combien de temps après le bruit, devant la porte du cabinet de travail ?
– Monsieur, quand le bruit s’est fait, j’étais justement là, dans la galerie, je passais pour aller chercher les cigares dans le cabinet de monsieur.
– Vous étiez devant la porte ?
– Oui, monsieur, j’allais entrer quand ça s’est produit, j’en ai encore les sangs tout retournés.
– Mais alors, personne n’est sorti ?
– Ce n’est pas possible, commença M. de Cheviron, se tournant vers Hervé Martel, ce n’est pas possible, mon vieux, ce qu’elle dit, ta cuisinière. Tu entends ?
– C’est bizarre, c’est absolument bizarre et totalement incompréhensible. Voilà la deuxième chose extraordinaire qui se passe dans cette pièce, car, tu te rappelles, Maurice, ce que je t’ai dit au sujet du vol dont j’ai été victime ?
De la cuisine, un homme à figure de fournisseur s’approchait, accompagné d’un gilet rayé :
– Monsieur Martel, s’il vous plaît ?
– Hein ? quoi ?
Énervé, le maître de maison allait se fâcher. Non. Il éclatait de rire :
– Allons bon, s’écriait-il, c’est vous, monsieur Nalorgne ? c’est vous, monsieur Pérouzin ?
Le fournisseur et le domestique n’étaient autres en effet que les deux « gérants ».
Ils étaient ravis, fiers, triomphants :
– Parfaitement, monsieur Martel, répondait Pérouzin, jetant des regards satisfaits sur l’assistance qui se demandait qui pouvait bien être ce nouvel arrivant, parfaitement, c’est bien moi Pérouzin, détective, et voici mon associé Nalorgne, détective aussi. Cher monsieur, vous nous avez priés, il y a quelques jours, de nous occuper d’une affaire mystérieuse qui s’est produite chez vous, vous voyez que notre sollicitude est grande et que nous n’épargnons rien pour vous donner satisfaction. Nous savions que vous receviez du monde aujourd’hui, nous avons pensé qu’il était possible que quelque événement fâcheux intervint, et, vous le voyez, nous sommes venus pour vous garantir de tout danger.
– Je vous remercie beaucoup, Messieurs, mais que savez-vous ? que s’est-il passé ? vous avez vu ce qui est arrivé ?
– Nous ne savons rien du tout, nous n’avons rien vu, rien entendu, nous nous tenions dans la cuisine, pour ne pas nous faire remarquer.
– Mais alors votre surveillance ?
– Elle n’a pas lieu de s’exercer tant qu’il ne se passe rien.
– Hé fichtre de bon Dieu, il est bien temps d’arriver quand tout est fini. Au moins vous comprenez quelque chose à ce qui s’est passé ? Vous allez nous donner une explication ?
Nalorgne, à son tour, s’avança :
– Nous vous demanderons une huitaine de jours pour l’enquête, Monsieur.
Le mot de la fin, ce fut Charley qui l’eut :
– Il doit y avoir des maisons hantées.
Mais là-dessus, Irma de Steinkerque poussa de tels cris, que Charley se tut.
Seuls Nalorgne et Pérouzin, qui s’estimaient très forts d’avoir pensé à se déguiser pour arriver après tout le monde sur les lieux, gardaient le sourire. Ces deux garçons étaient des esprits forts.
4 – SUR LA PENTE SAVONNÉE
Dans leur modeste cabinet de la rue Saint-Marc, Nalorgne et Pérouzin se promenaient de long en large, se frottant les mains, échangeant des clins d’yeux satisfaits, des sourires entendus.
Nalorgne et Pérouzin exultaient. Quelques instant auparavant, en effet, il était près de huit heures du matin, ils avaient échangé une dernière poignée de main avec leur excellent ami Prosper, l’ancien cocher d’Hervé Martel. Prosper avait dû leur parler d’affaires importantes et, en tout cas, leur donner de bonnes nouvelles. L’ex-cocher était ce matin-là revêtu d’un uniforme d’encaisseur des grandes banques.
– Mon cher, disait Nalorgne, arrêtant, en le prenant par le pan de sa jaquette, son associé qui frénétiquement déambulait dans le cabinet de travail, mon cher, plus de doute.
– Et par conséquent notre devoir est ?
– De conclure le plus vite possible une enquête qui fera grand honneur à notre étude.
– Je crois, reprit Nalorgne, qu’il n’y a pas deux façons d’opérer. Vous allez vous rendre, mon cher Pérouzin, au commissariat de police, vous préviendrez le commissaire de ce qui se passe, et moi, pendant ce temps, j’irai chercher le principal témoin. De la sorte, quand notre homme reviendra, nous n’aurons qu’à le cueillir. Hé, hé, je ris d’avance en imaginant sa surprise.
Il en riait encore quand retentit un coup de sonnette.
– Un client ! Rappelez-vous, Pérouzin, que les affaires amènent les affaires. L’argent amène l’argent. Nous sommes en train de conclure une enquête très importante, je ne serais nullement étonné que, nos travaux terminés, nous en ayons d’autres immédiatement.
En vérité, c’était le courrier.
– Où est l’ouvre-lettres ?
L’ouvre-lettres enfin retrouvé, Pérouzin, avec une solennité pompeuse, annonça :
– Mon cher Nalorgne, je vais vous lire le courrier.
Ce courrier n’était composé que d’une lettre assez courte même, mais dont la voix de Pérouzin souligna, détailla tous les passages :
Messieurs,
Je ne suis pas connu de vous, mais cependant, sur les bons rapports qui me sont faits relativement à votre agence, je ne doute pas que nous puissions arriver à nous entendre.
On m’a dit que vous vous occupiez de mariages riches.
Je suis célibataire, j’ai cinquante ans et je serais très bien conservé pour mon âge, si récemment un accident fâcheux n’avait occasionné une paralysie presque complète des deux jambes. Mon infirmité, toutefois, n’altérant en rien mes traits et étant largement compensée par ma fortune, (j’ai près de dix mille francs de rente), je songe à me marier. Connaissez-vous quelque jeune fille, quelque employée, jolie, jeune, de caractère doux et aimant, susceptible de comprendre que l’affection d’un homme de mon âge vaut mieux que les folles ardeurs d’un godelureau ? Si vous connaissez une jeune fille répondant à ces conditions, je serais heureux de vous parler quelques instants. Peut-être pourrions-nous alors organiser une rencontre.
J’attends l’honneur et le plaisir de vous lire, et vous prie de me croire
Votre respectueusement dévoué
Louis Ronier,
rentier à Saint-Germain.
– C’est même encore une grosse affaire, car nous pourrions demander une commission importante. Mais voyez-vous, Nalorgne, dans nos relations, une jeune fille susceptible de plaire à ce monsieur ?
Nalorgne allait répondre, lorsque, pour la seconde fois de la matinée, la sonnette tinta :
– Je vous parie que c’est encore un client.
– Hum, c’est bien improbable.
Ils coururent en même temps, cette fois à la porte, et demeurèrent ravis en apercevant une toute jeune fille debout sur le palier, et semblant fort émue.
– Vous demandez, Mademoiselle ?
– L’étude de MM. Nalorgne et Pérouzin.
– C’est bien ici, Mademoiselle. Entrez donc.
Précédant la visiteuse, Nalorgne l’introduisit, puis se présenta :
– Je suis M. Nalorgne et voici mon associé, M. Pérouzin. Vous êtes ici dans notre cabinet, Mademoiselle. Parlez sans crainte. Qu’est-ce qui vous amène à notre porte ?
– Mon Dieu, Messieurs, commençait la jeune fille, je viens vous trouver pour une affaire importante.
– Eh bien, Mademoiselle, de quelle affaire s’agit-il ?
– Du vol qui s’est produit dans le bureau de mon patron, M. Hervé Martel, et la suite.
Déjà Pérouzin avait bondi.
– Nalorgne, c’est le dossier 1738, hein ?
– Voyez au répertoire, mon cher ami, je ne me rappelle plus trop.
– Il n’est peut-être pas nécessaire de retrouver le dossier, je venais simplement vous demander si vous aviez du nouveau. Vous continuez les recherches, n’est-ce pas ?
– Voyez plutôt.
Triomphalement, Nalorgne exhibait un énorme dossier bourré de documents :
– Voyez plutôt. Malheureusement, nous n’avons rien de nouveau. Vous n’aviez que cela à nous demander. Mademoiselle ? C’est dommage. Vous ne désirez pas, par exemple, que nous nous occupions de votre mariage ?
– Je ne désire pas me marier, Monsieur. Mais j’aurais peut-être à vous demander aide et conseils. Vous vous chargez de rechercher les personnes, n’est-ce pas ?
– Parfaitement. Vous désirez retrouver ?
– Je serais heureuse d’avoir l’adresse d’un journaliste rédacteur à La Capitale. M. Jérôme Fandor.
***
Pour la troisième fois la sonnette tinta.
– Bigre, murmura Pérouzin, encore un client ?
Pérouzin se trompait. Un homme lui tendait un papier :
– Le terme, fit-il, deux cent soixante quinze francs, messieurs.
– Oh, ce n’est pas la peine, ne vous dérangez pas, faites une fiche, on passera payer cet après-midi à la banque.
– Ah bon.
Leurs réflexions devenaient sombres, lorsque quelques instants plus tard, par la porte qu’ils n’avaient point refermée, un second garçon de recette, qui n’était autre que Prosper, se glissait dans le cabinet de travail.
Prosper, joyeux comme un pinson, se jeta dans un grand fauteuil, brandit triomphalement sa sacoche, éclata de rire, envoya une claque amicale sur le ventre de Pérouzin :
– Hé, bon sang, rigolez donc, les enfants, c’est de la bonne ouvrage que je viens de faire. Ah, mince alors, comment que je me suis amusé. C’est quatre fafiots que je viens de lever.
– Quatre cents francs ? demanda Nalorgne.
– Jamais de la vie, petit père, je ne travaille pas dans ces prix-là, moi. C’est quatre mille balles que je rapporte, et, vous savez, il n’y a pas de surprise, avec moi. Moitié, moitié, que je vous ai dit. Voilà les quatre mille francs. Deux mille pour moi, deux mille pour vous.
Sous les yeux éblouis de Nalorgne et Pérouzin, Prosper tira de sa sacoche quatre beaux billets bleus :
– Non, voyez-vous, déclarait-il, c’est une mine, que mon procédé ; rien à craindre, pas de frais généraux et de la galette tant qu’on en veut. Ah, on va se la couler douce, tous les trois.
– Enfin, Prosper, expliquez-nous donc un peu votre profession ?
– Que je vous l’explique ? répétait le cocher, eh bien, vous en avez de bonnes, j’croyais que vous l’aviez devinée. Allons, les poteaux, ouvrez les oreilles. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit, n’est-ce pas, chaque mois, de tâcher de me savoir, c’est facile, dans votre métier, l’adresse de maisons de commerce qui ont de gros encaissements à faire, et le nom des gens qui doivent leur payer cet argent. Bon. Quand vous m’avez fourni ce renseignement, je m’arrange à me faire faire par un imprimeur une facture du modèle de celui qu’emploie la maison qui a l’argent à toucher. C’est pas malin, et puis, dame, après, ça va tout seul. Tenez, aujourd’hui 30, je savais que la maison Guinon devait payer quatre mille balles à la maison Miller et Moller. Vous m’avez procuré une facture de la maison Miller et Moller. Bon, à neuf heures du matin, raide comme balle, juste à l’ouverture des bureaux, j’étais chez Guinon. « Monsieur le caissier, que je leur ai dit, c’est pour un reçu Miller et Moller de quatre mille balles. Le payez-vous ? » – « Attendez, qu’il m’a dit, je vais voir si j’ai ça de marqué sur mon échéance. » Il a regardé. Naturellement, c’était marqué, et comme ma facture paraissait bonne, que de plus je suis revêtu d’un habit de garçon de recette, il m’a versé les quatre mille balles sans douleurs. Et allez donc. Comme je me présente le premier, il n’y a jamais de difficultés. C’est rond comme une galette, mon truc. Il n’y a qu’à se laisser faire. Celui qui se fait engueuler, c’est même pas moi, c’est le vrai garçon de recette, celui qui arrive avec la vraie traite, et qu’on prend pour un voleur. Ah, va te faire fiche, moi, j’suis loin.
Prosper se leva, tapa derechef sur le ventre de Pérouzin :
– C’est compris ? eh bien, mes petits enfants, je vous le répète, vous êtes des copains, des poteaux, j’vous propose la combine. Moitié, moitié, vous me fournissez des adresses, des renseignements. Comme vous écrivez mieux que moi, vous m’aidez à faire les traites, à imiter les signatures. En échange, je vous donne la moitié de mes bénéfices. Ah, au fait, en raison de notre première affaire, rendez-vous ce soir à huit heures et demie ici, ça va ? ça colle ? On croûte ensemble ?
Déjà le joyeux Prosper était parti.
– Évidemment, commença Pérouzin, évidemment, ce qu’il fait n’est pas honnête, et notre devoir…
– Oui, notre devoir nous oblige à le faire arrêter… Vous allez chez le commissaire, alors, Pérouzin ?
– Non, c’est vous qui y allez.
– Allons-y ensemble, voulez-vous ?
Ils avaient le chapeau sur la tête, le parapluie en main, quand, soudain, Nalorgne, timidement, remarquait :
– Il y a la banque aussi où il faut passer. La banque pour payer notre loyer.
– J’y songeais.
D’un commun accord, sans se consulter, les deux associés s’assirent. Puis, Nalorgne remarqua :
– Savez-vous, Pérouzin, que je me demande une bonne chose ? Nous avons peut-être tort de dénoncer Prosper en ce moment. Il serait peut-être plus sage d’attendre encore quelques jours, plus nous serons armés et mieux nous pourrons le confondre.
Deux heures plus tard, l’arrestation de Prosper était bien décidée en principe, mais rien n’annonçait qu’elle fût imminente. Ni Pérouzin, ni Nalorgne ne s’étaient rendus au commissariat de police, mais le loyer du « contentieux » était payé.
À sept heures et demie, les deux associés, brossés, lustrés, pommadés, attendaient, assis dans leurs deux fauteuils directoriaux, leur ami Prosper qui devait venir les prendre.
La sonnette retentit.
– C’est Prosper, hein ?
Non, ce n’était pas Prosper, mais une femme en grande toilette, couverte de bijoux :
– Madame Irma de Steinkerque, expliquait déjà Pérouzin qui était allé lui ouvrir, c’est paraît-il, l’amie, la très bonne amie de Prosper et elle a rendez-vous avec lui chez nous.
Pour le coup, la confusion de Nalorgne fut sans limite.
Comment, la belle M me Irma de Steinkerque était la maîtresse de l’ancien cocher ? Devait-il en gagner de l’argent, ce cocher.
– Madame, commença-t-il, nous sommes, mon associé et moi, très heureux, très flattés, infiniment touchés de vous recevoir. Mais, Prosper ne dîne-t-il pas avec vous ?
Irma, elle, en bonne fille qu’elle était, ne se perdit pas en phrases de cérémonie :
– Ça, c’est rigolo, Prosper m’a téléphoné cet après-midi : « Va m’attendre chez mes copains, rue Saint-Marc. » Mince alors. Si je me suis doutée que ces copains-là, c’était vous, vous, les deux louftingues qui vous trouviez l’autre jour en déguisés chez Martel, je veux bien être pendue la tête en bas.
– Asseyez-vous donc, madame, chère madame. Sur ce fauteuil. Tenez vous serez mieux.
En même temps, Pérouzin bourrait de coups de coude son associé :
– Allez dans la cuisine.
Nalorgne l’y rejoignit quelques instants plus tard, il y était rejoint par Pérouzin, très pâle :
– Je lui ai demandé deux minutes pour aller signer le courrier, expliqua Pérouzin. Elle est fichtrement belle, qu’en dites-vous ? Elle est si belle que je pardonne presque à Prosper d’être devenu une crapule si c’est pour l’entretenir. Au fait, Nalorgne, est-ce ce soir, comme nous l’avions décidé, ce soir après dîner, que nous allons faire arrêter Prosper ?
– Jamais de la vie. Nous ne pouvons pas faire ça du moment que sa maîtresse est là. Ça ne serait pas délicat.
– Et puis il y a l’argent, l’argent que nous avons emprunté sur les deux mille francs qu’il nous a remis.
– Et puis, il faut que nous devenions tout à fait les amis de Prosper et de sa maîtresse.
Es en étaient là, lorsqu’un éclat de rire éclata dans la cuisine.
– Ah, ce que vous êtes farces tous les deux, à discuter dans votre cuisine, non, quoi, qu’est-ce que vous faites ? j’m’embête, moi, toute seule.
Irma s’était levée, les avait rejoints à pas de loup :
– Chère madame, protesta Nalorgne au hasard, nous sommes désolés, nous venions voir si notre cuisinière était encore là pour lui commander une tasse de thé pour vous, mais justement…
– Hé, lui répondit Irma avec une parfaite simplicité, vous bilez donc pas. Je ne suis pas une petite évaporée, moi. Le thé, j’trouve que c’est de l’eau chaude, et voilà tout. Et puis, Prosper m’a bien dit que vous étiez des copains, et pas des mecs à la pose. N’vous bilez pas qu’j’vous dis, c’est plus l’heure du thé, d’abord, c’est l’heure de l’apéro. Tiens, justement, voilà Prosper !
5 – CENT MILLE FRANCS DE MOINS
Le repas fut expédié.
« Viens déjeuner avec moi », avait écrit Hervé Martel à Maurice de Cheviron. Mais les deux hommes étaient pressés l’un et l’autre.
Comme on servait le café, un café bouillant qui refusait de se laisser boire, Cheviron tirant une cigarette de sa poche, entreprit son ami :
– Dis donc, mon vieux, sais-tu que c’est très gentil chez toi. Sans avoir l’air d’y toucher, petit à petit tu as transformé ton appartement. Une véritable bonbonnière. Des toiles de maîtres, des bronzes signés, peste, tu te mets bien.
– Pourquoi veux-tu que je me prive ?
– Je ne veux pas que tu te prives du tout, mais enfin, je t’admire. Tu vis sur un pied qui en dit long. Quand on a une automobile à la porte, une trente-cinq chevaux.
– Quarante, mon vieux.
– Mazette. On sait ce que cela coûte. Bref, on parle toujours des agents de change et des scandaleuses fortunes qu’ils font, je commence à croire que le courtage maritime est une opération encore plus lucrative.
– Il est certain que je ne me plains pas. Sans gagner, comme tu parais le croire, des sommes énormes, je suis content. Le courtage maritime comme tu le dis, grâce au privilège qui réserve les opérations à sept ou huit intéressés, rapporte. Mais que de mal on se donne.
– Est-ce que, par hasard, ton métier n’est pas au contraire un métier de tout repos, un métier de père de famille ?
– Hé non, mon vieux, il faut avoir les reins solides, l’esprit décidé, trois sous d’audace, et quatre sous de culot, je t’assure, pour faire ce que je fais.
– Allons donc. Tu touches des commissions sur chaque affaire que tu apportes aux assurances, tu te réserves un prélèvement. Il n’y a aucun risque à courir.
– Tu te trompes, Maurice, tu te trompes lourdement, expliquait-il. Si, en réalité, je ne m’occupais véritablement que d’apporter des affaires aux compagnies d’assurances et de prélever une commission, tu aurais raison, je ne courrais aucun risque, mais je gagnerais beaucoup moins qu’en osant les petites spéculations et même les grosses spéculations.
– Tu joues ? toi, Hervé Martel, l’homme sérieux par excellence ? tu joues ?
– Hé oui, je joue. D’une façon particulière, mais enfin je joue. Tiens, veux-tu savoir comment ? C’est excessivement simple, et tu comprendras que c’est tentant. Hier, mon vieux Maurice, figure-toi que j’ai reçu la visite d’un gros banquier qui fait venir, pour le compte d’une maison allemande, plusieurs millions d’or monnayé, envoyés d’Amérique en Autriche. Ces millions d’or vont être apportés à Cherbourg par un paquebot anglais, le Triumph, et mon homme me venait voir pour me demander de les assurer contre les risques de mer.








