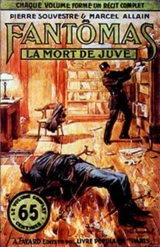
Текст книги "La mort de Juve (Смерть Жюва)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Quelques instants plus tard, les deux inspecteurs étaient introduits dans le cabinet, recevant des mains de M. Langlois la lettre de Fantômas, et le magistrat priait Nalorgne d’en prendre connaissance.
Nerveux, tenant toujours sa propre lettre, sa lettre si mystérieusement devenue blanche, Fandor guetta la physionomie des deux agents.
– Nous allons rire, pensait le journaliste. À la rigueur, j’admets que Fantômas ait voulu se débarrasser de moi, qu’il ait truqué sa lettre m’innocentant, qu’il m’ait indignement trompé, mais j’imagine que s’il a pris soin de m’annoncer que Nalorgne et Pérouzin étaient des agents à lui, des misérables devenus ses complices, c’est que c’est bien là une réalité. Donc il veut s’en venger, donc il a dû les accuser dans cette lettre, donc je vais assister à leur confusion. Ce sera toujours ça de pris.
Mais il était écrit que Fandor irait de stupéfactions en stupéfactions. Nalorgne se décidait enfin à rompre l’enveloppe. Il en tirait une lettre. Une lettre écrite très lisiblement, mais à peine Nalorgne avait-il jeté les yeux sur cette lettre qu’il parut plongé dans une stupéfaction profonde.
Lui aussi s’exclamait comme, quelques instants avant, s’était exclamé Fandor.
– Mais je ne comprends rien du tout à ce que cela signifie ? déclara l’agent de la Sûreté, c’est du chinois, de l’arabe.
– Comprenez-vous ce document ? demanda le juge.
– Non, dit Fandor, pas du tout.
La lettre adressée à Nalorgne et à Pérouzin, était en réalité composée d’une série de mots sans suite. Cette fois Fandor en demeura muet. Autour de lui tout dansait, tout tournait, dans une sarabande effroyable : le juge d’instruction, Nalorgne, Pérouzin, le greffier, les deux gardes, le mobilier du cabinet, tout valsait dans l’esprit de Fandor. Le jeune homme tituba, fut sur le point de s’écrouler : un garde le soutint.
– Évidemment, concluait, avec une netteté tranchante le digne M. Langlois, évidemment, c’est très intéressant, très significatif, Monsieur Fandor. Vous avez voulu vous moquer de la Justice et pour moi, la preuve de votre culpabilité est largement faite par les mensonges saugrenus que vous aviez imaginés au sujet de ces deux lettres qui, disiez-vous, devaient vous innocenter. L’une est incompréhensible, l’autre est blanche, en conséquence…
Fandor, comme un fou, s’était levé. Il échappait à ses gardiens, il bondissait vers le juge d’instruction terrifié, il lui fourrait la lettre sous le nez avec une autorité qui n’admettait pas de réplique :
– Sentez : il est impossible que vous ne sentiez pas.
M. Langlois n’osait dire ni oui ni non. La mimique de Fandor l’affolait. Il savait que contrarier les fous est ce qu’il y a de plus dangereux au monde, aussi s’en garda-t-il soigneusement. Il huma, pour lui faire plaisir, le papier que Fandor lui mettait sous le nez.
Or, brusquement, comme il respirait ainsi, M. Langlois à nouveau écarquillait les yeux.
– Vous sentez, hein ? répétait Fandor.
– Oui.
– Et qu’est-ce que vous sentez, nom d’un chien ?
– L’oignon.
– L’oignon, je ne vous l’ai pas fait dire.
– Et quelle conclusion en tirez-vous ?
Alors Fandor s’emporta :
– Je comprends tout. L’aventure est limpide ! Parbleu oui, j’ai été joué par Fantômas, c’est bien à l’encre véritable qu’il écrivait, seulement, en même temps, il passait un morceau d’oignon sur les lignes qu’il venait de tracer. C’est un procédé connu, un procédé classique. Quand l’opération est faite habilement, quand l’oignon présente certaines qualités, il mange l’encre. Petit à petit il n’en reste plus trace. Ah, l’animal. Je comprends maintenant pourquoi il tenait à ce que la lettre ne m’arrivât que dans trois jours, il voulait laisser à la chimie le temps d’agir.
– Ce que vous dites est possible, mais rien ne le prouve. Cette lettre sent l’oignon, je le reconnais, l’oignon peut faire disparaître des traces d’écriture, mais, et voilà le point essentiel, il n’en reste pas moins que vous avez menti. Vous prétendiez que Fantômas avait écrit sous votre dictée, il n’a pas écrit sous votre dictée car alors vous l’auriez vu passer un morceau d’oignon.
– C’est absurde. Parbleu oui, il a passé de l’oignon sur sa lettre, mais il l’a passé subrepticement. Comment ? je ne le sais pas. Il peut y avoir vingt moyens. Je me rappelle, tenez, qu’il avait des manchettes fort longues et des boutons de manchettes volumineux. Ces boutons de manchettes étaient peut-être constitués par des oignons artistement truqués.
M. Langlois tendit un papier à Nalorgne et à Pérouzin.
– Ce que dit l’inculpé, déclarait le magistrat, n’a aucune vraisemblance et l’on peut en conséquence tenir ses déclarations pour non avenues. De tout ceci, il n’y a qu’une chose à retenir : le sieur Jérôme Fandor, arrêté sur l’ordre de Juve, a affirmé que son innocence éclaterait quand il arriverait deux lettres. L’une de ces lettres est blanche, l’autre est incompréhensible. Je clos mon instruction sur ce fait. Messieurs Nalorgne et Pérouzin, voici un mandat qui vous enjoint d’accompagner le sieur Jérôme Fandor à Paris, où je le renvoie devant le juge d’instruction déjà saisi des affaires de l’avenue Niel. Je vous recommande tout spécialement de faire grande attention au prévenu pendant le voyage, je vais d’ailleurs donner des ordres pour qu’on vous réserve un wagon spécial dans le train.
– Fichu, se disait le journaliste, je suis fichu.
24 – PRIS AU PIÈGE
Nalorgne, l’air rogue et hautain, s’était tourné vers Fandor, et l’avait averti :
– La dépêche que l’on vient de nous remettre, nous prévient que, par crainte de manifestations, la Sûreté a envoyé un taximètre nous attendre à Clamart. Notre train y stoppera une minute, pour nous permettre de descendre, tâchez de ne pas rouspéter et de vous dépêcher.
Fandor, de la tête, avait fait oui. Rouspéter ? Il n’y songeait guère, le malheureux journaliste, car, à la vérité il était rompu de fatigue, brisé d’émotions, incapable, croyait-il, du moindre acte d’énergie. Depuis Cherbourg, Nalorgne et Pérouzin avaient usé à son endroit de rigueurs pour le moins inutiles. Non seulement, ils n’avaient pas permis à leur prisonnier de descendre une seconde de wagon, mais encore ils lui avaient laissé les menottes.
Fandor, toutefois, était trop philosophe pour laisser paraître son ennui, sa colère ou sa rage, dès lors qu’il prévoyait que ses gardiens en concevraient une satisfaction qu’il n’avait nul désir de leur donner.
– Ces gaillards-là, se répétait Fandor, se payent ma tête de bonne manière. Ils doivent exulter à l’idée qu’ils m’ont arrêté, qu’ils sont chargés de me livrer à la justice. Je ne vais pas, en leur montrant mon embêtement, augmenter leur satisfaction personnelle.
Toutefois, Fandor avait beau faire, il ne réussissait pas à amener un sourire joyeux sur ses lèvres. D’abord il était vexé, ensuite il était inquiet. De plus, il comprenait à merveille ce qu’avait voulu Fantômas. Fantômas, dans le château désert de Saint-Martin, s’était parfaitement rendu compte qu’il avait beaucoup plus d’intérêt à ne pas tuer Fandor, pour le faire considérer comme l’auteur de tous les crimes dont lui-même était responsable. Fantômas s’était moqué du journaliste. Lentement, docilement, il avait écrit sous sa dictée la lettre que Fandor avait préparée pour faire éclater son innocence mais, en même temps, il s’était arrangé pour utiliser le procédé de l’oignon qui l’avait assuré que la lettre ne produirait aucun effet. Cela était déjà bien. Ce qu’il y avait de mieux, c’était les instructions données à Nalorgne et Pérouzin où le juge n’avait vu que du feu.
– Je suis, pensait Fandor, exactement dans la situation d’un monsieur qui tombe du quatrième étage. Tant qu’il tombe, tant qu’il est dans le vide, le mal n’est pas grand. Seulement il se dit en lui-même : pourvu que cela dure. C’est ainsi que, depuis Cherbourg, Nalorgne et Pérouzin m’ont empoigné dans leurs mains délicates. Je n’ai, somme toute, pas trop à me plaindre. Mais pourvu que cela dure, pourvu qu’avant la Tour de l’Horloge où je vais très vraisemblablement coucher ce soir, il ne survienne rien.
Car en réalité, ce que Fandor redoutait, c’était tout bonnement une attaque de Nalorgne, et de Pérouzin. Les mains prises dans ses menottes, Fandor se rendait parfaitement compte qu’il était à peu près hors d’état de se défendre contre les deux bandits qui le gardaient, si fantaisie leur prenait de se débarrasser de lui.
– Que voulait dire la dépêche remise à Nalorgne et à Pérouzin lors de l’arrêt du rapide à Dreux ?
On l’avait averti, sans doute, qu’il s’agissait tout simplement d’un ordre d’avoir à débarquer à Clamart pour éviter toute manifestation, mais était-ce vraisemblable ?…
Certes, Fandor n’ignorait pas que, lorsque la Sûreté fait voyager des criminels importants, il arrive souvent qu’au lieu de les laisser aller jusqu’aux gares terminus : Saint-Lazare, Gare du Nord, P.-L.-M. ou gare Montparnasse, on prend la précaution de les faire descendre dans les petites stations de la banlieue d’où ils sont conduits directement en voiture au Dépôt.
On évite de la sorte des mouvements d’opinion à Paris, on évite de regrettables incidents, des scandales issus de l’émotion populaire.
Mais était-il bien dans le cas d’une semblable mesure ?
– Que diable, se disait Fandor, à moins de me tromper étrangement, il me semble que je ne suis pas un assez gros personnage pour que le bon peuple de Paris soit tenté de prendre parti pour moi. Cela doit même lui être profondément indifférent, au bon peuple de Paris, à supposer qu’il le sache, qu’on me ramène entre deux argousins. Et dans ce cas, pourquoi prend-on la peine de faire arrêter le rapide à Clamart et de m’y faire descendre ?
« Crédibisèque, se disait encore le journaliste, est-ce que, par hasard, il n’y aurait pas là un effet de la volonté de Fantômas ? Je suis arrêté, arrêté par des agents qui sont des agents de la Sûreté, c’est entendu, mais je ne dois pas oublier non plus que ce sont en réalité les complices du bandit. Par conséquent, est-il bien réel qu’ils vont me livrer à la Sûreté, ou au contraire, vont-ils me remettre aux mains de Fantômas ?
– Avancez, ordonnèrent les deux inspecteurs, et tâchez de marcher droit. Au premier signe, au premier geste, nous tirons.
– Ça va, ne vous faites pas de mauvais sang, j’y pense à vos revolvers, j’y pense souvent, j’y pense toujours, j’y pense encore.
Mais déjà, le train était reparti à toute allure et les deux agents encadraient leur prisonnier, et après avoir donné leur permis de circulation au chef de gare, poussaient le journaliste vers la cour de la petite station.
– Nalorgne, commençait Pérouzin, qui venait de déboucher le premier hors de la salle d’attente, je ne vois pas du tout le fiacre que devait nous envoyer la Sûreté. J’avais bien dit que ce voyage finirait mal. Qu’allons-nous faire ?
– C’est bizarre, répondit simplement Nalorgne.
– Pourtant, la phrase de la lettre était très claire ; nous ne pouvions pas nous y tromper.
Pérouzin s’interrompit brusquement. Nalorgne, d’un coup d’œil, venait de le rappeler au silence. Mais Nalorgne avait fait son signe trop tard. Jérôme Fandor avait entendu.
– Ah, la phrase de la lettre est claire, songeait le journaliste, la phrase de la lettre de Fantômas. Allons, je ne me suis pas trompé, mes aventures ne sont pas finies. Et si je couche quelque part, ce ne sera certainement pas au Dépôt.
Il fallait prendre un parti, cependant. Il était huit heures du soir et la petite gare déserte, mal éclairée par les lumières clignotantes de quelques becs de gaz, était peu hospitalière. Nalorgne et Pérouzin échangeaient des regards navrés :
– C’est très ennuyeux, reprenait Pérouzin, très ennuyeux que la voiture ne soit pas là.
– Avançons, nous trouverons peut-être dans le pays un véhicule qui voudra bien nous conduire où nous allons.
– Oui, mais le cocher ?
– Taisez-vous donc, Pérouzin.
– Bien, songeait le journaliste, si Pérouzin estime que le cocher, le cocher d’un véhicule quelconque, peut être gênant, c’est évidemment que le cocher qui devait nous conduire, n’était pas un cocher ordinaire.
Fandor cependant était pris par les deux agents, qui sans cérémonie, le tenaient chacun par un bras.
– Avancez, ordonnait Nalorgne.
– Marchez, répétait Pérouzin.
– Après vous, messeigneurs, répondait Fandor. Il faut être logique tout de même, vous m’avez dit de ne pas m’écarter d’un pas, emmenez-moi où vous voudrez, je suis.
Fandor, à ce moment, se sciait littéralement les deux mains à vouloir les arracher de l’étreinte des menottes.
– Quel imbécile d’instrument, se déclarait-il à lui-même en constatant l’inutilité de ses efforts. Quand je pense qu’à la fête de Montmartre, trois fois par an, il y a des individus qui, pour deux sous, se débarrassent des cordes les plus savamment nouées, des menottes les plus perfectionnées, et que moi, je ne suis pas fichu d’en faire autant. Je me rends compte que mon éducation a été bien négligée.
– Ah, tout de même, voilà la voiture.
Ils étaient sortis tous les trois de la cour de la gare, et ils apercevaient, rangé contre le trottoir, à quelque distance, le long d’un terrain vague un taxi-auto qui leur tournait le dos :
Les deux agents hâtaient le pas, entraînaient Fandor jusqu’à la hauteur du taxi-auto. Il avait le drapeau levé la voiture était libre, mais on ne voyait pas le chauffeur.
Pour le coup, Nalorgne s’emporta.
– Je parie qu’il a été boire. Ah sapristi !
Pérouzin cependant appelait à tous les échos :
– Mécano, mécano, le mécanicien du taxi-auto !
– Eh ben, quoi, me voilà, c’est pas la peine de faire tant de potin, les bourgeois, montez dans la bagnole, j’en ai pour deux minutes de réparation.
Le conducteur du taxi-auto était tout bonnement étendu sous sa voiture, invisible. Nalorgne se pencha :
– Ah vous êtes là ? C’est vous, Pros…
Mais le nom qu’il allait dire, le nom que Fandor guettait, Nalorgne ne le prononça pas.
Il se redressa rapidement, il ouvrit la portière du véhicule, y poussa Fandor :
– Embarquez et rapidement, ou sans ça…
La gueule d’un revolver brilla dans l’obscurité, Fandor haussa les épaules, monta.
– C’était Prosper qu’ils attendaient, se disait Fandor et ce n’est pas Prosper qui est là. Est-ce un complice ou un honnête conducteur de taxi-auto ?
Fandor n’eut guère le temps de réfléchir plus avant. Nalorgne venait de souffler quelque chose à l’oreille de Pérouzin, et celui-ci après avoir grimpé à son tour dans le fiacre, s’asseyait à côté de Fandor, refermait la portière.
Nalorgne disait tranquillement au chauffeur :
– Dépêchez-vous, mon ami, nous sommes des agents de la Sûreté, et vous avez pu voir que l’individu que nous emmenons porte des menottes. C’est un criminel dangereux. Il s’agit de ne pas perdre de temps. Je vais monter à côté de vous sur le siège. Je vous indique le chemin.
Tandis que Fandor, tout yeux et tout oreilles, s’efforçait de saisir les moindres indices susceptibles de le renseigner sur la destination du taximètre, qui venait de démarrer, tandis qu’il se faisait cette réflexion que Nalorgne guidait le taxi-auto, non point dans la direction de Paris, mais vers les terrains déserts du Petit-Bicêtre, Pérouzin, à l’improviste, tirait son revolver et le braquait sur le jeune homme :
– Maintenant, avait-il dit, tâchez de comprendre, Fandor, si vous vous permettez de faire un geste, de dire un mot, d’essayer d’attirer l’attention, je vous brûle la cervelle. C’est l’ordre de Fantômas. Si au contraire vous êtes sage, et vous laissez mener là où nous vous conduisons, il ne vous sera fait aucun mal. Pour l’instant du moins.
Pérouzin, sans doute, s’attendait à quelque geste apeuré du journaliste, à ce que le prisonnier, au moins, manifestât une surprise. Ce fut lui, en réalité, qui demeura stupide sous le coup d’une stupéfaction sans bornes. En réponse à sa menace, Fandor avait éclaté de rire. Et Fandor riait, riait si fort, semblait s’amuser à un tel point qu’une peur subite s’emparait de Pérouzin.
– Mais que diable avez-vous ? demandait l’agent, qui pour mieux le regarder dans les yeux, s’avançait sur sa banquette, tournait le dos au siège sur lequel était assis Nalorgne et le conducteur.
Et alors dans la voiture il se déroula une scène étrange. À peine Pérouzin avait-il menacé Fandor de son revolver que, brusquement, le journaliste levait ses deux mains attachées par les menottes aux poignets, les passait avec une rapidité folle derrière la tête de Pérouzin pris ainsi dans une sorte de collier, et Fandor attirait l’agent sur sa poitrine, lui serrait la tête sur ses vêtements avec une force que décuplait la rage, il l’étouffait à moitié. Pérouzin, pris à l’improviste, laissait échapper son revolver sur lequel Fandor s’empressait de mettre le pied, puis le journaliste hurlait :
– C’est fait, Juve, vous pouvez arrêter.
Qu’est-ce que tout cela voulait donc dire ? Pourquoi avec une brusquerie soudaine le taxi-auto stoppait-il ? Pourquoi le conducteur sautait-il à bas de son siège cependant que Nalorgne demeurait lui, immobile sur ce même siège ? Le conducteur après avoir immobilisé son véhicule, avoir arrêté le moteur, – c’était visiblement un homme précautionneux —, courait à la portière voisine de Fandor. Il ouvrait cette portière, il avait dans ses mains, de longues courroies, en une seconde, il avait lié, de main de maître, les pieds de Pérouzin, en une seconde, il lui avait ligoté les bras :
– Tu peux lâcher, Fandor. La bête enragée est hors d’état de nuire.
Alors Fandor lâcha la tête du malheureux Pérouzin, tendit ses bras encore pris par les menottes au conducteur :
– Si ça ne vous fait rien, mon cher Juve, j’aurais un certain plaisir à ce que vous me débarrassiez de ces affaires-là. C’est incommode en diable.
Que s’était-il donc passé ?
***
– Mon petit Fandor, je suis content de te voir.
– Mon cher Juve, vous êtes la plus détestable rosse que j’aie jamais rencontrée.
– Vraiment ? et pourquoi cela ?
– D’abord, vous n’êtes pas paralytique.
– Tu me le reproches, Fandor ?
– J’en aurais presque envie. Quand je pense que depuis six mois, vous vous faites soigner, dorloter, plaindre, par tout le monde, alors que vous vous portez comme le Pont-Neuf.
– Je t’expliquerai.
– Ensuite, je vous en veux pour la façon dont vous m’avez fait arrêter.
– Je n’avais pas d’autres moyens, Fandor, pour te faire tenir tranquille.
– Possible, mais tout de même.
– Il n’y a pas de tout de même.
Depuis dix minutes, Jérôme Fandor était libre. Nalorgne, immobilisé par des poucettes, que Juve lui avait passées à l’improviste, tout en conduisant de l’autre main le taxi-auto, avait été transporté à l’intérieur de la voiture où il avait rejoint Pérouzin, atterré lui aussi. Et maintenant, Juve et Fandor, assis sur le siège, causaient, cependant que le véhicule expertement guidé par Fandor allait bon train.
– Juve, continuait le journaliste, je ne comprends rien du tout à ce qui se passe. D’abord, où me menez-vous ? Ensuite, comment êtes-vous là ? Enfin qu’allons-nous faire de Nalorgne et de Pérouzin ?
– Procédons par ordre. Dis-moi d’abord ce qui t’es arrivé depuis le moment où tu as si gentiment embarqué Pérouzin, et je te dirai ensuite…
En peu de mots, Jérôme Fandor fit le récit de ses propres aventures depuis le moment où Juve l’avait fait arrêter à Saint-Martin, jusqu’au moment où, en compagnie de Nalorgne et Pérouzin, il était arrivé à Clamart.
– Ma parole, continuait Fandor, quand nous avons aperçu votre taxi-auto, quand Nalorgne s’est penché en demandant : « C’est vous, Pros… ? » je n’aurais pas donné cher de ma vie, je me croyais bel et bien fichu.
– Et alors ?
– Et alors, bien entendu, je ne vous ai pas reconnu, mon bon Juve, car vous étiez sous votre voiture.
– Précisément pour que l’on ne me reconnaisse pas.
– Je suis donc monté docilement dans cette auto, et je m’attendais aux pires événements, lorsque j’ai vu votre main, votre main droite qui, avec ostentation, frappait contre la vitre. Donc, votre signe de la main a attiré mon attention sur la vitre du fiacre. J’y ai lu tout naturellement l’avis que vous aviez gravé :
T’inquiète pas, Fandor, c’est moi, Juve, qui mène ce taxi-auto, tâche d’immobiliser Pérouzin, je me charge de Nalorgne.
Je me suis acquitté de ma partie de concert. Pérouzin, qui ne s’attendait à rien, a très gentiment accepté de venir dans mes bras, et ma foi, c’est tout. Mais comment diable êtes-vous ici ?
Le taxi-auto filait toujours dans la nuit noire. De temps à autre, Juve, d’un signe de la main, indiquait à Fandor la direction qu’il importait de prendre, une direction bizarre qui rapprochait certainement le véhicule de Paris, mais qui, cependant, n’était pas le chemin le plus court pour gagner la Préfecture.
– Ah çà, faisait-il, vas-tu me reprocher d’avoir remplacé Prosper, car c’était Prosper qu’ils attendaient, sur la présence duquel ils comptaient, ces bandits. Aimerais-tu mieux…
– Ne plaisantez donc pas, Juve, vous devriez comprendre mon impatience. Je vous quitte paralytique, je vous retrouve agile comme un zèbre. J’arrive prisonnier et cinq minutes après je suis libre, il y a bien de quoi…
– Tu n’es pas libre du tout, faisait-il tranquillement, tu es toujours sous le coup d’un mandat d’arrêt, ne l’oublie pas, un mandat d’arrêt signé par moi-même.
– Sans doute, Juve, mais enfin ?
– Stoppe, ordonna le policier.
Comme Fandor hésitait, Juve répéta :
– Arrête-toi donc, animal, fais entrer notre taxi-auto dans ce terrain vague que tu aperçois là-bas. Je connais l’endroit, n’aie pas peur, notre voiture peut passer. Bon, maintenant, va te ranger près de la champignonnière.
Fandor, intrigué, obéissait aux ordres de Juve, conduisait le véhicule près du monticule que le policier lui désignait. L’endroit était sinistre à souhait, désert comme il n’est pas possible. Fandor n’avait pas immobilisé son véhicule, qu’il questionnait à nouveau Juve.
– Mais, bon Dieu de bon Dieu, que prétendez-vous donc faire ?
– Tu vas le voir.
Juve avait sauté du fiacre, il faisait signe à Fandor de venir l’aider. Juve ouvrait la portière du taxi-auto. Blêmes, livides, décomposés, ligotés au point de ne pouvoir faire un geste, bâillonnés à ne pouvoir dire un mot, Pérouzin et Nalorgne s’y trouvaient, croyant leur dernière heure venue.
Juve regarda les deux agents, rit, puis :
– Crois-tu, Fandor, que tu as une belle revanche ? Crois-tu qu’ils ont l’air malheureux ?
La remarque faite, Juve ordonnait :
– Prends-moi Nalorgne par les épaules, pendant que je me charge de Pérouzin. Ah, tu peux ramasser le revolver de Pérouzin, c’est le modèle de la Sûreté, il est excellent.
Fandor, de plus en plus interloqué, se demandait quelles pouvaient être les intentions de Juve. Le policier venait de charger Pérouzin sur ses épaules, avec la même indifférence qu’il eût apportée à transporter un colis.
– Prends donc Nalorgne, répétait Juve, tu n’as pas l’air de te douter que je suis horriblement pressé.
Fandor empoigna Nalorgne et suivit Juve. Le policier se dirigeait alors vers un puits d’aération communiquant avec une champignonnière. Un grand panier était là, suspendu à une corde servant évidemment à descendre les outils de travail nécessaires à la culture des champignons.
– Voilà un ascenseur parfait.
Et, en même temps, il jetait Pérouzin dans le panier.
– Dépose Nalorgne.
Et quand Fandor se fut exécuté, quand Nalorgne eut rejoint dans le grand panier son complice Pérouzin, Juve laissa filer la benne, la fit descendre au fond de la champignonnière.
– À notre tour, dit Juve. Il y a une échelle.
Quelques secondes plus tard Juve et Fandor tiraient Nalorgne et Pérouzin du panier qui avait servi à les descendre, les accolaient à la muraille.
Juve était toujours d’excellente humeur, il se frottait les mains, il riait :
– Et maintenant, mon petit Fandor, déclarait le policier, tu vas me faire le plaisir de prendre ce revolver en main, de t’asseoir dans cette cave, bien en face de ces gaillards-là, et de monter la garde devant eux, jusqu’à ce que je sois revenu te prendre. J’ai à faire.
Mais véritablement, Juve était par trop énigmatique. Il ne donnait pas à Fandor suffisamment d’explications. Le journaliste protesta violemment :
– Non, je ne marche pas. J’aimerais mieux leur rendre la liberté pour vous suivre et savoir ce que vous allez faire. Juve, des explications !
Juve éclata de rire :
– Qu’il soit fait suivant ta volonté. Tu te demandes, Fandor, comment je suis là ? Peuh, c’est excessivement simple. Parce qu’après avoir arrêté Fantômas…
Mais Juve n’en dit pas plus long. À peine avait-il articulé ces deux mots extraordinaires, « arrêté Fantômas », que Fandor avait bondi vers lui :
– Vous avez arrêté Fantômas ? c’est vrai ? vous ne vous moquez pas de moi ? Vous avez arrêté Fantômas ?
– Mais, sans doute. Il est en ce moment proprement ligoté et gentiment cloué au sol, dans un appartement que tu connais, rue Bonaparte.
– Chez vous, Juve ?
– Oui.
Et, du ton dont il aurait annoncé les choses les plus ordinaires, les événements les plus indifférents, Juve, sans souci de Nalorgne et de Pérouzin, qui cependant écoutaient ses paroles, raconta à Fandor les événements survenus depuis son arrestation.
– Mon petit, déclarait Juve, tu penses bien que si j’ai pris le moyen désespéré qu’était ton arrestation pour t’empêcher d’aller recevoir chez moi cet excellent Fantômas, c’est que j’avais l’intention d’être là moi-même au rendez-vous. J’en avais d’autant plus l’intention que, n’étant nullement paralytique, il me paraissait très opportun de profiter de la venue de Fantômas pour, une bonne fois, lui mettre la main au collet. Toi, tu étais lié par un scrupule d’honneur ; moi, je n’étais tenu par rien de semblable. D’ailleurs, entre parenthèses, tu m’avoueras, Fandor, que les scrupules d’honneur sont déplacés avec Fantômas. Tu allais tenir ta parole, toi. Lui ne tenait pas la sienne, puisque sa lettre était blanche. Enfin… Maintenant, Fandor, j’imagine que tu devines la suite. Fantômas, ligoté chez moi, m’avouait, avec une belle tranquillité d’âme, que si j’avais la victoire sur lui, il l’avait sur toi. Je le tenais à ma merci, mais toi, tu revenais accompagné de Nalorgne et Pérouzin qui, dans une lettre chiffrée, avaient reçu les instructions nécessaires pour t’assassiner proprement. Tu vois mon émotion, Fandor ?
– Mon bon Juve !
– Naturellement, je courais au plus pressé. J’abandonnais Fantômas chez moi, à la garde d’un sergent de ville que je faisais monter d’urgence, je téléphonais à la Sûreté, j’apprenais ainsi que Fantômas devait envoyer à Clamart un fiacre conduit par Prosper. Prosper a dû trahir en ne venant pas t’attendre. En tout cas, pour ma part, je me suis emparé d’un taxi-auto, parce que, de la sorte, je facilitais beaucoup la lutte que je prévoyais entre Nalorgne, Pérouzin et nous, puis je suis venu t’attendre. Tu sais le reste.
Tandis que Fandor, ému au plus haut point, semblait prêt à sauter au cou de Juve, tandis que Nalorgne et Pérouzin, épouvantés, s’attendaient d’une minute à l’autre à être proprement expédiés dans l’autre monde, Juve reprenait :
– Donc, voici, en ce moment, où nous en sommes ; toi, tu es sous le coup d’un mandat d’arrêt. Nalorgne et Pérouzin, eux, sont considérés comme d’honnêtes gens. Fantômas, enfin, est immobilisé chez moi, sous la garde d’un agent. Eh bien, mon petit Fandor, je crois que tout cet imbroglio va se dénouer rapidement. Moi, Juve, je vais rentrer d’urgence rue Bonaparte et conduire Fantômas au Dépôt. Fantômas, une fois arrêté, je me débrouille, ce ne sera pas très difficile, pour obtenir que mon mandat d’arrêt te concernant soit rapporté. D’autre part, j’obtiens deux mandats contre Nalorgne et Pérouzin. En possession de ces paperasses, je reviens naturellement te tirer de cette champignonnière, et…
Fandor ne laissa même pas à son ami le temps d’achever.
– Dépêchez-vous, Juve, supplia-t-il, dépêchez-vous. Si vous saviez comme j’ai hâte que vous soyez parti et revenu ? J’ai bien pour trois ou quatre heures à vous attendre, cela va me sembler terriblement long. Mais tout de même, Fantômas est arrêté. Ah, Juve. Juve, je crois que cette fois nous avons enfin débarrassé le monde du Maître de l’Effroi, du Roi de l’Épouvante.
Juve, qui remontait l’échelle de la champignonnière, répondait simplement :
– Je le crois aussi, Fandor. Je l’espère.
25 – LE CHÂTIMENT
– Imbécile, triple imbécile.
À peine Juve avait-il quitté en hâte son appartement de la rue Bonaparte, que cette exclamation retentissait, s’échappait de la bouche en furie de Fantômas, cependant que le monstre, réduit à l’impuissance et cloué sur le plancher comme une chouette le long d’un mur, s’efforçait en vain d’arracher les liens qui le retenaient et l’immobilisaient ainsi, le laissant à la merci de son adversaire.
– Imbécile, répéta Fantômas, en écumant de rage.
Ces injures s’adressaient à l’agent de police que Juve avant de s’en aller avait posté dans son cabinet de travail, revolver au point, avec l’ordre de briser les membres de Fantômas si d’aventure le bandit s’efforçait de vouloir s’échapper.
Impassible l’agent demeurait en face de Fantômas et considérait curieusement cette grande et superbe silhouette de tragédie et de crime désormais abattue, réduite à l’impuissance.
Fantômas, cependant, de son regard féroce, fixait le sergent de ville. Il reprit encore :
– Tu avais pourtant le revolver à la main.
– Oui, proféra enfin l’agent d’un ton énigmatique…
Fantômas poursuivit :
– Et ce revolver était chargé, il l’est encore.
– Oui.
– Eh bien ? eh bien ? continua Fantômas, dont la fureur augmentait sans cesse. Ne pouvais-tu pas tirer ? Il fallait le tuer quand il s’en allait, le tuer comme un chien. N’y as-tu point songé ?
L’agent eut un geste vague :
– Sans doute, fit-il, j’y ai bien songé, mais…
– Mais quoi ? grommela encore le captif…
L’agent, lentement, s’expliquait :
– Mais d’abord, j’aurais pu le manquer, et puis un coup de revolver, ça fait du bruit. On aurait pu l’entendre, quelqu’un peut-être serait venu.
– Mais peu importait, hurla Fantômas, puisque nous étions là tous les deux.
Cependant, peu à peu, l’agent reprenait de l’assurance et semblait s’accoutumer à Fantômas, bien convaincu désormais que le terrible bandit ne pouvait plus faire un mouvement. Le représentant de l’autorité reprenait :








