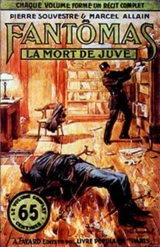
Текст книги "La mort de Juve (Смерть Жюва)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
– Tu peux être rassuré sur ce point. Dès qu’elle sera en état de voyager, nous la ferons transporter à Paris et elle s’installera dans une cellule confortable, au sein d’une maison, tout ce que l’on peut imaginer de plus tranquille.
– C’est à dire ?
– De l’hôpital de Cherbourg, Hélène sera transférée à Saint-Lazare.
– À la prison de Saint-Lazare ?
– Évidemment, Fandor. Ce n’est pas à l’Élysée que je la ferai conduire.
– Juve, vous ne ferez pas ça.
– Je te demande bien pardon, Fandor, je le ferai. D’ailleurs, j’en ai assez de cette famille.
– Juve, ayez pitié d’Hélène. Vous savez qu’elle n’a rien fait, qu’elle n’est pas coupable.
– Je n’en sais rien et peu importe, je la tiens, je la garde.
– Juve, craignez la vengeance de Fantômas ! Elle sera terrible. Et dans l’état où vous êtes actuellement…
– Crois-tu, petit, que la mort me fait peur et que la crainte de Fantômas puisse m’empêcher d’accomplir mon devoir ? Il n’aurait pas de pitié pour moi, sans doute, je le sais, peu importe. J’ai décidé d’agir et j’agirai comme je l’entends, quoi qu’il arrive. Entre Fantômas et moi, c’est la lutte sans merci, il ne saurait y avoir de compromis entre le monstre qu’il est et l’honnête homme que je suis.
– Justement, j’ai quelque chose, Juve, à vous demander, quelque chose qu’il faut m’accorder, me promettre. Dites que vous ne me contrarierez pas, que j’obtiendrai satisfaction.
– Hum, fit Juve, je n’aime pas beaucoup acheter chat en poche. Explique-toi d’abord.
Rassemblant son courage, Fandor raconta au policier les détails extraordinaires de l’effroyable lutte qu’il venait de vivre y compris la chute dans l’oubliette, la menace de mort affreuse dont il était l’objet et enfin sa libération par Fantômas, Fantômas qui, pour la première fois, tenait sa parole.
– Est-ce fini ?
– Non. J’ai rendez-vous, dans quatre jours, avec Fantômas, à cinq heures du soir, pour lui remettre les papiers d’Hélène.
– Où ?
– Dans votre appartement, rue Bonaparte, à Paris.
– Bien.
– Il est bien entendu avec Fantômas que la lutte reprendra sans trêve ni merci, à dater de l’instant même où je lui aurai restitué les papiers de sa fille.
– Restitué les papiers. Ah ça, Fandor, es-tu devenu complètement fou ?
– Pourquoi ?
– T’imagines-tu que je m’en vais te rendre ces documents pour que tu t’en ailles les porter à ce bandit et que nous perdions ainsi, bénévolement, le plus gros atout dans notre jeu, qui nous permet d’espérer gagner la partie ?
– Juve, j’ai donné ma parole d’honneur.
– On ne se déshonore pas, Fandor, en manquant de parole à Fantômas.
– Je vous demande bien pardon, Juve, du moment que j’ai engagé ma parole, peu importe à qui.
– D’accord, fit Juve, la parole donnée est une chose respectable, et j’estime, comme toi que l’on ne transige pas avec une telle promesse. Mais moi je n’ai rien promis du tout. Or, c’est moi qui possède les papiers.
Fandor, qui s’était levé et approché du lit de Juve, recula, désespéré, se laissa tomber sur un fauteuil.
– Juve, je vous en prie, rendez-vous compte de la situation dans laquelle je me trouve. Vous aviez, jusqu’à présent, le devoir de lutter contre Fantômas par tous les moyens, c’est possible. Mais à l’heure actuelle je suis redevable, moi, de quelque chose à Fantômas, et ce quelque chose, c’est ma vie, en échange de laquelle j’ai donné ma parole au bandit, il faut que je la tienne.
– Eh bien, tiens-la, Fandor. Tu es robuste, solide, libre de tes mouvements. Moi, je suis infirme, paralysé.
– Oh, Juve, supposez-vous un seul instant que je serais capable d’agir par la force.
– Il est des cas, fit-il, où on se demande quelle est l’attitude à observer la plus équitable. Tu as donné ta parole, Fandor, de livrer à Fantômas des documents que tu sais que je possède et que je refuse de te donner. Si tu veux les prendre, tenir ta promesse, tu sais qu’il te faudra user de violence.
– Et dans ces conditions ?
– Ce sera à mon tour de te répondre de la même façon.
– Juve, vous me mettez dans une situation inextricable.
– Écoute, Fandor, fit-il, laissons cela. Fantômas, m’as-tu dit, a écrit sous tes yeux une lettre dans laquelle il s’accuse de l’assassinat d’Hervé Martel, dans laquelle il se vante d’avoir voulu torpiller le sous-marin ?
– Il a écrit tout cela, je l’ai vu, de mes yeux vu.
– Donc, poursuivit le policier, de plus en plus énigmatique, cette lettre, lorsqu’elle parviendra à destination, c’est-à-dire lorsqu’elle te sera remise, non seulement t’innocentera, mais encore incriminera Fantômas ?
– C’est exact. Où voulez-vous en venir ?
– À ceci, Fandor.
Juve, péniblement, leva le bras et appuya trois fois sur un bouton de sonnette.
On frappait à la porte.
– Entrez, dit Juve.
Deux hommes entrèrent.
– Emparez-vous de lui, ordonna Juve.
Nalorgne et Pérouzin considérèrent Fandor stupéfaits, puis Pérouzin s’écria, tendant cordialement la main au journaliste :
– Mais au fait, c’est notre collègue de la police locale de Cherbourg. Comment allez-vous, cher monsieur ?
– De qui faut-il s’emparer ? Qui devons-nous mettre en état d’arrestation ? demanda Nalorgne.
– Je viens de vous le dire, hurlait déjà le paralytique, arrêtez cet homme, car c’est celui que vous recherchez, c’est l’individu inculpé des divers crimes pour lesquels M. Havard vous a envoyés ici. Vous cherchez Jérôme Fandor, n’est-il pas vrai ? eh bien, arrêtez-le, car cet homme ici présent n’est autre que Jérôme Fandor.
– Mais pardon, dit Nalorgne, l’individu dont nous avons le signalement et que nous connaissons d’ailleurs du nom de Jérôme Fandor ne ressemble pas du tout à Monsieur ? Jérôme Fandor est blond, il a une toute petite moustache, tandis que Monsieur est brun, très brun même.
– Imbécile, hurla Juve dont la lèvre écumait de rage, je vous dis que c’est Jérôme Fandor, je vous donne l’ordre de l’arrêter.
Depuis qu’il était à Saint-Martin, Juve s’était fait officiellement reconnaître par Nalorgne et Pérouzin, qui déjà, dans M. Ronier, avaient deviné le Roi des Policiers.
Nalorgne et Pérouzin, cependant, ne comprenaient pas, mais malgré eux, impressionnés par l’attitude du fameux inspecteur de la Sûreté, qu’ils savaient être si apprécié en haut lieu, ils se décidèrent à agir, d’autant que Fandor ne protestait pas, n’opposait aucune résistance.
Pour mettre sa conscience à l’aise, Nalorgne demanda une dernière fois à Juve :
– Alors, vous prenez la responsabilité de cette arrestation que vous ordonnez, monsieur Juve ?
– J’en prends la responsabilité.
Une seconde plus tard, Fandor avait les menottes.
– Où faut-il le conduire ? demanda Pérouzin.
– Immédiatement et sous bonne garde, dit Juve, à la prison de Cherbourg.
– Allez, en route, déclarèrent les deux hommes en posant leurs lourdes mains sur les épaules du journaliste.
Et celui-ci, qui jusqu’alors n’avait pas prononcé une parole, se demandant s’il n’était pas victime d’une hallucination, ne put s’empêcher de se tourner brusquement vers Juve :
– Enfin, Juve, pourquoi me faites-vous arrêter ?
– Il fallait, Fandor, pour t’empêcher de commettre le vol des papiers d’Hélène que t’ordonnait ton devoir, un cas de force majeure.
22 – FACE À FACE
– Jean ?
– Monsieur ?
– Jean, mon ami, vous allez sortir d’ici, sortir même très ostensiblement de la maison, vous irez ensuite… ma foi, je n’en sais rien. Ou plutôt si, je le sais, Jean, vous irez boulevard du Palais, vous entrerez au Café des Avocats, vous commanderez un bock, un apéritif à votre choix, puis, quand vous aurez fini de boire, vous recommencerez, mais au préalable vous aurez soin de dire à la caisse que si au téléphone on demande une personne nommée M. Jean, on vienne immédiatement vous chercher.
– Je ne comprends pas.
– Vous n’avez pas besoin de comprendre. Faites ce que je vous dis.
– Combien de temps faudra-t-il rester ?
– Jean, vous êtes décidément trop curieux. Quand vous aurez achevé votre verre, si le cœur vous en dit, prenez-en un autre, puis un troisième, en un mot, restez au café jusqu’à ce que vous ayez de mes nouvelles.
Le vieux Jean leva les bras au ciel.
– Monsieur est fou, murmura-t-il, de me faire sortir alors que nous venons à peine de rentrer, que depuis trois mois nous n’avons pas mis les pieds rue Bonaparte, qu’il y a un désordre de tous les diables dans l’appartement et une épaisse couche de poussière sur tout.
– Vous êtes un impertinent. Faites comme je vous dis. Toutefois, dès que je vous aurai téléphoné, vous vous précipiterez à la Sûreté et vous irez dire à M. Havard, de ma part : « Juve vient ». Non. Au fait, c’est inutile.
– Mais, qu’allez-vous devenir, monsieur Juve, pendant mon absence ? Il vous faudrait quelqu’un, si vous avez besoin de quelque chose ?
– Inutile, j’ai tout ce qu’il me faut, et d’ailleurs vous allez faire une chose. En partant, laissez la porte entrouverte.
– Pourquoi ?
– Parce qu’il est inutile que le visiteur que j’attends démolisse ma serrure. Allons, allons, Jean, dépêchez-vous, vous allez être en retard.
– En retard ? fit le domestique, je comprends de moins en moins.
– Moi, fit Juve, je sais qu’il est quatre heures et demie et que, par conséquent, j’éprouve dès maintenant un impérieux besoin d’être seul. Voulez-vous sortir, oui ou non ? Et n’oubliez surtout pas de sortir bien ostensiblement.
Seul désormais dans son appartement, étendu de tout son long sur le canapé-lit, Juve prêta l’oreille.
Soudain, il tressaillit. Un bruit. La porte communiquant avec son cabinet de travail, au milieu duquel il se trouvait, s’entrebâillait doucement. Juve tournait le dos à cette porte. Il devinait, mais ne pouvait apercevoir le visiteur.
Celui-ci s’approcha lentement. Son pas lourd fit craquer les lames du plancher. Juve ne broncha pas, ne fit pas un mouvement et ce fut simplement lorsque l’arrivant eut pénétré au milieu de la pièce, qu’il eut contourné le lit de Juve et se fut placé à son chevet, que le policier, le fixant les yeux dans les yeux, prononça le nom terrible :
– Fantômas.
Le bandit était sans cagoule, enveloppé dans un vaste manteau noir dont les plis flottaient autour de ses épaules et dérobaient à la vue les lignes robustes et souples de son corps.
Fantômas, cependant, prit enfin la parole :
– Vous connaissiez donc le rendez-vous ? demanda-t-il, vous saviez que j’allais venir à votre domicile ce soir à cinq heures ?
– Oui, fit Juve, je vous ferai toutefois remarquer que vous êtes en avance, car il est moins dix.
– Cela nous donnera plus de temps.
– Avons-nous quelque chose à nous dire ?
– Pourquoi pas ? Nous avons rarement l’occasion de nous rencontrer. Nous pouvons nous entendre. Vous tiendrez les promesses de votre ami Fandor, n’est-ce pas ?
– Nullement. J’ai fait arrêter Fandor pour qu’il ne puisse rien tenir. Je n’ai pas l’intention de vous donner ce qu’il vous a promis, ce que je lui ai refusé.
– Vous ne me remettrez pas les papiers d’Hélène ?
– Non.
– Écoutez, dit Fantômas, qui s’efforçait de demeurer calme malgré la colère qui grondait en lui, je crois que, dans la circonstance, vous êtes obligé de reconnaître que j’ai agi avec Fandor et avec vous comme un adversaire loyal. Souvenez-vous que j’ai épargné votre ami, Juve, alors qu’il était en mon pouvoir ?
– Vous l’avez épargné, Fantômas, parce que vous aimez votre fille et que vous n’avez pas osé tuer Fandor à cause d’elle. Vous avez eu peur d’Hélène, et voilà tout.
– Juve…
– Taisez-vous. Vous êtes un criminel, un monstre. Je ne discute pas avec des êtres de votre espèce.
– Vous êtes à ma merci.
– Possible, mais moi, Fantômas, je vous mets en état d’arrestation.
Le bandit éclata de rire.
– Vous riez, mais vous avez peur, Fantômas ! Peur d’être pris dans une souricière comme un rat, comme une bête malfaisante que vous êtes ! Rassurez-vous. Juve, lorsqu’il accepte un rendez-vous, ne se fait garder par personne. J’ai décidé de vous mettre en état d’arrestation, vous êtes seul ici et mon prisonnier.
– Votre prisonnier ? à la condition que vous me preniez ?
– Évidemment.
– Je puis vous tuer. Je vous tuerai dans un instant. Il me suffira d’un geste de mon index.
– En effet.
Fantômas braquait sur Juve le canon de son revolver.
– Et vous ne tremblez pas, Juve ?
– Depuis quand, Fantômas, vos menaces me font-elles peur ?
– Je vais vous tuer.
– Non, fit Juve, vous ne me tuerez pas. Vous avez besoin de savoir, auparavant, où se trouvent les papiers de votre fille.
– C’est vrai, vous me tenez encore.
– Vous voyez bien.
– Voyons, reprit le bandit d’un ton plus doux, êtes-vous disposé à me les rendre ?
– Jamais.
– Je les prendrai donc de force, gronda le bandit.
– Essayez.
– Où sont-ils ?
– Ils sont sur ma poitrine, venez donc les chercher.
De sa main gauche Fantômas, décidé à tout, écarta la chemise de Juve, et le bandit remarqua que le policier portait à même la peau, une ceinture à poches. Toutefois le bandit hésitait.
– Êtes-vous donc si poltron que vous n’osiez toucher le corps d’un paralytique ? Croyez-vous par hasard que cette ceinture contient quelque arme secrète ? Non, Fantômas, ne m’abaissez pas à votre niveau. Je ne suis pas de ceux qui, pour assassiner lâchement, emploient un chapeau-poignard. Je suis loyal, moi. Je vous dis simplement : Fantômas, prenez garde.
– Allons, allons, donnez-moi les papiers de ma fille.
– Prenez-les, Fantômas.
Le bandit, une seconde, hésita, puis résolument, lâchant son arme, qui tomba à terre avec un bruit sourd, il se précipita sur Juve, s’efforça de défaire la ceinture attachée autour de la poitrine de son adversaire.
Mais soudain un cri, un râle épouvantable. Fantômas lâcha prise. Ses deux bras s’écartèrent, son corps penché sur celui de Juve, se redressa brusquement, puis retomba en arrière. Plus vif que la pensée, Juve, au moment où Fantômas s’était penché sur lui l’avait pris à la gorge, serré des deux mains et le policier étranglait Fantômas. Juve le maintenait toujours, lui comprimant la gorge, jusqu’à ce qu’il perdît conscience.
– Enfin, enfin, ce moment tant souhaité est arrivé. Je vous tiens, Fantômas. Voilà six mois, six longs mois que je joue la comédie de la paralysie, que je me condamne devant tout le monde à l’immobilité absolue. Ah, vous avez été dupe comme les autres ? Vous avez cru que Juve était fini ? Réduit à rien ? à l’état de momie, de cadavre ? Pas encore, Fantômas. Et si j’ai la vigueur voulue pour vous maintenir, pour vous tenir ainsi terrassé, un genou sur la poitrine, et les doigts serrés autour de la gorge, c’est parce que, lorsque j’étais seul, j’ai suivi un entraînement minutieux, rigoureux. Je me suis fait des bras, des muscles, des biceps. Jugez-en plutôt.
Fantômas suffoqué, évanoui, à demi-mort, n’entendait rien. Juve, cependant, avec une agilité surprenante, ne se contenta pas d’avoir terrassé momentanément le bandit. Il prit les liens dissimulés sous son matelas, il attacha Fantômas, lui ligota les mains, les pieds, les bras, le ficelant à terre, rendant tout mouvement impossible, puis, satisfait, il regarda son œuvre.
Peu à peu, cependant, le bandit revenait à lui. Il respira profondément, ses paupières vacillèrent, puis, s’ouvrirent ses yeux injectés de sang regardèrent autour d’eux, ils eurent une expression affreuse en s’arrêtant sur Juve :
– Eh bien, Fantômas ? déclara celui-ci.
– Eh bien, déclara lentement le bandit, je m’avoue vaincu, vous aviez raison, Juve, en m’annonçant tout à l’heure que vous me mettiez en état d’arrestation, je suis pris, tuez-moi.
– Non pas, Fantômas, la mort rapide, instantanée, serait un châtiment trop doux. Je n’assassine pas, moi. Je ne tue pas. Nous avons des bourreaux pour cela. Mon rôle est de vous prendre. Mon devoir est de vous livrer à la justice.
Fantômas suivit des yeux le policier qui, traversant à grands pas la pièce, s’approchait du téléphone. Juve décrochait le récepteur. Toutefois, incapable de dominer sa joie :
– Un de mes hommes, mon vieux domestique, est actuellement à deux pas de la Sûreté. Je vais l’appeler. Il ira prévenir M. Havard. Dans dix minutes, je vous aurai remis aux mains des inspecteurs de police.
Machinalement, tout en parlant, Juve appuyait sur le balancier du téléphone, sans réponse.
– Allo, allo, fit-il deux ou trois fois, s’étonnant de ne point avoir entendu obtenir de la téléphoniste, répondre : « J’écoute. >
– Voulez-vous me permettre, Juve ?
– Que voulez-vous ?
– La téléphoniste ne répond pas ?
– Je ne comprends pas.
– Puis-je vous expliquer ?
– Ah bandit, les fils ?
– Je ne me serais pas permis de détériorer le matériel de l’État. Je sais trop à quels ennuis on s’expose. Et si la téléphoniste ne vous répond pas, Juve, c’est de votre faute.
– Vous croyez ?
– Voilà trois mois, Juve, que vous avez quitté votre appartement de la rue Bonaparte pour vous installer à Saint-Germain, dans une charmante villa. Vous avez omis de remplir une petite formalité qui pouvait avoir, qui a d’ailleurs, en ce moment, pour vous, les plus graves conséquences.
– Laquelle ?
– Mon Dieu, fit Fantômas, vous avez tout simplement oublié de payer votre abonnement au téléphone, et l’administration vous a « coupé » comme un vulgaire débiteur insolvable. J’ajoute, pour vous rassurer, que cet état de choses ne durera pas longtemps. Vous vous demandez peut-être comment j’ai surpris ce détail intime de votre vie privée ? Oh, bien simplement, Juve. Tout à l’heure, en bavardant avec votre concierge, je me suis donné pour l’un de vos secrétaires, et cette excellente femme, entre autres paperasses laissées chez elle à votre nom, m’a remis les divers ultimatum de l’administration des Téléphones.
« Non. Ne vous précipitez pas sur le tuyau acoustique. Vous allez gourmander cette pauvre femme. Or, elle n’est pas responsable de votre négligence. J’ajoute même que, pour vous rendre service, et pour l’éloigner, je l’ai chargée en votre nom, tout à l’heure, d’aller payer cet abonnement, d’urgence. Je lui ai remis la somme sur mes fonds personnels. Juve, quoiqu’il arrive, vous vous souviendrez qu’à l’heure actuelle vous me devez cent francs, plus les frais.
– Canaille, hurla le policier.
Fantômas, de plus en plus imperturbable, continuait :
– J’ajoute, que je suis un peu intéressé à voir la communication rétablie, car j’ai donné des ordres pour qu’on me téléphone ici même dans la soirée – vous voyez que j’avais l’intention de devenir votre hôte – un renseignement assez important et que j’attends avec la plus vive impatience.
– Trêve de plaisanterie. Je ne suis pas d’humeur à supporter vos railleries, Fantômas.
Mais le bandit, qui devenait de plus en plus calme au fur et à mesure que Juve s’exaspérait, continua d’un ton persifleur :
– Au fait, Juve, vous ne serez pas de trop.
– Comment ça ?
– Il s’agit de ce pauvre Fandor.
– Quoi ?
– Je vous le disais bien, fit Fantômas, dès qu’il s’agit de Fandor vous dressez l’oreille. Juve, vous m’avez mal jugé tout à l’heure, vous m’avez accusé d’avoir épargné Fandor parce que j’avais peur de mécontenter ma fille. Certaines nécessités empêchent de tenir compte de ces contingences. Fandor d’ici peu de temps ne sera plus de ce monde. J’imagine Juve, que vous ne me traiterez plus de poltron.
Comme un fou, Juve s’était précipité auprès de Fantômas, il le secouait :
– Qu’avez-vous dit encore, misérable ? quel est ce mensonge ?
– Je dis la vérité, Fandor va mourir. Je vois à votre pendule qu’il est six heures moins le quart. Entre nous, elle doit retarder de dix minutes environ. Les dix minutes d’avance que vous m’avez reprochées tout à l’heure. Eh bien, dans une heure trente-cinq exactement, le malheureux Jérôme Fandor, votre ami, aura passé de vie à trépas.
– Fandor, déclara-t-il, est entre les mains de la Justice française, qui n’a pas l’habitude d’assassiner ceux qu’on lui donne à garder. Deux inspecteurs de la Sûreté l’amènent précisément aujourd’hui de Cherbourg à Paris : Nalorgne et Pérouzin.
– Des hommes à moi. J’ai eu la fantaisie de me les attacher voici déjà quelques semaines, alors qu’ils étaient fortement compromis avec un escroc de médiocre envergure, un fabricant de fausses traites : l’ancien cocher Prosper. C’est moi qui leur ai suggéré de faire les démarches nécessaires pour entrer dans la Sûreté de Paris. Il est bon, n’est-ce pas, d’avoir plusieurs cordes à son arc ? Vous avez pu vous en rendre compte, Juve, Nalorgne et Pérouzin ne sont pas très intelligents, mais ils ont une habitude passive de l’obéissance et surtout, encore plus peur de moi que de M. Havard. Lorsque Fandor descendra du train, non pas à la gare Montparnasse, car l’on craint des manifestations, mais à la gare de Clamart où s’arrêtera exceptionnellement le rapide, les braves Nalorgne et Pérouzin l’entraîneront dans un terrain vague et l’exécuteront. D’ici là, Juve, il est vraisemblable que la communication téléphonique sera rétablie et que vous aurez pu prévenir votre domestique d’aller chercher les agents pour m’arrêter.
Juve était devenu pâle. Il se précipita à la fenêtre, espérant voir quelqu’un, pouvoir faire un signe, appeler. Hélas, il pleuvait à torrents, la rue était déserte. Soudain, de son quatrième étage, Juve aperçut marchant à pas comptés le sergent de ville de garde, qui, mélancoliquement rasait les murs des maisons d’en face, le capuchon rabattu sur le képi. Juve saisit sur sa table un encrier en verre et le lança dans la rue, où il s’écrasa non loin du sergent de ville, qui relevait la tête. Juve alors, agitant ses bras, poussant des cris inarticulés, fit des signaux désespérés pour signifier à l’agent de monter le plus vite possible. Mais il n’avait qu’un médiocre espoir dans cette tentative. Il connaissait l’apathie consciencieuse avec laquelle les gardiens de la paix font en général, de long en large, leur tour de garde. Il savait combien ils redoutaient dé s’introduire dans les appartements, mais il faut croire que le projectile, dont Juve s’était servi pour attirer l’attention de l’agent de police, avait courroucé celui-ci, car l’homme immédiatement traversait la rue, faisant signe à Juve, qu’il allait monter. Le policier se retourna, Fantômas gisait toujours sur le plancher. Tandis qu’il attendait l’agent, le policier ne demeura pas inactif, il prit une boîte pleine de pointes et un marteau.
– Vous voulez me crucifier ?
– Non. Mais pour être plus sûr que vous ne bougerez pas, je m’en vais vous clouer au plancher comme font les paysans des montagnes lorsqu’ils ont pris une bête malfaisante, la clouent contre la porte de la maison.
Et à grands coups de marteau, qui résonnaient dans l’appartement, Juve enfonçait d’énormes pointes dans les cordes qui maintenaient Fantômas et immobilisaient de plus en plus ainsi le bandit contre le sol. Le sergent de ville, qui n’avait même pas ôté son capuchon, essoufflé, car il avait gravi l’escalier quatre à quatre, apparut sur le seuil de la porte :
– Que faites-vous ?
– Vous savez, je pense, chez qui vous êtes ?
– Oui, fit le sergent de ville, en esquissant le salut militaire, je vous reconnais bien, monsieur l’inspecteur.
– Je suis Juve, écoutez mes instructions, agent ?
Juve, se penchait, ramassa le revolver que Fantômas avait laissé tomber par terre, il le donna au sergent de ville :
– Prenez cette arme, postez-vous en face de cet homme ligoté sur le sol, et ne bougez plus jusqu’à ce que je revienne, j’en ai pour une heure, pas plus. Vous avez tous pouvoirs pour agir. S’il fait un seul mouvement, s’il cherche à se débarrasser de ses liens, première sommation. À la seconde, à bout portant, vous lui cassez le bras gauche. Il faut viser là.
Et Juve touchait du doigt l’épaule de Fantômas qui ne tressaillit même pas.
– S’il insiste encore, l’autre bras. Soyez énergique, mais prudent. Il faut que je retrouve cet homme quand je reviendrai, et que je le retrouve vivant.
– Monsieur Juve, vous pouvez compter sur moi.
23 – LE RÔLE D’UN OIGNON
– Je n’ai jamais été fichu de faire correctement une addition, ça, c’est connu, c’est réglé comme du papier à musique, rond comme une pièce de cent sous, évident comme la bêtise des bourgeois, mais enfin, tout de même, je sais compter jusqu’à trois, or, j’ai été arrêté lundi, nous sommes aujourd’hui jeudi matin, donc voici le troisième jour, largement compté que je gémis dans cette geôle, et sans me livrer à des calculs compliqués, je puis raisonnablement espérer l’arrivée de la lettre de cet excellent Fantômas, de cette lettre que je lui ai dictée et qui va me permettre de me rendre chez Juve pour flanquer à mon vieux traître d’ami un de ces savons numéro un dont j’ai gardé le secret.
Jérôme Fandor se promenait de long en large dans l’étroite cellule qui lui avait été affectée à la prison de Cherbourg. Il y avait en effet quatre jours, ou plus exactement, trois jours et une nuit, que Juve l’avait fait arrêter, se disant que c’était le meilleur moyen d’empêcher Fantômas de retrouver ses documents.
Ces quatre jours de prison, Jérôme Fandor les avait passés, dans ce qu’il appelait lui-même, « une rogne épouvantable ». D’abord, il était furieux contre Juve, il trouvait que le procédé du policier, pour subtil qu’il fût, était empreint d’une abominable rosserie. De plus, il avait tremblé en se voyant confié à la garde de Pérouzin et de Nalorgne, que Fantômas lui avait dit être ses complices. Rassuré contre l’hypothèse d’une agression possible alors qu’il avait été écroué à la prison de Cherbourg, Fandor avait employé le reste de son temps à s’ennuyer, exactement, pensait-il, « comme s’ennuierait une baleine tombée dans un aquarium de poissons rouges », mais plus au large toutefois. N’empêche, le journaliste avait besoin d’air et de mouvement. Doué d’un tempérament éminemment actif, remuant par nature, par besoin, par amour de l’agitation, il s’accommodait infiniment mal de l’existence cloîtrée.
Et puis, la malchance avait voulu que le juge d’instruction commis pour étudier son affaire fût précisément un vieillard pointilleux, méticuleux à l’excès, ami des formes, des belles phrases, qui portait sur les nerfs de Fandor.
– Je vous dis, avait crié, hurlé, répété le journaliste, je vous dis, monsieur le juge, qu’il est absolument inutile de m’interroger, que c’est du temps perdu, de la salive gâchée. Je ne suis pas coupable. Dans trois jours vous en aurez la preuve en main, la preuve écrite, signée. Une lettre arrivera qui me mettra hors de cause, qui vous prouvera ma bonne foi, qui vous expliquera mon rôle, qui vous ouvrira les yeux. Que diable, vous pouvez bien attendre trois jours avant de me demander un tas de choses inutiles. Parbleu, je ne suis qu’un prévenu, attendez du moins qu’il y ait contre moi des présomptions formelles.
– Vous avez été arrêté sur l’ordre de Juve, s’entêtait à répondre le magistrat, Juve était, a été, est toujours votre meilleur ami, si donc il vous a fait mettre en état de détention, c’est que, de bonne foi, il s’est rendu compte du rôle tout spécial que vous jouiez. Le contraire serait inadmissible. Veuillez donc répondre à mes questions et me dire…
Entre-temps, toujours pas de lettre, lorsque enfin la porte de la cellule s’ouvrit :
– Prévenu, dit le gardien, veuillez me suivre. M. le juge d’instruction vous demande.
– Ça va.
***
M. Langlois, tranquillement, cependant, sans se presser le moins du monde, avec des mines de coquette, rangeait sur une tablette précieuse de menus accessoires de bureau. Il disposait avec amour son porte-plume, son coupe-papier, son encrier, son buvard, un canif, le sceau enfin qui lui servait à authentifier ses pièces de procédure.
– Mon Dieu ! pensait Fandor, encore heureux qu’il n’ait pas des crayons bleus et des crayons rouges.
– Monsieur Jérôme Fandor, j’ai, en ce qui concerne votre affaire, un petit peu de nouveau.
– Vous avez la lettre ?
– J’ai une lettre pour vous et une lettre pour les deux agents qui vous ont arrêté : MM. Nalorgne et Pérouzin. Je vais ouvrir cette lettre.
M. Langlois, froidement, ouvrant une lame de son canif, l’introduisit par le coin de l’enveloppe et avec une lenteur grave, en tira la lettre.
– Ah, tonnerre, qu’est-ce que cela veut dire ?
En même temps, il arrachait la feuille de papier à lettre des mains du magistrat, il la regardait sur toutes ses faces, il la tournait, la retournait, l’inspectait par transparence : les quatre pages étaient blanches, rigoureusement blanches, parfaitement blanches.
– Et pourtant, monologuait Fandor, et pourtant que diable, j’ai vu Fantômas l’écrire, cette lettre ; je l’ai eue entre mes mains, je l’ai lue, voilà ici un coup d’ongle que j’ai moi-même marqué quand j’étais dans l’oubliette.
Tranchant avec le ton emporté du journaliste, la voix froide et ironique de M. Langlois :
– Du moment que cette lettre est blanche, vous conviendrez, monsieur Fandor, qu’elle n’a plus aucune importance.
Mais Fandor n’écoutait même pas ; il continuait à retourner la lettre en tous sens, puis il tirait son portefeuille, il examinait sur un papier maculé d’encre un pâté qu’il y avait fait :
– Pourtant, monologuait Fandor, il n’écrivait pas avec de l’encre sympathique, l’une de ces encres qui disparaissent après un certain temps, puisque voici un bout de papier que j’ai ramassé dans le souterrain, bout de papier sur lequel il avait secoué son stylographe et que l’encre tombée de sa plume sur ce papier ne s’est pas effacée. Alors, pourquoi sur cette lettre ?
Jérôme Fandor allait et venait dans le cabinet d’instruction, tapait des pieds et se tordait les mains, haussait les épaules :
– Je donnerais ma tête à couper que je suis victime d’un truc absolument extraordinaire. Oui, mais quel truc ?
Soudain, Jérôme Fandor qui s’étonnait surtout de la différence qu’il y avait entre la lettre devenue blanche et le pâté d’encre resté noir sur le papier qu’il possédait, Jérôme Fandor qui ne pouvait comprendre que l’encre fût devenue sympathique sur la lettre de Fantômas et ne l’eût pas été sur l’enveloppe où l’adresse était demeurée, Jérôme Fandor, interrogeait d’une voix haletante :
– Et les lettres de Nalorgne et Pérouzin ? la lettre pour ces messieurs plutôt ? est-elle arrivée ?
– En effet, monsieur Fandor, il y a une lettre pour MM. Nalorgne et Pérouzin. Veuillez vous rasseoir, je vais convoquer ces agents, ils liront cette lettre devant vous, et si, quelque chose y est inclus qui soit utile à votre affaire, vous pourrez immédiatement en prendre connaissance.








