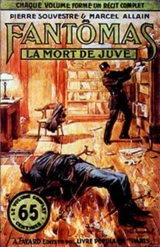
Текст книги "La mort de Juve (Смерть Жюва)"
Автор книги: Марсель Аллен
Соавторы: Пьер Сувестр
Жанр:
Иронические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
– Mais je ne savais pas que ma facture était fausse, protestait M. Bertrand, je ne savais pas que je vous escroquais, et d’ailleurs, vos dix mille francs les voilà. Tenez, je les ai encore sur moi. Je venais les rapporter au commissaire.
***
Mais pourquoi les associés n’avaient-ils pas attendu ce pauvre Bertrand, encore au commissariat en train d’essayer de convaincre ses interlocuteurs ?
M. Bertrand n’était pas parti du Café blancdepuis dix minutes pour aller effectuer l’encaissement qu’on lui avait confié, que Nalorgne et Pérouzin avaient la vive surprise d’entendre un garçon de café crier à haute voix leurs noms :
– Au téléphone, MM. Nalorgne et Pérouzin.
– Allo, cria Nalorgne.
– C’est vous, Nalorgne ? c’est bien vous ? demanda une voix inconnue.
– C’est moi. Que me voulez-vous ?
– Fichez le camp avec Pérouzin, fichez le camp tout de suite, dare dare. Rentrez au Contentieux. Le truc est brûlé. On vous recherche. Allez, débinez.
Ils étaient partis sans demander leur reste.
Nalorgne et Pérouzin, une heure plus tard, car ils avaient fait, par prudence, d’énormes détours, réintégraient leur Contentieux.
– Nous n’avons plus qu’à attendre, disait Pérouzin, Prosper va nous rejoindre évidemment.
– Certainement, nous serons renseignés dans dix minutes.
C’est à trois heures seulement qu’ils entendirent une clef grincer dans leur serrure.
– Voilà Prosper.
Prosper, seul, en effet, possédait une clef de l’officine.
Des pas cependant se faisaient entendre dans le corridor. Puis on traversait le salon d’attente, enfin la porte du cabinet de travail s’ouvrit.
Ce n’était pas Prosper, c’était M. Bertrand. Seulement le M. Bertrand qui entrait dans le cabinet de travail n’avait véritablement rien du M. Bertrand qu’ils avaient vu le matin même au Café blanc. Il était plus grand, moins maigre, il avait surtout une tout autre assurance.
Et puis, voilà qu’il savait les noms des deux associés :
– Bonjour Nalorgne, bonjour Pérouzin, vous allez bien ?
De stupéfaction, ni l’un ni l’autre des deux associés ne répondaient.
M. Bertrand continua :
– Hé, hé, ma parole, seriez-vous devenus muets ? ou encore ne me reconnaîtriez-vous pas ? Vous savez bien qui je suis, voyons ?
Nalorgne, ébahi par l’arrivée de ce visiteur inattendu, se demandant ce que tout cela pouvait signifier, balbutia :
– Vous êtes notre employé, monsieur Bertrand ?… mais comment se fait-il ?
Nalorgne n’acheva pas.
Avec une inconcevable rapidité, M. Bertrand, tout en éclatant de rire, un rire bruyant qui emplissait l’étude, jetait à la volée son chapeau, arrachait une perruque couvrant son crâne, arrachait sa moustache, sa barbe, se redressait et, en même temps, sa main s’armait d’un revolver.
– Votre employé, faisait-il, vraiment, vous croyez que je suis votre employé ? ah, la bonne plaisanterie, non, mes amis, je ne suis l’employé de personne, je suis le Maître.
Et comme Pérouzin et Nalorgne, terrifiés par le revolver braqué sur eux, tremblaient de tous leurs membres, l’inconnu achevait :
– Je suis le maître, mes amis, le maître de tous et de tout. Le meilleur des maîtres, le maître qui, désormais, aura sur vous droit de vie et de mort, qui vous punira terriblement si vous le trompez, vous récompensera magnifiquement si vous marchez droit. Allons, regardez-moi bien. Me reconnaissez-vous ?
Ils regardèrent cet homme d’une quarantaine d’années, grand, mince, souple, à la figure énergique, à la face rase, intelligente. Il parlait d’une voix posée, d’une voix de commandement qui n’admettait pas de réplique :
– Regardez-moi bien, Nalorgne, et Pérouzin, car, à partir d’aujourd’hui, je vous le répète, vous êtes mes lieutenants dévoués, très dévoués, vous m’entendez ? Car, j’ai non seulement droit de vie sur vous, mais encore, après ce que je sais, il me serait facile de vous livrer à la police, vous et Prosper, Prosper, qui sera mon troisième lieutenant dans quelques minutes. Prosper, dont j’ai imité la voix au téléphone pour vous faire quitter le petit Café blanc. Allons, vous me reconnaissez maintenant, je suppose ? Non ? eh bien, je me nomme et comprenez bien qu’il s’agit pour vous d’être sages, je ne suis pas M. Bertrand, M. Bertrand n’a jamais existé, je suis le Roi du Crime, le Maître de l’Effroi. Et vous, désormais, vous êtes mes complices. Remerciez-moi, car lorsque Fantômas fait l’honneur à quelqu’un de s’associer à sa fortune, ce sont des actions de grâce qu’on lui doit.
7 – JUVE SE CACHE
Saint-Germain, résidence estivale, est également une ville fort agréable à habiter en hiver.
Ce matin-là, le temps était clair et froid. Avenue des Violettes, un vieux domestique s’occupait à astiquer avec conscience la plaque de cuivre d’un bouton de sonnette.
Il fut soudain interrompu dans son travail par la voix claire et forte d’une femme qui l’interpellait :
– Et alors, monsieur Jean, ça va toujours ? et votre patron, monsieur Ronier ? comment se porte-t-il, ce matin ?
– Merci, merci bien, vous êtes bien honnête de vous occuper de nous. Oui, ça va toujours.
Mais la marchande de lait insistait :
– Et ses douleurs, à M. Ronier ?
– Eh bien, qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse à ses douleurs ? ce sont des douleurs comme les autres, il en souffre et ce n’est pas pendant l’hiver qu’il faut espérer qu’il se remettra. D’ailleurs, qu’est-ce que cela peut bien vous fiche, à vous, la santé de mon patron ?
– Là, là, fit la brave femme, vraiment, vous n’êtes pas à prendre avec des pincettes, monsieur Jean, quel caractère, grand Dieu ! Pour ce qui est de m’en fiche, bien sûr que je m’en fiche, si vous allez par là, et si je demande des nouvelles de M. Ronier c’est pas par curiosité, mais histoire de savoir comment il se porte.
Le domestique ne répondait pas. Il venait d’apercevoir à l’extrémité de l’avenue, deux hommes jeunes encore, aux allures d’anciens militaires qui, peu à peu, se rapprochaient de lui.
– Voilà les neveux de Monsieur, fit-il, d’un ton plus doux, en s’adressant à la marchande de lait.
Mais celle-ci, après s’être arrêtée un instant, poussa sa voiturette dont les cahots de la route firent tinter les bouteilles.
Les deux hommes que Jean avait qualifiés de « neveux de son patron », firent un petit salut amical et protecteur au serviteur bourru, puis franchirent la grille de la villa et, en habitués qui connaissent les aîtres, entrèrent dans la maison.
Cependant qu’ils étaient leur pardessus, l’un d’eux dit à son compagnon :
– Vraiment, cela me fait de la peine chaque fois que je viens ici pour le voir. Quand je pense que c’était un homme si actif, si vivant, et que depuis plus de trois mois son état n’a fait qu’empirer.
– Comme c’est vrai, mon cher Léon, le patron ne va pas bien.
– Ah Michel, ce que c’est que de nous. Un mauvais coup, comme ça, ramassé au hasard et vous voilà cloué sur un lit, immobilisé, paralysé.
– L’esprit est encore bon, l’intelligence toujours ouverte, vive.
– Oui, mais les jambes ? plus rien à faire.
Les deux hommes montèrent au premier étage, frappèrent à la porte. Une voix puissante leur répondit :
– Entrez.
Ils pénétrèrent tous deux dans une vaste chambre au milieu de laquelle se trouvait un grand lit où était étendu un homme au visage énergique, au teint coloré, à la chevelure grisonnante. Était-ce bien l’oncle de ces deux jeunes gens, comme l’avait dit le domestique ?
Ces derniers, en effet, à peine dans la chambre, esquissaient une sorte de salut militaire, et d’un ton à la fois joyeux et respectueux ils s’écrièrent :
– Bonjour Juve, comment allez-vous ?
C’était Juve, en effet, étendu sur son lit de malade. Juve que son domestique, fidèle à la consigne, déclarait à tout venant s’appeler M. Ronier et dont les neveux n’étaient autres que les inspecteurs de la Sûreté, ses jeunes collègues, Léon et Michel. Qu’était-il donc advenu à Juve ? Pourquoi le vaillant lutteur se trouvait-il ainsi terrassé par le mal, étendu sur un lit, véritable loque humaine ?
Quelques mois auparavant, alors que Juve et Fandor poursuivaient Fantômas et finissaient par le démasquer à l’agence Thorin, le bureau de placement où les domestiques étaient cambrioleurs et assassins, Fantômas, patron de cet affreux établissement, avait, au cours d’une lutte, frappé Juve, à la tête, d’un coup de manche de poignard. Longtemps le sympathique policier était resté sans connaissance. Puis il avait éprouvé des troubles dans les centres nerveux. Les médecins qui le soignaient avaient diagnostiqué une paralysie momentanée qui, disaient-ils, ne tarderait pas à disparaître. Les jours s’étaient écoulés. L’état général de Juve redevenait excellent, mais, hélas, ses membres lui refusaient tout service. Les jambes ne le soutenaient plus, c’est à peine s’il pouvait se servir de ses bras, et avec quelle difficulté.
Ah, le coup avait été terrible pour le vaillant policier, et dans son entourage on avait été atterré de le voir ainsi. Fandor, l’inséparable de Juve, atteint d’une dépression, avait disparu de Paris.
Quant à Juve, il n’avait pas craint, chose incompréhensible, extraordinaire, de donner tout d’abord une très grande publicité à son état de santé. Il avait dicté lui-même des bulletins de santé où il ne se ménageait pas. Était-ce là une folie de malade ? Jusqu’au jour où Juve avait interdit de donner le moindre renseignement sur son compte, avait quitté Paris, s’était fait transporter à Saint-Germain, dans une petite villa qu’il louait et où désormais il vivait ignoré, sous le nom de M. Ronier, avec pour seule compagnie son fidèle domestique Jean.
Juve toutefois recevait quelques visites dont celles de Léon et Michel. Les deux inspecteurs venaient à Saint-Germain tant pour tenir le célèbre policier au courant de leurs affaires, que pour obtenir de lui des avis précieux. Car, ainsi que le disait Michel : si les membres de Juve désormais se refusaient à tout service actif, l’intelligence restait entière.
Ce matin-là, Léon et Michel avaient beaucoup de choses à dire au policier.
Et d’abord d’une affaire délicate dont ils avaient eu connaissance par des indiscrétions, affaire qu’ils appelaient « Le mystère de l’avenue Niel ».
Léon et Michel s’étaient étonnés d’apprendre que des disparitions s’étant produites dans l’appartement d’un courtier maritime, Hervé Martel, ce dernier n’avait pas porté plainte alors qu’on s’attendait à lui voir faire intervenir la police. Qu’en pensait Juve ?
– Il ne faut pas être surpris, mes chers amis, leur déclara-t-il, lorsque certains particuliers, qui sont victimes d’une désagréable aventure quelconque, tenant de près ou de loin à quelque cambriolage ou chantage savant, ne s’adressent pas à nos services. Vous savez que dans nos bureaux, dans notre administration, on est toujours très consciencieux, plein de bonne volonté, mais quelquefois maladroit, indiscret. Lorsqu’on mêle la Sûreté à ses affaires, on est assuré de l’indiscrétion. J’imagine qu’un homme tel que M. Martel préfère garder tout cela secret jusqu’au jour où il ne pourra plus faire autrement, soit qu’il ait trouvé les coupables des vols dont il est victime, soit qu’il soit impuissant à effectuer lui-même les recherches.
– Moi, je ne comprends pas qu’il hésite, dit Michel. De deux choses l’une : si l’on est victime de quelque chose, on porte plainte, ou alors, si on évite de le faire, c’est qu’on se sent morveux.
– Je vous reconnais bien là, mon cher Michel, avec vos idées nettes, arrêtées, vos grands principes. Mais dites-vous bien que la vie n’est pas une ligne droite que l’on peut suivre à son gré. L’itinéraire de notre existence comporte fréquemment des chemins sinueux que l’on doit suivre, et lorsque la montagne est trop abrupte, plutôt que de la gravir au risque de mille périls, mieux vaut la contourner.
– Vous parlez comme un livre, dit Léon.
– C’est, poursuivit le policier, peut-être parce que j’ai vu beaucoup de choses.
Puis pour convaincre Michel :
– Mon cher, je comprends parfaitement l’attitude de M. Hervé Martel. Un homme d’affaires comme lui, surtout un spéculateur de son espèce, – car ce courtier maritime est un spéculateur –, n’a jamais intérêt à faire connaître au public, c’est-à-dire à sa clientèle, qu’il a subi des pertes importantes. Voyez-vous, les vols, chez ces gens-là, ont toujours un caractère plus ou moins suspect. Et puis, enfin, n’imaginez pas que M. Hervé Martel se désintéresse des pertes qu’il a subies. S’il n’a pas convoqué la police officielle, il a pris à son service des détectives privés.
– Oui, interrompit Michel, il s’est adressé à Nalorgne, à Pérouzin, les anciens inspecteurs de Monaco, que vous avez bien dû connaître, Monsieur Juve ?
– Si je les ai connus !
– En tout cas, Monsieur Juve, dit Léon, ça n’est pas pour durer.
– Je sais ce que vous voulez dire, fit Juve : Nalorgne et Pérouzin vont être admis à la Sûreté en qualité d’inspecteurs auxiliaires.
– Tiens, s’écria Michel, comment savez-vous cela ?
– C’est moi, fit Juve, qui les ai recommandés, sans qu’ils s’en doutent d’ailleurs, à M. Havard.
– Je voudrais bien, s’écria Léon, avoir par eux des renseignements sur le mystère de l’avenue Niel.
Juve ne dit rien, il prêtait l’oreille :
On entendait marcher dans le jardin. Des pas précipités qui faisaient crier le gravier.
Juve conclut l’entretien qu’il avait avec ses deux jeunes collègues.
– Mes chers amis, dit-il, retirez-vous, je vous en prie, j’attends des visiteurs, les voici qui arrivent. Ne vous montrez point. Sortez par la pièce à côté, de façon à ne pas les rencontrer dans l’escalier. J’y tiens énormément.
Puis, comme Léon et Michel prenaient congé :
– Au fait, ça vous intéresse peut-être de savoir qui vient me rendre visite ? Eh bien, ce sont Nalorgne et Pérouzin.
***
– Jean.
– Monsieur Juve ?
– Il n’y a plus de M. Juve en ce moment : c’est le vieux Ronier qui te parle. Comprends-tu ce que cela signifie ?
– Naturellement, je comprends, ronchonna Jean ; je ne suis tout de même pas complètement idiot.
Maussade, l’excellent domestique passa dans le cabinet de toilette attenant à la chambre de son maître. Il en rapporta une perruque blanche, une barbe postiche, ajusta le tout, tendit au policier un miroir :
– Cela vous va, patron ?
– Oui, tu peux les faire entrer.
Nalorgne et Pérouzin venaient rendre visite à leur client, M, Ronier, qui leur avait écrit pour leur demander de collaborer à son futur bonheur.
– La paralysie, expliquait Juve, m’immobilise encore, mais je ne tarderai pas à être guéri, et comme la maladie n’empêche pas les sentiments, que, sans être vieux, je suis quelque peu âgé et fatigué de vivre seul, j’ai pensé qu’il serait agréable pour moi de me marier. Vous, messieurs, qui avez les plus hautes relations dans la société parisienne, vous devez être les hommes les mieux désignés pour trouver l’épouse qui me conviendrait. J’ai quelque fortune, je ne serai pas exigeant pour la dot de ma future femme, il suffit qu’elle soit honnête, respectable et gentille.
– Monsieur, affirma, sur un ton doctoral Nalorgne, qui avait écouté ce préambule avec une superbe gravité, vous ne pouvez pas en effet vous adresser mieux qu’à nous, et d’ores et déjà nous avons votre affaire.
– Tiens, qui donc ?
Nalorgne le foudroya du regard et poursuivit :
– Une jeune fille charmante, monsieur Ronier, qui vous donnera toute satisfaction. Nous la connaissons depuis son enfance. C’est une amie de notre famille, sérieuse, excellente éducation, a toujours travaillé. Elle exerce la profession de dactylographe. Son prénom : Hélène.
– Ah, fit Pérouzin, j’y suis. Elle travaille chez M. Hervé Martel car, M. Ronier, ce grand courtier maritime, le plus connu de la place de Paris, est aussi notre client.
Mais Nalorgne, après avoir fait à Juve un boniment dans les règles, s’arrêta soudain, et il regarda le faux M. Ronier avec une insistance si singulière que celui-ci parut s’en rendre compte :
– Hein ? demanda Juve avec une pointe d’anxiété très bien dissimulée, voilà que vous avez des regrets maintenant, en me voyant. Vous vous dites : cette jeune fille ne voudra jamais épouser un pauvre homme dans un si misérable état.
– Oh, s’écria Pérouzin, ce n’est certainement pas cela que pense mon associé Nalorgne, mais…
Pérouzin également avait fixé le vieillard, et sur sa physionomie s’était peinte une certaine stupéfaction. Il allait poursuivre, Nalorgne l’en prévint :
– Nous ne nous permettrions pas, monsieur, d’avoir une telle opinion sur quelqu’un qui nous fait l’honneur de nous accorder sa clientèle. Certes, le cœur des jeunes filles est un abîme insondable, et nous ne pouvons vous donner, dès aujourd’hui, une promesse formelle d’acceptation. M lle Hélène ne s’engage à rien en faisant votre connaissance, et je suis convaincu que, par sa grâce, son charme, sa douceur et sa touchante timidité, elle fera sur vous la plus délicieuse impression.
Juve tressaillit. Ses espérances étaient exaucées. Nalorgne et Pérouzin s’offraient spontanément à lui faire connaître la personne qu’il désirait voir, car, malgré le peu d’intérêt qu’il avait eu l’air, devant Léon et Michel, de prendre aux mystérieuses affaires de l’avenue Niel, Juve se passionnait pour ces vols extraordinaires, et le célèbre policier, de son lit de douleur, voulait savoir. Il avait entendu parler de cette Hélène, la dactylographe, et il s’était juré de la connaître. Or, voici que la proposition de Nalorgne et de Pérouzin allait singulièrement lui faciliter les choses :
– Amenez-la moi, déclara avec enthousiasme le pauvre M. Ronier, cependant que, graves et dignes, Nalorgne et Pérouzin se levaient pour le quitter.
– Nous ferons notre possible, déclara Nalorgne, pour vous faire connaître M lle Hélène d’ici une semaine au plus.
Nalorgne salua gravement, Pérouzin fit de même, mais au moment de partir, l’ancien notaire, toujours pratique, dit au faux M. Ronier :
– Et alors, cher monsieur, il est encore une petite chose dont nous n’avons point encore parlé : c’est la question des honoraires.
– Vous me les fixerez vous-même, répondit Juve, magnanime, lorsque l’affaire sera conclue.
Les deux agents d’affaires se retirèrent, et Juve, après s’être fait débarrasser de ses postiches, se mit à réfléchir très profondément.
***
– Eh bien, Pérouzin ?
– Eh bien, Nalorgne ?
– Ça, c’est plus fort que de jouer au bouchon.
– Vous l’avez donc reconnu aussi ?
– Parbleu, comme c’est difficile. À policier, policier et demi. J’aime à croire que nous ne sommes pas complètement idiots.
– Et que, tout au contraire, ce pauvre Juve est bien déprimé.
– Ah, ah, ah, monsieur Ronier, la farce est bonne, en vérité.
– Ce que c’est, tout de même, que d’être paralysé.
– Mais croyez-vous qu’il le soit réellement ?
– Parbleu, c’est indiscutable. Tout Paris l’a su, au moment de ce que l’on a appelé l’accident de Juve, et qui n’était autre qu’un mauvais coup de Fantômas.
– Mon cher Nalorgne, dit Pérouzin, je vais vous poser une question précise. Répondez-moi avec la même précision. Dites, pourquoi croyez-vous que Juve, qui nous connaît fort bien, nous a fait venir ici ? Pourquoi se donne-t-il pour un vieux monsieur désireux de se marier ? Il ment ? Il dit la vérité ?
– Pérouzin, pourquoi allez-vous chercher midi à quatorze heures. C’est bien simple, Juve, en tant que policier, est un homme fini, usé, perdu. Il veut prendre femme. C’est son droit. Mieux encore, c’est très naturel.
– Nalorgne, vous voyez les choses trop simplement. Ce qui arrive n’est pas dû au hasard seul. Fantômas qui nous tombe sur le dos…
– Vous vous en plaignez ?
– Non. Mais il y a aussi cette Hélène, que nous ne connaissons ni d’Ève ni d’Adam, qui nous demande de lui rechercher Fandor, puis, voilà que, convoqués par un certain M. Ronier, nous tombons sur Juve. Tout cela n’est pas clair.
– Limpide, au contraire. Cela prouve que nos affaires s’arrangent de mieux en mieux et qu’après avoir crevé de faim nous allons faire fortune. Songez donc, Pérouzin, à la Préfecture de police, on nous a dit encore tout récemment que nos démarches allaient être couronnées de succès, et voyez-vous l’éclat que cela donnerait à nos affaires ? MM. Nalorgne et Pérouzin, inspecteurs de la Sûreté, de la vraie Sûreté et, en outre, travaillant avec… Ah, je ne nous donne pas six mois pour être millionnaires.
– Croyez-vous que Juve ne sait pas que nous l’avons reconnu ?
– Il ne se doute de rien.
– Pourquoi, poursuivit Pérouzin, se dissimule-t-il sous un faux nom ?
– Rendez-vous compte, Pérouzin, que Juve, à l’heure qu’il est, est fini, archi-fini, incapable même de faire un geste. Or, quelle peut être la pensée de cet homme qui a passé les dix dernières années de sa vie à poursuivre… Il a peur.
– Fantômas ne sait pas qui est M. Ronier.
– Non, Fantômas ne le sait pas encore.
8 – LES CLIENTS DE « L’ENFANT JÉSUS »
« À l’Enfant Jésus ». C’est à peine si l’on pouvait en croire ses yeux, et cependant l’infect bouge qui terminait la rue Championnet, du côté de la Chapelle, portait cette enseigne.
C’était un marchand de vin, un zinc ne payant pas de mine, sale, exigu, enfumé, qui s’intitulait ainsi a) parce que de son toit l’on apercevait les tours du Sacré-Cœur ; b) parce que le patron de l’assommoir se prénommait Joseph ; c) parce que ce Joseph, Auvergnat d’ailleurs, prétendait que sa boutique, vu les trésors de victuailles qu’elle contenait, ressemblait à s’y méprendre à l’Éden perdu à cause de notre mère à tous, mauvaises raisons au demeurant.
– Par exemple, ajoutait-il, ce sont les vierges, saintes ou non, qui manquent dans la maison.
Et, de fait, le troquet du père Joseph était le rendez-vous de toute la racaille du quartier, des apaches en veine de paresse, et des filles du trottoir. L’établissement, toujours désert le matin, peu achalandé l’après-midi, se remplissait, dès la nuit tombée, d’une clientèle interlope et qui, jusqu’aux petites heures, ne cessait de faire le tapage le plus infernal en absorbant des liquides de feu ou d’encre.
La police restait indulgente, car c’était l’un des endroits les plus commodes pour y retrouver les malfaiteurs. Et, en outre, on chuchotait volontiers, dans les services de la Sûreté, que le père Joseph, à l’occasion, était de bon conseil.
Ce soir-là, un samedi, vers onze heures, l’ Enfant Jésusregorgeait de clients.
Dans la fumée, dans le remugle âcre du tabac et de l’alcool à bas prix, une clameur s’éleva. Arc-bouté au chambranle, un ivrogne en houppelande crasseuse et pantalon de velours à patte d’éléphant ne parvenait pas à pénétrer dans la salle, par conséquent, à en fermer la porte.
– La lourde, y caille ! hurlaient les loustics.
Enfin ce client imprévu appela au secours :
– Hé, patron, viens-t’en voir à m’aider à franchir la passe. C’est malheureux de penser qu’il faut maintenant avoir un pilote pour entrer dans ta cale sèche. Mets-en voir un coup pour rentrer ma carcasse au bassin de radoub.
Le père Joseph resta au comptoir :
– Plus souvent, grogna-t-il, que j’irai chercher un homme saoul.
Mais l’individu, toujours en lutte avec le battant de la porte, protestait :
– Ben quoi, puis après, un homme saoul n’est pas déshonoré. Sûr que je suis saoul. Mais ça arrive à des gens très bien. Du moment que j’ai l’argent pour payer, personne n’a le droit de me refuser à boire. Ça oui, par exemple. Je défends bien à n’importe qui de venir me le reprocher, ce que je bois, puisque je le paie.
Le froid pénétrait. Il fallait ou le faire sortir ou le faire rentrer. Un homme se leva, gros et couvert de crasse des pieds à la tête, complètement chauve, mais une épaisse barbe embroussaillait ses joues et son menton.
– Je vais le vider, déclara-t-il.
Et il s’approcha de l’autre qui restait accolé au montant.
– Ah, par exemple, elle est bien bonne celle-là, dit l’ivrogne, c’est bien toi, Dégueulasse ?
Et le petit gros ainsi interpellé par le grand maigre de s’écrier :
– Ça, par exemple, ça dépasse tout, Fumier, vieille saloperie, qu’est-ce que tu viens faire là.
Ils s’accolèrent, puis gagnèrent le comptoir :
– J’en paie un, dit Fumier.
– J’offre l’autre répliqua Dégueulasse.
Oui, ils avaient de l’argent ces surprenants personnages, si bizarres vraiment qu’on prêtait l’oreille pour écouter leurs épanchements après ces retrouvailles.
D’ailleurs, Dégueulasse et Fumier ne cherchaient pas à s’entretenir en secret, et c’est d’une voix tonitruante, comme s’ils étaient abominablement sourds l’un et l’autre, qu’ils se racontaient leurs aventures, depuis l’époque déjà lointaine où les hasards de l’existence les avaient séparés. Car tous deux étaient du même pays, originaires d’un village du centre de la France qu’ils avaient quitté pour venir à Paris en sabots. Mais la fortune ne les avait pas favorisés, et, au lieu de troquer leurs rustiques chaussures contre des bottines vernies, comme il arrive aux parvenus, ils n’avaient pu échanger les galoches de bois que contre de vieux souliers ramassés au hasard du ruisseau. Non, ils ne se plaignaient pas du sort :
– Moi, déclarait Dégueulasse avec une emphatique vanité, je suis dans la Marine. C’est à Cherbourg que je gratte depuis déjà une pièce de cinq ans. Mon boulot, c’est d’aller avec la drague, autrement dit la Marie-Salope, ramasser les ordures du patelin qu’on fout dans l’entrée du port et je te prie de croire que c’est le bon métier, parce que plus que tu en cherches, plus que t’en trouve.
– C’est rigolo, expliquait Fumier, on voit bien qu’on est pays tous les deux, car moi je travaille comme toi dans le même fourbi. Tantôt, je suis embauché pour racler la boue le long des trottoirs et dans les rues, tantôt c’est pour farfouiller dans les poubelles et rechercher dans les carcasses de zhomards et les trognons de choux si les bourgeois ont pas laissé tomber un bibelot que ça vaut la peine.
– Fumier, s’écria Dégueulasse, ça me fait plaisir de te revoir.
– Dégueulasse, on se quitte plus. Mais, par le fait, comment ça se fait que tu te trouves ici, Dégueulasse, puisque censément tu restes à Cherbourg ?
L’employé de la Drague leva son verre à la hauteur de son œil, puis, après l’avoir ramené jusqu’au niveau de ses lèvres, il expliqua :
– Voilà, c’est tout un fourbi du diable, je suis dans les ordures, mais dans la justice aussi. Figure-toi, Fumier que, voilà trois jours, le patron m’a dit : « Dégueulasse, faut aller à Paris, histoire de faire un témoignage dans une affaire de coups et blessures qui a commencé à Cherbourg et qui va se terminer à Pantruche. » Il m’a donné un papier sur lequel il y avait des choses écrites, et le pèze pour prendre le grand frère. Alors, je me suis pris par la main, et je m’ai amené ici comme de juste. Voilà-t-y pas qu’en route j’ai rencontré des copains, on a pris un verre, puis un autre, tant et si bien que j’ai oublié d’aller dégoiser mon histoire et de faire le témoin dans le procès. Un soir, je me suis dit : « Mon petit Dégueulasse, faudrait voir à te ramener à Cherbourg, où l’on doit être en peine de toi. Mais, tu me croiras si tu veux, on a dû changer la gare de place, car j’ai jamais été foutu de la retrouver. Alors, naturellement, tout en la recherchant à droite, à gauche, j’ai pris des verres et, dame, depuis ce temps-là, j’aime autant te dire, je ne suis plus dans mon assiette.
– Ça, remarqua Fumier, c’est bien naturel, d’ailleurs, j’aime autant te le dire aussi, moi non plus je ne désaoule pas. Seulement, moi, voilà un an que ça dure ? Dégueulasse, on va pas s’arrêter.
– Sûr que non, Fumier. Encore un verre ?
Dialogue passionnant en vérité dont l’assistance ne perdait pas une virgule, à l’exception de trois hommes assis dans un coin noir, qui discutaient avec passion, ou plutôt non, dont deux écoutaient avec passion le troisième, sans rien dire. Et si l’orateur paraissait simplement un homme robuste et énergique, dans la force de l’âge, ses deux compagnons avaient des allures caractéristiques d’individus bizarres et indéfinissables, caricatures de bourgeois, types d’une pègre mal définie, comme on en voit aux abords des lieux les plus mal famés. Ces deux hommes n’étaient autres que les agents d’affaires de la rue Saint-Marc : Nalorgne et Pérouzin.
Or, Nalorgne et Pérouzin, dans le bouge de l’ Enfant Jésus, étaient attablés avec le Maître qui leur exposait son programme.
Il leur avait dit :
– Plusieurs millions d’or monnayé ont été achetés récemment par le Gouvernement autrichien aux États-Unis d’Amérique. Cet or, soigneusement enfermé dans des caisses blindées, a été chargé à bord d’un navire britannique qui fait le service entre New York et Cherbourg. Il arrivera bientôt dans ce port, et les précieux colis seront aussitôt transbordés dans un wagon spécial qui, attaché à un train de marchandises, sera conduit jusqu’à la frontière.
– Eh oui, s’étaient dit les deux compères, notre client Hervé Martel s’en occupe, il a même gardé pour lui « ce risque ». Ah, ces spéculateurs.
Ce n’était, en somme que de la bonne information, mais où Nalorgne et Pérouzin avaient sursauté c’est en entendant Fantômas déclarer :
– Ces millions, nous allons nous en emparer. Voici mon plan : Le navire anglais, un cargo-boat, à bord duquel sont ces caisses d’or et qui s’appelle le Triumph, a dû arriver hier ou ce matin, en rade de Cherbourg. Dans quarante-huit heures, les formalités de douane seront achevées, et, comme je viens de vous le dire, les caisses déchargées du navire seront placées dans un wagon, le wagon 3227.
– Ah ! Fantômas, s’écria Pérouzin, que vous êtes donc bien renseigné.
– Le seul moyen pour réussir dans des affaires de cette nature, c’est d’être documenté. Voilà quinze jours que je m’efforce de me renseigner, c’est bien le moins que mes efforts aient été couronnés de succès.
– Mais comment avez-vous fait ?
Un regard dur et hautain du maître lui fit baisser les yeux piteusement. Pérouzin oubliait que Fantômas ne disait que ce qu’il voulait, et que jamais personne ne devait se permettre de lui poser une question. Fantômas, d’ailleurs, sans tenir compte de la question de l’ancien notaire, poursuivait, donnant ses ordres, sec, bref, à la manière d’un général qui élabore son plan de bataille :
– Le jour même où le chargement sera effectué à bord du wagon en question, le train qui l’emmène partira de la gare de Cherbourg. Le convoi, qui porte le numéro 22 bis, se mettra en route à vingt heures cinq. Vous, Nalorgne, vous aurez simplement pour mission, ce soir-là, de vous assurer que le wagon en question est bien placé l’avant-dernier dans l’attelage du convoi. Quant à vous, Pérouzin, vous connaissez, n’est-ce pas Sottevast et particulièrement les abords de la gare ?








