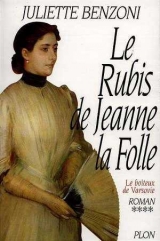
Текст книги "Le rubis de Jeanne la Folle"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
– Dites toujours !
Elle écouta sagement, sans mot dire et sans surprise apparente, puis elle déclara le plus tranquillement du monde :
– Certains prétendent qu’elle apparaît ici tous les ans à pareille date. Moi je ne l’ai jamais vue parce qu’elle ne se montre qu’aux hommes.
– Vous la connaissez donc ?
– Tous les Sévillans connaissent l’histoire de la Susana. Elle est inscrite dans notre mémoire collective. Mon beau-père prétendait l’avoir rencontrée… et aussi l’un de nos maîtres d’hôtel que l’on a retrouvé un matin errant par les rues et totalement privé de raison. On dit qu’elle revient ici pour le portrait de la Reine, mais surtout pour le rubis qu’elle porte au cou. Après tout, c’est peut-être elle qui a volé le tableau ?
– Je ne crois pas qu’elle en ait eu la possibilité. Quand je la suivais, en tout cas, elle ne portait rien. Mais puisque nous parlons du joyau représenté sur la toile, sauriez-vous ce qu’il est devenu ? Une pierre de cette importance doit avoir laissé sa trace dans l’Histoire ?
La duchesse écarta ses petites mains chargées de bagues dans un geste d’ignorance.
– J’ai honte d’avouer que je n’en sais rien. Pourtant, nous descendons de ce marquis de Denia qui fut le geôlier de Tordesillas où la pauvre reine subit une si longue captivité et parfois dans d’affreuses conditions. Denia et sa femme étaient rapaces au-delà de toute expression et j’ai tout lieu de croire qu’ils ont pu faire main basse sur les quelques bijoux que la pauvre reine conservait. Mais il se peut aussi qu’au moment de sa mort le rubis ne lui ait plus appartenu, sinon il nous serait peut-être parvenu par voie d’héritage. Il est possible que dona Juana l’ait offert à sa dernière et si précieuse fille Catalina quand celle-ci a quitté Tordesillas pour épouser le roi de Portugal. Mais j’y pense : puisque vous deviez, demain, être confronté à Fuente Salida, nous pourrions lui demander ce qu’il en sait ? Je crois qu’il n’ignore rien de ce qui touche à la reine folle.
– Ne venez-vous pas de dire que je « devais » ? Je le dois toujours, madame la duchesse… à moins que vous refusiez cette rencontre chez vous ? Je vous avoue que je le regretterais : je compte beaucoup dessus…
– Ce ne sera pas utile. J’ai l’intention de régler cette question ce soir même : dans un petit quart d’heure, le commissaire Gutierez devrait venir ici. Quant à Fuente Salida, je vais lui faire porter un carton d’invitation à déjeuner avec vous demain. Tel que je le connais, il accourra, ajouta-t-elle avec un sourire qu’Aldo imita :
– La… cursilería ?
– La cursilería.Le cher homme ne résiste pas à un titre ducal et j’en possède neuf. C’est un curieux personnage : chaque printemps, il vient ici et à Grenade pour effectuer une sorte de pèlerinage ; le portrait et le tombeau. Nous ne manquons jamais de l’inviter mais il s’est trouvé que, cette fois, la Reine arrivait en même temps que lui.
– J’ai été surpris de ne pas le voir dans la suite royale. On m’a dit qu’il était chambellan.
– De la reine Marie-Christine, la mère du Roi et la veuve d’Alphonse XII. Elle vit retirée à Madrid et le titre de chambellan ne correspond plus qu’à une ombre de fonction. Je crois d’ailleurs que Sa Majesté le trouvait assommant…
Avec une ponctualité toute militaire, Gutierez fit son entrée à la minute même qui lui avait été prescrite, salua en homme qui sait son monde et prit place sur le rebord du siège qu’on lui indiquait, non sans jeter à Morosini un coup d’œil lourd de sous-entendus : de toute évidence il n’était pas ravi de le trouver là. Il le fut moins encore lorsque son hôtesse prit la parole :
– Je vous ai demandé de venir me voir, señor comisario,pour vous éviter d’aller plus loin sur un chemin erroné, fit-elle en offrant au policier l’un de ces sourires auxquels il est difficile de résister. En effet, je suis en mesure de vous assurer que le prince Morosini ici présent n’est pour rien dans le dommage que nous avons subi…
– Veuillez me pardonner si j’ose vous contredire, madame la duchesse, mais les faits et témoignages que j’ai pu recueillir ne sont guère en faveur de… votre protégé.
Le mot était malheureux. Dona Ana fronça un sourcil olympien :
– Je ne protège personne, señor ! Il se trouve qu’un incident tout à fait fortuit me met à même de vous offrir un témoignage irréfutable. Alors que nous étions à souper, la marquise de Las Marismas est venue demander à Sa Majesté la Reine l’autorisation pour le prince Morosini, souffrant d’une crise de névralgies, de se retirer. Ensuite, elle a commandé une voiture et l’a fait reconduire à son hôtel. De mon côté, un moment plus tard, j’ai prié ma secrétaire dona Inès Aviero d’aller me chercher un châle. Ce qu’elle a fait. Or, dona Inès est formelle : le portrait était à sa place lorsqu’elle est passée devant lui.
– Elle a pu ne pas le remarquer. Lorsque l’on est habitué à voir un objet jour après jour, ce sont des choses qui arrivent…
– Pas à dona Inès ! Elle sait se servir de ses yeux et aucun détail n’échappe à sa vigilance… Vous allez pouvoir le lui demander ; je vais la faire appeler.
– Si elle est sûre du fait, pourquoi n’a-t-elle rien dit lorsque j’ai interrogé vos gens ?
– Vous ne le lui avez pas demandé, fit la duchesse avec une logique imparable. D’ailleurs, c’est quand nous nous sommes retrouvées seules hier soir que dona Inès, après avoir réfléchi, m’a dit qu’elle était certaine d’avoir vu le portrait de la Reine aux environs d’une heure du matin. Comme le prince nous a quittés vers minuit et demi, concluez vous-même.
Le ton, sans réplique, était de ceux qu’un modeste señor comisario,face à l’une des plus grandes dames d’Espagne, ne pouvait s’autoriser à mettre en doute, mais, de toute évidence, l’envie ne lui en manquait pas. Assis sur sa chaise, tassé sur lui-même, sa tête de taureau rentrée dans ses épaules massives, il semblait ne pouvoir se décider à lever le siège. Compatissante et pour lui laisser le temps de digérer sa déception, dona Ana ajouta, soudain gracieuse :
– Soyez bon d’informer le marquis de Fuenta Salida de ce que je viens de vous dire.
Gutierez tressaillit, comme éveillé d’un rêve et, non sans effort, se mit debout :
– De toute façon, le señor marquis ne serait pas venu demain. Avant de venir, je suis passé chez son cousin qui le loge quand il vient à Séville et j’ai appris qu’il est déjà parti.
– Comment, s’indigna la duchesse, il lance en l’air une accusation gratuite et il s’en va ? C’est bien la meilleure preuve qu’il obéissait à une rancune personnelle et que c’était de la simple méchanceté…
– Je pencherais plutôt pour de la simple économie, suggéra le commissaire qui tenait à défendre un homme si précieux Il a pensé qu’en profitant du train royal pour regagner Madrid. Le voyage ne lui coûterait rien.
Morosini se mit à rire.
– Peut-être avait-il tout simplement révisé son jugement, fit-il avec indulgence. En ce qui me concerne, tout est bien qui finit bien et je vais maintenant me préoccuper de mon propre retour.
Il se levait lui aussi, mais dona Ana le retint :
– Restez encore un moment ! Señor comisario, voilà votre enquête dans une impasse et vous devez avoir beaucoup à faire ! Je ne vous retiendrai pas plus longtemps…
Gutierez sortit, mais sa façon de tramer les pieds disait assez qu’il partait à regret.
– Il n’a pas l’air convaincu, remarqua Morosini.
– C’est sans aucune importance. Ce qui compte, c’est qu’il cesse de vous importuner. Son accusation était grotesque.
– Mais normale quand on ne connaît pas les gens et qu’il s’agit d’un étranger.
– C’est surtout normal quand on est affligé d’un esprit borné. La première qualité d’un bon policier est de savoir discerner à qui il a affaire.
La cloche d’un couvent voisin se fit entendre. Aldo se leva de nouveau sans que cette fois on l’en empêche. Son regard pétillait quand il s’inclina sur la main de son hôtesse :
– Je vous dois de grands mercis, madame la duchesse. Des mercis plus grands que vous ne voulez bien le dire !
La même petite flamme amusée brilla dans les prunelles sombres de dona Ana.
– Prétendriez-vous, mon cher prince, que ce que je viens d’affirmer n’était pas l’expression même de la vérité ?
Morosini huma l’air ambiant et la brise fraîche venue de la mer qui agitait avec majesté la cime des grands palmiers.
– Il ne fait pas chaud et la robe de Votre Grâce – il employait à dessein le titre anglais réservé aux duchesses parce qu’il trouvait qu’il lui allait bien – est en fort beau tissu, mais plutôt mince… et elle n’a pas encore réclamé de châle.
Cette fois, elle se mit à rire, quitta son siège à son tour et vint prendre le bras d’Aldo :
– Vous pensez que je devrais ? … De toute façon, je n’ai jamais froid ! Mais… je voudrais savoir pourquoi Fuente Salida s’est empressé de prendre le large. Il joue volontiers les gueux bien qu’il se soit pas dans la misère, tant s’en faut ! Alors, pourquoi se jeter dans le train royal ?
– Une crise aiguë de cursilería ?
– J’ai peine à y croire : il approche l’entourage royal autant qu’il le désire. Peut-être, après tout, a-t-il éprouvé du remords de ses affirmations fantaisistes.
– C’est possible, mais s’il a des remords, je le saurai. Demain matin, je pars pour Madrid et ce serait bien le diable si je n’arrive pas à mettre la main sur lui. N’oubliez pas que j’ai besoin de ses connaissances. C’est d’ailleurs l’unique raison pour laquelle je ne lui taperai pas dessus.
– L’auriez-vous fait, sinon ?
– Comment réagirait un Espagnol dans le même cas, à votre avis ?
– Oh, avec violence, je le crains.
– Nous autres Vénitiens sommes aussi sensibles, mais je vous promets d’être des plus aimable.
Ce qu’il n’ajouta pas, c’est qu’une idée bizarre lui venait à l’esprit. Et si par hasard le voleur n’était autre que « don Basile » ?
Ils arrivaient dans le grand patio où attendait le majordome chargé de raccompagner le visiteur à sa voiture. Aldo s’inclina :
– Je suis à jamais votre esclave, dona Ana ! Je saurai, désormais, à quoi ressemble un ange gardien.
– La vérité a parfois bien du mal à se frayer un chemin vers la lumière. C’est un devoir d’état de l’y aider… et puis, pour être tout à fait franche, je me trouverai assez satisfaite d’être privée du portrait si son absence me débarrasse des visites de la Susana. Je… je ne l’apprécie guère !
En arrivant sur la place de l’ancienne Puerta de Jerez au fond de laquelle s’élevait l’Andalucia Palace, Morosini aperçut soudain, sous un vieux chapeau de paille, une souquenille d’un rouge déteint qu’il crut reconnaître et qui avait l’air de tourner en rond. Aussitôt il fit arrêter sa calèche, paya et descendit avec l’idée que le mendiant le guettait peut-être. Il ne se trompait pas : à peine l’eut-il aperçu que Diego Ramirez lui adressa un signe discret l’invitant à le suivre.
L’un derrière l’autre, les deux hommes gagnèrent un vénérable bâtiment dont la façade baroque s’ornait de magnifiques azulejos. C’était l’hospice de la Caridad, fondé au XVI esiècle par la confrérie du même nom pour donner un asile aux miséreux et une sépulture aux suppliciés dont les corps abandonnés pourrissaient jadis à la face du ciel. L’un des bienfaiteurs principaux en avait été ion Miguel de Manara dont la vie dissolue devait servir de modèle à don Juan. Y voir entrer un mendiant n’avait rien d’étonnant, et pas davantage un homme élégant puisque les religieuses en charge de l’hospice recevaient souvent des dons et des visites de la haute société sévillane. Les deux hommes se rendirent dans la chapelle qui fermait tard le soir. Sachant que l’étrange bonhomme était juif, Morosini s’étonna un peu de le voir entrer dans une église, mais Ramirez n’alla pas vers les autels. Il se contenta de se planter, à droite de la grande porte, devant la terrible peinture de Valdès Leal, chef-d’œuvre du réalisme espagnol, dont Murillo prétendait qu’on ne pouvait le regarder qu’en se bouchant le nez. Il représentait un évêque et un chevalier morts, dans leurs cercueils à demi ouverts et envahis par les vers…
– Vous auriez pu trouver autre chose ! murmura Morosini en s’arrêtant auprès de lui.
– Pourquoi donc ? Pour tous mes semblables cette peinture est un réconfort, mais c’est d’un autre tableau que je veux vous parler.
– Celui qui a été volé à la Casa de Pilatos. Je suis au courant. On m’a même accusé du vol.
– C’était une grave erreur. Je sais qui l’a pris. Aldo considéra son voisin avec une surprise qui touchait à l’admiration.
– Comment pouvez-vous savoir cela ?
– Nous autres les mendiants sommes partout, autour des églises, de la plaza de Toros les jours de corrida, près des maisons riches quand on y donne une fête. Il m’a suffi de chercher, d’interroger…
– Et alors ?
– C’était vers deux heures du matin. La fête n’était pas finie, mais la Reine se retirait : les invités et la maisonnée se pressaient autour d’elle mais les mendiants, eux, se tenaient plutôt dans la rue derrière le mur du Petit Jardin où deux ou trois domestiques leur faisaient passer de la nourriture : il y en a toujours à foison quand on reçoit à la Casa de Pilatos et ils espèrent obtenir d’autres services en échange. Or, cette nuit-là, d’après Gomez, le mendiant de San Esteban qui est l’église voisine, il y a eu un paquet pas comme les autres : pas très grand mais rectangulaire et plutôt plat. Intrigué, Gomez a suivi l’homme qui le recevait. Celui-là n’a pas attendu le partage : il s’est sauvé comme si le diable était à ses trousses.
– Et où est-il allé ?
– Dans une vieille maison noble près de la plaza de la Encarnacion. Elle appartient à un vieux hibou un peu gâteux dont le frère a été chambellan chez la Reine mère…
– Il ne s’appellerait pas Fuente Salida, le chambellan ?
– Je crois que c’est ça…
– Il avait donc la meilleure des raisons de diriger les recherches de la police de mon côté : c’est lui qui a fait voler le tableau et je suppose qu’à l’heure actuelle le portrait roule avec lui dans le train royal et direction de Madrid. Vous venez de me rendre un service inappréciable…
– Oh, il y a toujours un prix à quelque chose ! fit le mendiant avec modestie…
Morosini saisit l’allusion, tira quelques billets de son portefeuille et les fourra dans une main qui n’était pas bien loin.
– Encore un mot : pourquoi avez-vous entrepris ces recherches ? A cause de moi ?
Diego Ramirez devint tout à coup extrêmement grave :
– Un peu sans doute mais surtout parce que, dans la nuit qui a suivi notre rendez-vous, j’ai entendu pleurer Catalina.
– Dites-lui d’être patiente ! Je retrouverai le rubis et il retournera aux enfants d’Israël. Ce jour-là je reviendrai. Dieu vous garde, Diego Ramirez !
– Dieu vous garde, señor principe !
Ce fut une fois dehors que Morosini se demanda comment le mendiant pouvait connaître son titre, mais il ne s’y attarda pas : comme Simon Aronov lui-même, ce diable d’homme semblait posséder un service de renseignements fonctionnant à merveille…
CHAPITRE 3 LA NUIT DE TORDESILLAS
À Madrid, comme à Paris ou à Londres, Aldo Morosini ne connaissait qu’un hôtel : le Ritz. Il avait adopté ces palaces fondés par un Suisse génial dont il appréciait le style, l’élégance, la cuisine, la cave et un certain art de vivre qui, teinté différemment selon la ville, n’en établissait pas moins un lien certain entre les trois établissements et permettait au voyageur, même très difficile, de s’y sentir toujours chez lui.
Cette fois, cependant, il n’y resta que vingt-quatre heures : juste le temps d’obtenir du portier l’adresse du palais de la reine Marie-Christine, ex-archiduchesse d’Autriche, de s’y rendre pour s’enquérir du marquis de Fuente Salida et d’apprendre que celui-ci n’avait fait que toucher terre dans la résidence royale où l’attendait un télégramme l’appelant à Tordesillas. Son épouse était souffrante.
Ce fut une surprise pour Aldo qui n’imaginait pas que ce vieux forban amoureux d’une reine morte depuis bientôt cinq siècles fût pourvu d’une femme, mais la dame d’honneur asthmatique et boiteuse qui avait reçu le Vénitien assura, les yeux au ciel, qu’il s’agissait là d’un des meilleurs ménages bénis par le Seigneur Dieu. Elle n’en oublia pas pour autant de demander la raison pour laquelle un seigneur étranger souhaitait rencontrer le personnage le plus xénophobe du royaume. Mais la réponse était toute prête : on souhaitait l’entretenir d’un fait nouveau, un détail découvert par un historien français touchant le séjour effectué par la reine Jeanne et son époux, chez le roi Louis XII à Amboise en l’an de grâce 1501.
L’effet fut miraculeux. Un instant plus tard Aldo se retrouvait dehors avec l’adresse et des souhaits de bon voyage. Il n’eut plus qu’à s’en aller consulter l’annuaire des chemins de fer et retenir une place sur le train de Medina del Campo, où par la ligne de Salamanque à Valladolid, il finirait par débarquer à Tordesillas. Ce qui, avec des horaires fantaisistes, représentait un voyage au long cours pour même pas deux cents kilomètres.
Le trajet à travers les déserts de sable et de granit de la Vieille Castille fut monotone. Il faisait déjà très chaud et le ciel d’un bleu chauffé à blanc s’étendait, écrasant les villages soumis et les petits chemins qui semblaient errer à la recherche des quelques maisons dispersées dans les vallées et les hauteurs d’une sierra déprimante. En arrivant à Tordesillas après avoir essuyé le plus lourd de la température, Morosini, couvert de poussière et d’escarbilles, se sentait sale et de mauvaise humeur. Il fallait qu’il eût vraiment besoin des connaissances de ce vieux fou pour le suivre jusqu’à cette petite ville morose étalée sur sa colline dominant le Douro. Il n’y restait rien du sombre château où, durant quarante-six ans, une reine d’Espagne, séquestrée par la volonté d’un père impitoyable puis d’un fils qui l’était encore plus, avait vécu le long cauchemar alterné du désespoir et de la folie… Les descendants avaient préféré abattre ce témoin de pierre.
C’était regrettable pour le tourisme. La présence du château aurait attiré les foules et justifié l’existence d’un hôtel convenable dans cette petite ville de quatre ou cinq mille habitants. Celui qui reçut Aldo n’était même pas digne d’un chef-lieu de canton français : l’arrivant y trouva une sorte de cellule monacale blanchie à la chaux et des relents d’huile rance qui ne plaidaient guère en faveur de la cuisine-maison. Pas question de s’attarder dans ces conditions ! Il fallait voir Fuente Salida et le voir vite !
Aussi, profitant de la fraîcheur qu’apportait le déclin du soleil, Morosini prit-il juste le temps d’une toilette rapide, se renseigna sur l’église auprès de laquelle habitait son gibier et partit d’un pas allègre par les ruelles que l’approche du crépuscule ranimait.
Il n’eut pas de peine à trouver ce qu’il cherchait : c’était une grosse maison carrée, mi-forteresse mi-couvent, dont les rares fenêtres s’armaient de fortes grilles en saillie propres à décourager tout visiteur intempestif. Au-dessus de la porte cintrée, plusieurs blasons plus ou moins usés semblaient se bousculer. Cette citadelle-là ne serait pas facile à investir… et pourtant il fallait entrer ! Car si Fuente Salida s’était emparé du portrait, celui-ci ne pouvait se trouver que dans cette maison. Le difficile était de s’en assurer…
Le bel enthousiasme de tout à l’heure ayant laissé place à quelque réflexion, Aldo décida d’user d’un stratagème pour se faire ouvrir cette porte trop bien fermée. Assurant son chapeau sur sa tête, il s’en alla soulever le lourd heurtoir de bronze qui, en retombant, rendit un son tellement caverneux que le visiteur se demanda un instant si cette bicoque n’était pas vide. Mais non, au bout d’un instant il entendit un pas feutré glisser sur ce qui devait être un sol dallé.
Les gonds devaient être bien graissés car la porte s’entrouvrit sans faire le bruit d’apocalypse auquel Morosini s’attendait. Étroit, ridé, un visage de femme qui aurait pu être peint par le Greco apparut entre une coiffe noire et un tablier blanc annonçant une servante. Elle considéra un instant l’étranger avant de demander ce qu’il voulait. Rassemblant son meilleur espagnol, Aldo annonça qu’il désirait voir « el señor marquès »… de la part de la Reine. Du coup, la porte s’ouvrit toute grande et la femme plongea dans une espèce de révérence tandis que Morosini avait l’impression de changer de siècle. Cette maison devait dater au moins des Rois Catholiques et le décor intérieur n’avait pas dû beaucoup changer depuis. On le laissa dans une salle basse – il avait dû descendre deux marches pour y pénétrer – dont la voûte était soutenue par de lourds piliers. Hormis deux bancs à dossier en chêne noir qui se faisaient face d’un mur à l’autre, il n’y avait aucun meuble. Et Morosini tout à coup eut froid, comme il arrive en pénétrant dans certains parloirs de couvent particulièrement austères.
La femme revint un instant plus tard. « Don Basile » l’accompagnait, mais son sourire empressé se changea en une horrible grimace quand il reconnut l’arrivant :
– Vous ? De la part de la Reine ? … C’est une trahison : sortez 1
– Pas question ! Je n’ai pas fait tout ce chemin par une chaleur de four pour le simple plaisir de vous saluer. J’ai à vous parler… et de choses importantes. Quant à la Reine, vous savez très bien que nous sommes dans les meilleurs termes : la marquise de Las Marismas qui m’a donné votre adresse pourrait vous l’assurer.
– On ne vous a pas mis en prison ?
– Ce n’est pourtant pas faute d’avoir fait ce qu’il fallait pour m’y envoyer… Mais ne pourrions nous parler dans un endroit plus aimable ? Et surtout seul à seul ?
– Venez ! fit l’autre de mauvaise grâce après avoir renvoyé la servante d’un signe.
Si le vestibule était d’une rigueur monacale, ce n’était pas le cas de la salle d’honneur où l’on introduisit le visiteur. Fuente Salida en avait fait une sorte de sanctuaire à la mémoire de sa princesse : entre les étendards de Castille, d’Aragon, ceux des différentes provinces dont se composait l’Espagne et des trois ordres de chevalerie, une haute cathèdre en bois sculpté était disposée sur une estrade à trois marches et sous un dais tendu de tissu aux couleurs royales. Un portrait de Jeanne – simple gravure en noir et blanc – était accroché au-dessus de ce trône improvisé. Sur le mur d’en face, fait de moellons que l’on n’avait pas jugé utile de recouvrir d’un crépi ou d’un lait de chaux, un grand crucifix d’ébène étendait ses bras décharnés et, de chaque côté de la salle, une file d’escabeaux était disposée de façon symétrique, chacun sous l’écu du noble censé prendre place aux jours de Grand Conseil. L’ensemble était assez impressionnant, d’autant que, traversant la pièce pour atteindre une autre porte, le marquis mit brièvement genou en terre devant le trône. Courtoisement, Morosini fit de même, ce qui lui valut le premier regard approbateur de son hôte.
– Ce siège, expliqua celui-ci, n’a pas été choisi au hasard. « Elle » s’y est assise. Il vient de la Casa del Cordon, à Burgos, et c’est peut-être mon plus cher trésor ! Passons dans mon cabinet !
Le mot de capharnaüm était ce qui correspondait le mieux à la pièce étroite, étouffante en dépit de la fenêtre ouverte sur un ciel pâlissant et les rumeurs du soir. Aux environs d’une table de bois ciré à pieds forgés couverte de papiers et d’un bric-à-brac de plumes, de crayons et d’objets sans destination apparente, les livres empilés à même le sol carrelé rendaient la circulation difficile. Le marquis en tira un escabeau qu’il offrit à son visiteur avant de gagner son propre fauteuil à gros clous de bronze tendu d’un cuir qui avait dû être rouge. Une belle pièce, d’ailleurs, pour l’œil exercé de l’antiquaire, et qui devait être aussi vieille que la maison elle-même. C’était en tout cas une base solide sur laquelle son propriétaire se sentait stable, comme en témoignaient ses mains fermement posées sur les bras. Le regard, maintenant, avait perdu toute aménité :
– Bien. Causons, puisque vous semblez y tenir, mais causons vite ! Je n’ai pas beaucoup de temps à vous consacrer…
– Je n’en prendrai que ce qu’il faudra. Sachez d’abord que, si je suis libre aujourd’hui c’est parce que la preuve a été faite de mon innocence…
– J’aimerais savoir par qui, ricana « don Basile ».
– Par la duchesse de Medinaceli en personne sur le témoignage de sa secrétaire. Je comprends qu’il vous ait paru commode de faire de moi votre bouc émissaire, malheureusement c’est raté !
– Eh bien, j’en suis ravi pour vous. Et c’est pour me dire ça que vous avez fait le voyage ?
– En partie, mais surtout pour vous proposer un arrangement.
Fuente Salida sauta sur ses pieds comme si son siège était pourvu d’un ressort :
– Sachez, monsieur, que ce mot ne saurait avoir cours chez moi. On ne prend pas d’ »arrangements » avec un marquis de Fuente Salida ! Je ne suis pas un marchand, moi !
– Vous êtes seulement un acquéreur d’un modèle un peu particulier. Quant à la transaction que je vous propose – ce mot vous conviendra peut-être mieux ? – vous verrez que, dans un instant, vous allez la trouver intéressante.
– Cela m’étonnerait tellement que je vais vous prier de vous retirer !
– Oh, pas avant de m’avoir entendu ! Vous permettez que je fume ? C’est une habitude déplorable, sans doute, mais grâce à laquelle mon cerveau fonctionne mieux ; mes idées sont plus claires…
Sans attendre la permission, il tira de sa poche son étui d’or gravé à ses armes, y prit un mince rouleau de tabac après l’avoir offert à son hôte qui, raide d’indignation muette, refusa d’un bref signe de tête. Il alluma tranquillement, aspira une ou deux bouffées puis, croisant ses longues jambes en prenant grand soin du pli de son pantalon, il déclara :
– Quoi que vous en pensiez, l’idée de posséder le portrait en question ne m’a jamais effleuré. En revanche, je donnerais cher pour savoir ce qu’est devenu l’admirable rubis que la Reine porte au cou. Si quelqu’un peut m’en apprendre davantage, c’est vous et vous seul puisque, si votre légende est vraie, personne au monde n’en sait plus que vous sur cette malheureuse souveraine qui ne régna jamais.
– Et pourquoi cette pierre-là et pas une autre ?
– Vous êtes collectionneur et je le suis aussi. Vous devriez comprendre à demi-mot mais je vais être plus explicite : ce rubis-là, dont j’ai tout lieu de croire qu’il est celui que je cherche, est une pierre maudite, une pierre malfaisante dont le pouvoir maléfique ne peut prendre fin que lorsqu’elle sera rendue à son légitime propriétaire.
– Qui est Sa Majesté le Roi, bien entendu !
– En aucune façon et vous le savez très bien, ou alors dites-moi que vous ignorez à qui appartenait ce cabochon avant d’être offert à Isabelle la Catholique qui, elle-même, l’a donné à sa fille au moment de son mariage avec Philippe le Beau ?
Les yeux du vieil homme se mirent à brasiller de tous les feux de la haine :
– Ce pourceau ! Ce Flamand qui n’a su prendre la plus belle perle de l’Espagne que pour l’avilir et la briser…
– Je ne vous dirai pas le contraire. De votre côté, admettez que la possession de ce merveilleux rubis n’a guère porté chance à votre reine ?
– Il se peut que vous ayez raison mais je n’ai pas la moindre envie d’évoquer pour vous cette histoire. On n’évoque bien ceux que l’on vénère qu’avec des gens auprès de qui on se sent en intelligence. Ce n’est pas votre cas et vous n’êtes même pas Espagnol !
– Personnellement je ne le regrette pas et il faudra vous y faire. Mais puisque vous ne semblez pas m’entendre, je vais parler plus net : c’est vous qui avez volé le portrait ou qui l’avez fait voler par un serviteur qui l’a passé par-dessus le mur du jardin à un complice déguisé en mendiant, lequel s’est hâté de le porter chez monsieur votre frère… Vous ne vous sentez pas bien ?
C’était pour le moins une litote. Devenu d’un beau violet pourpré, le marquis semblait sur le point d’étouffer. Mais, voyant que Morosini s’élançait pour lui porter secours, il étendit pour s’en protéger un long bras maigre en glapissant :
– C’en est trop ! A… allez-vous-en ! Sortez d’ici !
– Tenez-vous tranquille, s’il vous plaît ! Je ne suis pas ici pour vous juger, moins encore pour vous arracher le portrait. Je ne vous demande même pas d’avouer votre larcin et je vous donne ma parole de n’en parler à personne si vous me donnez ce que je suis venu chercher…
Peu à peu Fuente Salida retrouvait sa couleur normale,
– Je vous croyais ami de dona Ana ?
– Nous le sommes devenus depuis qu’elle s’est interposée entre un déni de justice et moi. Cela dit, qu’elle retrouve ou non son tableau m’est tout à fait indifférent. Et je ne suis pas certain d’ailleurs qu’elle y tienne tellement…
– Vous plaisantez ?
– Pas le moins du monde. Le portrait valait de curieuses visites nocturnes et annuelles à la Casa de Pilatos. Et à ce propos, autant vous prévenir tout de suite : vous risquez d’en hériter.
Le marquis haussa ses maigres épaules :
– S’il s’agit d’un fantôme, sachez que je ne les crains pas. Il y en a déjà un dans cette maison.
Morosini nota mentalement que c’était là une manière d’aveu et se contenta de l’enregistrer. En revanche, son sourire s’accentua dans l’espoir d’être plus persuasif :
– Alors, vous acceptez de me parler du rubis ? Le vieux seigneur n’hésita qu’à peine, se laissant aller sur le dossier de son fauteuil, il s’y accouda, ses mains jointes par le bout des doigts.
– Après tout, pourquoi pas ? Mais je vous préviens : je ne sais pas tout. Ainsi, j’ignore où la pierre peut se trouver à l’heure actuelle. Peut-être irrémédiablement perdue ?
– Ce genre de recherche fait partie de mon métier, fit Aldo avec gravité. J’ajoute cependant que j’y prends plaisir. L’Histoire a toujours été pour moi un jardin étrange et fascinant où l’on risque parfois sa vie à se promener mais qui sait vous récompenser par des joies extraordinaires.
– Je commence à croire qu’il pourrait nous arriver d’être d’accord, fit le vieil homme d’un ton soudain radouci. Ainsi que vous le savez déjà, la reine Isabelle a offert cette magnifique pierre, montée comme vous avez pu le voir sur le portrait, à sa fille Juana au moment où, à Laredo, elle s’embarquait pour rejoindre les Pays-Bas où l’attendait l’époux choisi pour elle. C’était un beau mariage, même pour une infante : Philippe d’Autriche, descendant par sa mère des grands ducs de Bourgogne que l’on appelait les grands ducs d’Occident, était fils de l’empereur Maximilien. Il était jeune, on le disait beau… Jeanne croyait bien partir vers le bonheur. Le bonheur ! Est-ce que cette consolation des gens de rien peut exister quand on est princesse ! En fait, il s’agissait d’un double mariage puisque la princesse Marguerite, sœur de Philippe, épousait en cette même année 1496 le frère aîné de Jeanne, l’héritier du trône d’Espagne, et les navires portant l’infante devaient ramener la fiancée royale…








