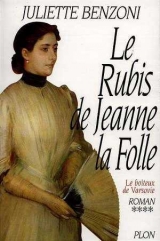
Текст книги "Le rubis de Jeanne la Folle"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
– Il y a ici une partie des bijoux de la Grande Catherine et quelques bijoux russes.
Entre ses mains, une boîte habillée de velours violet révéla un extraordinaire collier de diamants, une paire de girandoles et deux bracelets. Morosini ouvrit de grands yeux : cette parure, il la connaissait pour l’avoir admirée avant la guerre sur la gorge d’une grande-duchesse apparentée à la famille impériale et dont la disparition soudaine laissait supposer qu’elle avait pu être assassinée. Elle avait bien appartenu à la Sémiramis du Nord, mais Aldo lui refusa son admiration : il avait horreur de ce que l’on appelait dans la profession « bijoux rouges » : ceux que l’on s’était procurés en versant le sang. Il ne put s’empêcher de lâcher avec sévérité :
– Comment vous êtes-vous procuré cette parure ? Je sais à qui elle appartenait avant la guerre et…
– … et vous vous demandez si je l’ai achetée au meurtrier de la grande duchesse Natacha ? Rassurez-vous, c’est elle-même qui me l’a vendue… avant de disparaître en Amérique du Sud avec son maître d’hôtel dont elle était tombée follement amoureuse. Je vous livre là un secret mais je pense que vous ne me ferez pas regretter de vous avoir montré ces joyaux.
– Vous pouvez en être certain. Vous devez savoir que notre secret professionnel est aussi exigeant que celui des médecins…
– J’avoue, fit Kledermann en riant, qu’en dépit de votre réputation je n’imaginais pas un instant que vous les reconnaîtriez. Cela dit, la grande-duchesse a eu tout à fait raison de filer en Amérique avant la révolution bolchevique. Elle a au moins sauvé sa vie et une partie de sa fortune…
Après les diamants, Morosini put admirer la fameuse parure d’améthystes, célèbre dans l’étroite confrérie des grands collectionneurs, et quelques autres babioles de moindre importance avant de passer à l’exploration d’autres coffres, d’autres écrins. Il vit l’admirable émeraude ayant appartenu au dernier empereur aztèque et rapportée du Mexique par Hernan Cortes, deux des dix-huit « Mazarins », un bracelet fait de gros diamants provenant du fameux Collier de la Reine, jadis dépecé et vendu en Angleterre par le couple La Motte, de très beaux saphirs ayant appartenu à la reine Hortense, les nœuds de corsage en diamants de la Du Barry de fantastiques émeraudes qui avaient brillé sur la poitrine d’Aurengzeb, l’un des sautoirs de perles de la Reine vierge et tant d’autres merveilles qu’Aldo ébloui et surtout sidéré contemplait avec émerveillement : il n’imaginait pas que la collection Kledermann pût atteindre cette importance. Encore l’un des coffres garda-t-il ses secrets :
– Ce sont les bijoux de ma femme, fit le banquier. Ils sont tellement plus beaux lorsqu’elle les porte… Mais vous semblez surpris ?
– Je l’avoue. Je ne connais guère au monde que trois collections susceptibles de s’aligner avec la vôtre…
– J’avoue m’être donné beaucoup de mal mais le mérite n’en revient pas à moi seul. Mon grand-père et mon père ont commencé ceci bien avant moi… Maintenant, voici ce que j’ai acheté à cet Américain.
Il venait d’ouvrir un nouvel écrin de velours noir : tel l’œil d’un cyclope rougi au feu des forges infernales, le rubis de Jeanne la Folle regarda Morosini.
Celui-ci le prit à deux doigts et n’eut pas besoin d’un grand examen pour s’assurer que c’était bien la pierre qu’il avait eu tant de peine à trouver :
– Aucun doute ! dit-il. C’est bien le bijou qui m’a été volé à Prague…
Pour plus de sûreté – une contrefaçon étant toujours possible encore qu’improbable ! – il repassa dans le bureau, tira de sa poche une loupe de joaillier, la logea dans son orbite et se pencha sous la lumière de la grande lampe moderne posée sur la table. Inquiet, Kledermann se hâta de refermer la chambre aux trésors et le rejoignit :
– Tenez ! dit Aldo en indiquant de l’ongle un point minuscule sur le revers de la pierre et en offrant sa loupe au banquier. Voyez cette étoile de Salomon imperceptible à l’œil nu ! Elle vous confirmera qu’il s’agit bien d’un joyau d’origine juive…
Kledermann fit ce qu’on lui demandait et fut bien obligé d’accepter une évidence qui lui déplaisait. Il ne dit rien sur le moment, posa l’écrin sur le cuir vert foncé de son bureau, y remit le rubis, puis sonna et alla rouvrir sa porte :
– Prendrez-vous encore un peu de café ? J’avoue en avoir besoin.
– Vous ne craignez pas l’insomnie ? fit Aldo avec un demi-sourire…
– Je possède la faculté de dormir quand j’en ai envie. Mais que faites-vous donc ?
Morosini avait sorti un carnet de chèques et un stylo emportés très intentionnellement, et écrivait sur le coin de la table :
– Un chèque de cent mille dollars, répondit-il avec le plus grand calme.
– Je ne crois pas avoir dit que j’acceptais de vous rendre ce bijou, articula le banquier avec une froideur polaire qui n’impressionna guère Morosini.
– Je ne vois pas comment vous pourriez faire autrement ! riposta-t-il. Nous parlions il y a un instant de « bijoux rouges ». Celui-ci l’est plus que tout ce que vous pouvez imaginer…
Kledermann haussa les épaules :
– Il ne saurait en être autrement pour une pièce chargée d’histoire. Puis-je vous rappeler la Rose d’York, ce diamant du Téméraire qui nous a rapprochés à Londres ? Vous la convoitiez autant que moi et vous vous souciiez comme d’une guigne de son passé tragique.
– Sans doute, mais ce n’était pas moi qui l’avais découverte au risque de ma vie… Cette fois, c’est différent ! Enfin, réfléchissez ! ajouta Morosini. Vous avez vraiment envie de voir briller sur la gorge de votre femme une pierre qui a passé des dizaines d’années sur un cadavre ? Cela ne vous fait pas horreur ?
– Vous avez le sens des évocations désagréables, grogna le banquier, mais autant vous le dire tout de suite : maintenant que je connais les aventures de ce rubis, je ne souhaite plus du tout l’offrir à ma femme. Elle aura pour son anniversaire le collier que vous avez apporté… et moi je garderai cette merveille…
Aldo n’eut pas le temps de répondre : rejetant la porte plus qu’elle ne l’ouvrit, Dianora, dispensant autour d’elle la fraîcheur de la nuit jointe aux senteurs suaves d’un parfum précieux, fit une entrée de reine tumultueuse :
– Bonsoir, cher ! lança-t-elle de sa belle voix de contralto. Albrecht me dit que vous avez ici le prince Morosini… et c’est ma foi vrai ! Quel plaisir de vous revoir, cher ami !
Tendant ses deux mains dégantées, elle s’élançait vers Aldo quand, soudain, elle s’arrêta et obliqua résolument vers la droite :
– Qu’est-ce là ? … Oh Dieu ! … Quelle splendeur !
Rejetant l’ample manteau ourlé de renard bleu assorti à la toque posée sur ses cheveux de lin, elle le laissa tomber sur le tapis comme un simple papier froissé et se précipita sur le rubis qu’elle saisit avant que son époux ait pu l’en empêcher.
Son visage rayonnait de joie. La pierre entre les mains, elle revint vers Kledermann.
– Moritz très cher ! Vous n’avez jamais hésité à remuer ciel et terre pour me faire plaisir, mais cette fois vous me comblez. Où avez-vous trouvé ce merveilleux rubis ?
Elle avait oublié Aldo mais celui-ci n’était pas disposé à se laisser évincer : l’enjeu était trop gros.
– C’est moi qui l’ai trouvé à l’origine, Madame. Votre époux n’a fait que l’acheter, en toute innocence d’ailleurs, à celui qui me l’a volé. Aussi m’apprêtais-je à le rembourser, ajouta-t-il en détachant le chèque de sa souche.
Dianora tourna vers lui ses yeux transparents qu’une brusque colère traversait d’éclairs :
– Êtes-vous en train de me dire que vous prétendez emporter « mon » rubis ?
– Je ne prétends qu’obtenir justice. La pierre n’est même pas à moi. Je l’avais achetée pour un client…
– Il n’y a pas de client qui tienne lorsqu’il s’agit de moi, fit la jeune femme avec arrogance. D’autant qu’il n’est pas certain que vous disiez la vérité ? On n’en est pas à un mensonge près, quand on est collectionneur comme vous.
– Calmez-vous, Dianora ! intervint Kledermann. Nous étions justement en train de discuter la question quand vous êtes arrivée. Non seulement je n’avais pas accepté le chèque du prince, mais j’entendais lui en offrir un pour le dédommager de ce qu’il a subi du fait d’un voleur…
– Tout cela m’a l’air bien compliqué. Répondez-moi franchement, Moritz ! Avez-vous, oui ou non, acheté ce bijou pour mon anniversaire ?
– Oui, mais…
– Pas de mais ! Il est donc à moi et je le garde ! Je le ferai monter à mon idée…
– Vous devriez, intervint Aldo, laisser votre mari développer ce « mais » ! Il en vaut la peine : l’homme qui lui a vendu la pierre vient d’être retrouvé dans le lac… étranglé. J’ajoute qu’il m’avait logé une balle pas loin du cœur, il y a trois mois.
– Mon Dieu… mais comme c’est excitant ! Raison de plus pour y tenir !
Et Dianora éclata de rire au nez de Morosini qui se demanda comment il avait pu manquer mourir d’amour pour cette folle. Tant de beauté et pas plus de cervelle qu’un petit pois ! songea-t-il en regardant la jeune femme voltiger à travers le cabinet de son époux. Les années glissaient sur elle comme une eau vivifiante. En surimpression de son image actuelle, il la revoyait telle qu’elle lui était apparue un soir de Noël chez lady de Grey. Une fée nordique ! Une sylphide des neiges dans l’enroulement givré de sa robe couleur de glacier qui épousait si tendrement chaque courbe d’un corps juvénile aussi ravissant que le visage ! … Il l’avait revue par deux fois : à Varsovie où tous deux avaient retrouvé pour une nuit les folles délices d’autrefois et au mariage d’Eric Ferrals avec Anielka Solmanska. À cette occasion, il n’était pas retombé au pouvoir de son charme. Uniquement d’ailleurs parce qu’il était prisonnier de celui de la jolie Polonaise ! Ce soir, il ne pouvait s’empêcher de penser qu’elles se ressemblaient de singulière façon.
Comme Anielka, Dianora sacrifiait à la nouvelle mode, au moins dans sa façon de se vêtir car elle avait gardé entière sa magnifique chevelure de soie pâle – peut-être pour ne pas déplaire à un mari si fastueux ? – mais sa robe de fin lainage d’un gris bleuté découvrait jusqu’au-dessus du genou des jambes parfaites et laissait deviner la grâce du corps, toujours aussi mince et libre de toute entrave, qu’elle recouvrait… Pour l’instant, elle glissait son bras sous celui de son époux en le regardant avec une tendre supplication. Quant à lui, si jamais visage avait exprimé la passion c’était bien celui de cet homme d’aspect si sévère et si froid. Peut-être restait-il là une carte à jouer ?
– Soyez raisonnable, Madame ! dit Morosini doucement. Quel mari amoureux pourrait accepter de gaieté de cœur de voir celle qu’il aime en danger ? Et ce sera votre cas si vous vous obstinez à garder ce redoutable caillou.
Toujours pendue au bras de Kledermann et le regard perdu dans le sien, elle haussa les épaules :
– Qu’importe ! Mon époux est assez fort, assez puissant et assez riche pour me préserver de tout danger. Vous perdez votre temps, cher Morosini ! Jamais, vous entendez, jamais je ne vous rendrai ce bijou ! Je suis sûre que pour moi, il sera un vrai talisman de bonheur.
– Fort bien ! Vous venez de remporter cette bataille, Madame, mais je ne désespère pas de gagner la guerre. Gardez le rubis, mais, je vous en supplie, réfléchissez ! Je n’ai pas pour habitude de jouer les épouvantails, pourtant vous devez savoir qu’en le conservant c’est le malheur que vous allez attirer. Je vous souhaite une bonne nuit ! … Ne me raccompagnez pas, ajouta-t-il à l’adresse de Kledermann. Je connais le chemin et je compte rentrer à mon hôtel à pied !
Kledermann se mit à rire et, lâchant sa femme, rejoignit son invité rebelle :
– Vous savez qu’il y a plusieurs kilomètres ? Et en souliers vernis ce n’est pas le comble du confort. Ne soyez pas mauvais perdant, mon cher prince, et permettez à mon chauffeur de vous raccompagner. Ou alors laissez-moi vous prêter des brodequins ?
– Vous êtes décidé à ne me laisser l’initiative en rien, ce soir ? fit Aldo avec un sourire qui n’alla pas jusqu’à Dianora. Va pour la voiture. J’opterais bien pour les grosses chaussures, mais je craindrais l’œil réprobateur du portier du Baur !
La pluie avait cessé quand la longue voiture glissa à travers le jardin mouillé. Le ciel s’éclaircissait mais une froide humidité montait des eaux noires du lac et, tout au long de la route ramenant vers le centre de la ville, on roulait dans de larges flaques où frissonnait la lumière inversée des réverbères. Il était déjà tard et, le mauvais temps aidant, les rues étaient désertes. Zurich était triste, ce soir, en dépit de ses brillants éclairages et Aldo envoya une pensée reconnaissante à Kledermann : une longue promenade dans ce désert dégoulinant n’aurait rien eu d’agréable ! Au fond, il serait aussi bien dans son lit pour réfléchir au problème tel que le posait à présent le couple Kledermann. Il ne voyait pas comment il allait pouvoir s’en sortir. Même avec l’aide d’Adalbert. À moins de se livrer à un cambriolage en règle du palais Kledermann ? …
Il y pensait encore en empruntant le large couloir feutré d’épaisse moquette, menant à sa chambre. Il enfonça sa clé dans la serrure… et oublia ses préoccupations : un coup sur la nuque, et il s’écroulait comme un vêtement abandonné sur le moelleux tapis qui étouffa le bruit de sa chute…
Quand il se réveilla, il était couché sur un petit lit de fer dans une pièce si tristement meublée qu’un trappiste n’en aurait pas voulu. Une lampe à pétrole posée sur une table éclairait des murs fendus et salpêtrés. Tout d’abord il se crut l’objet d’un cauchemar, mais sa bouche pâteuse et son crâne douloureux plaidaient pour une désagréable réalité, sans qu’il parvienne à comprendre ce qui lui arrivait. Ses idées en se remettant en place lui restituaient ses derniers gestes conscients : il se voyait devant sa porte, introduisant sa clé. Puis le trou noir. La question, alors, était celle-ci : comment avait-il pu passer des couloirs d’un palace international à cette cave mal entretenue ? Était-il seulement pensable que ses agresseurs eussent réussi, même en pleine nuit, à le sortir de là et à l’emmener ailleurs ?
Chose plus curieuse encore, il était libre de ses mouvements : on ne l’avait pas attaché. Alors il se leva, alla vers l’unique fenêtre, étroite et défendue par des volets solidement cadenassés. Quant à la porte, vétuste, sans doute, elle était dotée d’une serrure neuve contre laquelle Aldo s’avoua impuissant. Il ne possédait pas les talents de son ami Adalbert et le regretta :
– Si on se revoit un jour je lui demanderai des leçons ! marmotta-t-il en s’étendant de nouveau sur le matelas nu qui semblait rembourré avec des cailloux. Quelqu’un viendra bien un jour et, en attendant, mieux vaut prendre mon mal en patience…
Il n’attendit pas longtemps. Une dizaine de minutes à sa montre – on ne lui avait rien pris – et la porte s’ouvrait pour laisser passer une sorte de batracien dont la ressemblance avec un crapaud, aux pustules près, était frappante. Derrière lui venait un homme dont la vue arracha au prisonnier une exclamation de surprise. Il s’agissait d’un personnage qu’il n’aurait jamais cru revoir en cette vie pour l’excellente raison qu’il le supposait au fond d’une prison française ou dûment extradé en direction de Sing-Sing : Ulrich, l’Américain qu’il avait rencontré dans une villa du Vésinet au cours d’une nuit agitée deux ans plus tôt. Loin de l’inquiéter, cette résurrection l’amusa : mieux valait avoir affaire à quelqu’un qu’il connaissait déjà.
– Encore vous ? fit-il avec bonne humeur. Auriez-vous été nommé ambassadeur des gangsters américains en Europe ? Je vous croyais en prison ?
– En sortir ou y rester, c’est souvent une question d’argent, fit la voix froide et coupante dont Aldo gardait le souvenir. Les Français ont eu le tort de vouloir me transférer aux States : j’en ai profité pour prendre le large mais pas celui de l’Atlantique. Sors, Archie, mais ne t’éloigne pas !
Ulrich alla établir son long corps osseux habillé de tweed bien coupé sur l’unique chaise, laissant à Morosini l’entière disposition de son lit. Celui-ci bâilla, s’étira puis se recoucha aussi tranquillement que s’il eût été chez lui :
– Je n’ai rien contre une conversation à cœur ouvert avec vous, mon cher, mais nous aurions pu causer aussi bien à l’hôtel où vous semblez avoir vos petites entrées ? On est très mal chez vous.
– Ce n’est pas vraiment un lieu de villégiature. Quant à ce que j’ai à vous dire, ça tient en deux mots : je veux le rubis.
– C’est une manie chez vous ? La dernière fois, vous couriez après un saphir. Maintenant, c’est un rubis. Avez-vous l’intention de me convoquer chaque fois que vous aurez envie d’une pierre précieuse ?
– Ne faites pas l’idiot ! Vous savez très bien ce que je veux dire. Le rubis a été vendu à Kledermann par cet abruti de Saroni qui a cru pouvoir faire cavalier seul et s’approprier l’objet.
Et ce soir, Kledermann vous l’a revendu. Alors dites-moi où il est et on vous ramène en ville ! Morosini éclata de rire :
– Où êtes-vous allé pêcher votre psychologie du collectionneur ? Vous vous imaginez que le banquier m’a fait venir ici pour lui racheter la pièce rare sur laquelle il a réussi à mettre la main ? Vous rêvez, mon vieux ! Il m’a fait venir pour l’estimer et lui en raconter l’histoire, un point c’est tout ! Cela dit, je désirais en effet racheter ce rubis mais Kledermann y tient comme à la prunelle de ses yeux. J’ai échoué.
– Moi je n’échouerai pas et vous allez m’aider.
– Du fond de cette cave ? Je ne vois pas comment ? Au fait, c’est vous qui avez arrangé de si belle façon ce pauvre Saroni ?
– Ce n’est pas moi, c’est mon… employeur, fit Ulrich avec une nuance de dédain qui n’échappa pas à Morosini. C’est lui qui a mené l’interrogatoire et c’est son exécuteur qui l’a tué. Moi j’ai horreur de me salir les mains…
– Je vois. Vous êtes le cerveau de l’association ?
Un éclair d’orgueil traversa les yeux pâles de l’Américain.
– On peut dire ça, en effet !
– Étrange ! Que l’on ne laisse pas les responsabilités au jeune Sigismond qui est loin d’être une lumière, je le conçois mais… le vieux Solmanski est toujours vivant, lui, en dépit de la comédie du suicide jouée à Londres. Et à moins qu’il ne soit devenu subitement gâteux ? …
– Eh bien, vous en savez des choses ! Non, il n’est pas gâteux mais il est malade. Le produit qu’il a avalé pour simuler la mort a laissé des traces. Il ne peut plus diriger lui-même les opérations. Pourquoi croyez-vous qu’il ait pris la peine de me faire évader pour me mettre à la tête de la bande de malfrats ramenés d’Amérique par Sigismond ?
La conversation prenait un tour inattendu qui était loin de déplaire à Morosini. Il poussa son avantage :
– Il est certain que le besoin d’un homme à poigne devait se faire sentir. Sigismond n’est qu’un agité dangereux et cruel. Je crois même que son père partage mon opinion.
– Sans aucun doute ! acquiesça Ulrich toujours aux prises avec les joies de l’autosatisfaction.
– Autrement dit, vous prenez vos ordres directement de lui. Il est ici ?
– Non. À Varsovie…
Entraîné par le rythme de la conversation, il avait parlé trop vite et le regretta aussitôt :
– De toute façon, ça ne vous regarde pas !
– Que voulez-vous de moi ? Je vous ai déjà dit que Kledermann veut garder le rubis. Je ne vois pas ce que vous pourriez me demander de plus ?
Un sourire qui n’avait rien d’aimable vint se poser comme un masque sur le visage taillé à coups de serpe de l’Américain :
– Oh, c’est simple : vous allez vous arranger pour le récupérer. Vous avez vos grandes et vos petites entrées : ce doit être assez facile ?
– Si c’était aussi facile j’aurais déjà trouvé un plan, mais ce que vous êtes en train de me demander c’est de cambrioler une chambre forte qui ne vole pas son nom. C’est Fort-Knox en plus petit !
– Il ne faut jamais désespérer de rien. En tout cas, arrangez-vous comme vous l’entendrez mais il me faut le rubis, sinon…
– Sinon quoi ?
– Vous pourriez vous retrouvez veuf !
C’était tellement inattendu que Morosini ouvrit de grands yeux :
– Ce qui veut dire ?
– C’est assez facile à comprendre : nous tenons votre femme ! Vous savez, cette ravissante créature que vous êtes venu arracher de nos mains au péril de votre vie dans la villa du Vésinet ?
– J’entends bien mais… elle est la sœur et la fille de vos patrons ? Et ce sont eux qui vous ont donné l’ordre d’enlever ma femme ?
Ulrich prit un instant de réflexion avant de répondre, puis releva la tête avec l’air d’un homme qui vient de prendre un parti :
– Non. Je dirais même qu’ils ignorent ce détail. Voyez-vous, il m’a semblé qu’il ne serait pas mauvais de prendre une assurance contre eux tout en me procurant un moyen de pression sur vous !
Le cerveau d’Aldo travaillait à toute vitesse. Il y avait là quelque chose de bizarre. Sa première pensée pencha pour un bluff.
– Quand l’avez-vous enlevée ? demanda-t-il d’une voix égale.
– Hier soir, vers onze heures, alors qu’elle sortait du Harry’s Bar avec une amie… Cela vous suffit ?
– Non. Je veux téléphoner chez moi !
– Pourquoi ? Vous ne me croyez pas ?
– Oui et non. Le délai me semble un peu court pour l’amener ici…
– Je n’ai pas dit qu’elle était ici. Mais que je la tienne, vous pouvez en être sûr !
À son tour, Aldo prit un temps de réflexion. Quand il avait quitté Anielka, elle venait tout juste d’être débarrassée de ses nausées mais sa forme n’était pas éblouissante. Il l’imaginait mal se précipitant au Harry’s Bar pour y siroter des cocktails, même avec une amie qui pouvait être Adriana. En tout cas, une chose était certaine : Ulrich savait qu’il avait épousé la veuve de Ferrals mais il ignorait l’état actuel de leurs relations. Un instant, il caressa l’idée de déclarer avec un grand sourire : « Vous avez ma femme ? À merveille ! Gardez-la donc, vous n’avez pas idée du service que vous me rendez ! » Il imagina la tête d’Ulrich à l’annonce de cette nouvelle… D’autre part, il savait d’expérience que cet homme était dangereux et qu’il n’hésiterait pas un instant à faire souffrir Anielka pour parvenir à ses fins. Or, si Aldo voulait récupérer sa liberté, il ne souhaitait pas la mort de la jeune femme et encore moins qu’elle subît une quelconque torture. La seule chose à faire était de jouer le jeu tel qu’on le lui offrait. C’était l’unique façon de remonter à l’air libre…
– Eh bien ? fit Ulrich. Vous ne dites plus rien ?
– Ce genre de nouvelle mérite qu’on y réfléchisse, non ?
– Peut-être, mais je trouve que c’est suffisant. Alors ?
Morosini se composa un visage qu’il espérait suffisamment angoissé :
– Vous ne lui avez pas fait de mal, au moins ?
– Pas encore et je dirais même qu’elle est fort bien traitée !
– En ce cas, je n’ai pas le choix. Que voulez-vous au juste ?
– Je vous l’ai dit : le rubis.
– Vous ne pensez pas que je vais vous le chercher cette nuit ? Et demain, le rubis partira chez quelque joaillier pour être monté en vue d’être offert à Mme Kledermann pour son anniversaire.
– C’est quand, cet anniversaire ?
– Dans treize jours.
– Vous y serez ?
– Naturellement ! fit Aldo en haussant les épaules avec une lassitude bien imitée. À moins que vous ne me gardiez ici ?
– Je ne vois pas trop à quoi vous pourriez me servir dans ce trou. Alors, écoutez-moi bien ! On va vous ramener en ville où vous vous tiendrez à ma disposition, monsieur le prince ! Et, bien entendu, pas question d’approcher la police : je le saurais et votre femme en pâtirait. Pas question non plus de quitter votre hôtel. Je vous indiquerai par la suite un rendez-vous. Vous pouvez toujours essayer d’apprendre quel joaillier est chargé de la monture ?
Ulrich se leva et se dirigea vers la porte mais se retourna avant de l’ouvrir :
– Ne faites pas cette tête-là. Si les choses marchent comme je le veux, il se peut que vous y trouviez votre intérêt.
– Je ne vois pas en quoi ?
– Allons, réfléchissez ! Au cas où, grâce à vous, je pourrais visiter la chambre forte de Kledermann, il se peut que je vous laisse le rubis…
– Comment ? lâcha Aldo abasourdi. Mais je croyais…
– Les Solmanski le veulent à tout prix mais qu’ils l’aient ou non, ça m’est égal ! Il fallait être aussi bête que Saroni pour s’imaginer qu’un truc comme ça pouvait se vendre sans faire de vagues. Dans le coffre du banquier, il doit y avoir de quoi se remplir les poches plus facilement…
– Il a beaucoup de bijoux historiques. Pas commodes à vendre non plus.
– Vous tourmentez pas pour ça. En Amérique tout se vend et à des prix plus intéressants qu’ici. À bientôt !
Assis sur son lit, Aldo leva la main dans un vague salut négligent. Un instant plus tard, le batracien nommé Archie effectuait sa rentrée, arborant ce qu’il croyait être un sourire :
– On va te ramener en ville, mon gars, fit-il, mais Morosini n’eut même pas le temps d’articuler un mot : un coup de matraque appliqué à une vitesse incroyable le renvoya au pays des songes…
Le second réveil eut lieu dans des circonstances encore moins confortables que le premier : au moins, dans la maison inconnue, il y avait un lit. Cette fois, Morosini ouvrit les yeux dans un univers obscur, froid et humide. Il s’aperçut vite qu’on l’avait posé sur l’herbe d’une pelouse autour de laquelle il y avait de beaux arbres. Au-delà on apercevait le lac, des hangars à bateaux, des restaurants sur pilotis. La nuit était toujours là et les réverbères continuaient à brûler. Transi, en dépit de son manteau de vigogne qu’on avait eu la grâce de lui remettre, Aldo repéra vite les lumières du Baur-au-Lac qui ne lui parut pas très éloigné. En dépit de sa tête douloureuse, il se mit à courir dans le triple but de sortir du jardin, de rentrer chez lui et de se réchauffer.
Lorsqu’il pénétra dans le hall de l’hôtel, le portier s’autorisa à lever un sourcil en voyant rentrer en aussi triste état un client apparemment sobre et qu’il croyait couché depuis longtemps, mais il se serait fait couper la langue plutôt que d’oser une question. Aldo le salua d’un geste vague de la main et marcha d’un pas tranquille vers l’ascenseur : il avait, en effet, retrouvé la clé de sa chambre au fond de sa poche.
Une douche chaude, deux comprimés d’aspirine, et il se plongeait dans son lit en repoussant fermement toute pensée défavorable au sommeil. Dormir d’abord, on verrait après !
Il n’était guère plus de dix heures quand il se réveilla, plus dispos qu’il ne l’aurai craint. Il commença par se commander un copieux petit déjeuner puis demanda qu’on lui appelle Venise au téléphone. Bien qu’il n’y crût guère, cette histoire d’enlèvement d’Anielka le tarabustait. Si c’était vrai, il allait trouver la maison sans dessus dessous et peut-être même envahie par la police ? Il n’en fut rien : la voix qui lui répondit – celle de Zaccaria – était calme et paisible, même lorsque Aldo demanda à parler à sa femme :
– Elle n’est pas là, dit le fidèle serviteur. Votre départ lui a donné des envies de bouger : elle est allée passer quelques jours chez donna Adriana.
– Elle a emporté des bagages ?
– Bien sûr. Ce qu’il faut pour un petit séjour. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?
– Tout va bien, ne te tourmente pas. Je voulais seulement lui dire un mot. Au fait, Wanda est avec elle ?
– Bien entendu…
– C’est parfait. Je vais téléphoner chez ma cousine.
Il n’y eut pas plus de succès. Une voix mâle et rogue lui apprit que ni la comtesse Orseolo ni la princesse Morosini n’étaient là : ces dames avaient quitté Venise la veille au matin en direction des grands lacs. Elles n’avaient pas laissé d’adresse, ne sachant encore où elles se fixeraient.
– Et vous êtes qui, vous ? demanda Aldo qui n’aimait ni le ton ni la voix du personnage.
– Moi, je suis Carlo, le nouveau serviteur de madame la comtesse. C’est tout ce que Votre Excellence désire savoir ?
– C’est tout. Merci.
Aldo raccrocha. Plutôt perplexe. Ce qui se passait à Venise était encore plus bizarre qu’il ne l’avait cru. Où était Anielka ? Prisonnière d’Ulrich, ou paisible touriste sur le lac Majeur ? À moins que les deux femmes, plus Wanda, n’aient été enlevées ensemble ou qu’Adriana, non contente d’entretenir des relations avec le cirque Solmanski, n’en eût noué d’autres avec les gangsters yankees ? Jusqu’à ce nouveau valet qui péchait par singularité : le nom était italien mais, vu l’accent, Morosini aurait eu tendance à penser que Karl ou Charlie conviendraient mieux. Qu’est-ce que tout cela voulait dire au juste ?
Une longue succession de points d’interrogation l’occupa jusqu’à l’arrivée pétaradante d’Adalbert et de son roadster Amilcar rouge vif doublé de cuir noir qui valut à son propriétaire la considération respectueuse du voiturier persuadé d’avoir affaire à un échappé de la Targa Florio ou de la toute nouvelle course des Vingt-Quatre heures du Mans. Morosini, lui, n’apprécia pas :
– Tu ne pouvais pas venir par le train comme tout le monde ? grogna-t-il.
– Si tu tenais à la clandestinité il fallait le dire… et descendre dans une auberge de campagne. Devons-nous vraiment passer inaperçus ? J’ajoute que mon « char », comme disent les Canadiens, est maintenant hérissé de carburateurs, de compresseurs et de je ne sais trop quoi qui en font une véritable bombe. En cas d’urgence, ça peut toujours être utile. Toi, tu es de mauvais poil ? Des ennuis ?
– Si en une seule nuit, la dernière, on t’avait assommé par deux fois, tu trouverais la vie moins rose. Quant aux ennuis, il en pleut de tous les côtés…
– Allons boire un verre au bar et raconte !
Il n’y avait presque personne au bar et les deux hommes, installés à une table de coin sous un palmier en pot, purent causer tranquillement. Ou plutôt Aldo put parler tandis qu’Adalbert dégustait un cocktail en reniflant de temps en temps. Tant et si bien que Morosini, un peu agacé, finit par lui demander s’il était enrhumé :
– Non, mais j’ai découvert que le reniflement pouvait être un moyen capable d’exprimer toutes sortes de nuances : la tristesse, le dédain, la colère. Alors je m’entraîne… Il n’empêche que nous nous trouvons, toi surtout, dans une situation difficile. Une véritable histoire de fous mais je t’applaudis des deux mains pour ton attitude en face du gangster. Tu as bien fait d’entrer dans son jeu et je me demande même si cela ne nous permettrait pas de faire coffrer toute la bande.








