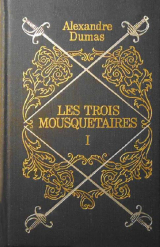
Текст книги "Les trois mousquetaires, vol. 1 (illustré par Maurice Leloir)"
Автор книги: Alexandre Dumas
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 27 страниц)

Table des chapitres
Table des gravures
LES TROIS
MOUSQUETAIRES
ÉDITION DE GRAND LUXE
IL A ÉTÉ TIRÉ DE CETTE ÉDITION
1o Un exemplaire unique sur papier des Manufactures impériales du Japon, accompagné des dessins originaux de M. Maurice Leloir et des fumés des deux cent cinquante bois gravés.
2o Cent cinquante exemplaires numérotés sur papier de Chine, dont cent avec les tirages à part de chaque gravure.
ALEXANDRE DUMAS
LES TROIS
MOUSQUETAIRES
AVEC UNE LETTRE D’ALEXANDRE DUMAS FILS
COMPOSITIONS
DE
MAURICE LELOIR
GRAVURES SUR BOIS DE J. HUYOT
TOME PREMIER

PARIS
CALMANN LÉVY, ÉDITEUR
ANCIENNE MAISON MICHEL LÉVY FRÈRES
3, RUE AUBER, 3
1894


LETTRE D’ALEXANDRE DUMAS FILS
Mon cher père,
Se souvient-on encore, dans le monde où tu es, des choses de notre monde, ou cette seconde vie, éternelle, n’existe-t-elle que dans notre imagination, enfantée, au milieu de nos reproches à l’existence, par notre terreur de ne plus être? La mort anéantit-elle complètement ceux qu’elle touche, et ceux qui demeurent sur la terre conservent-ils seuls le privilège de se souvenir? Ou le lien des âmes n’est-il jamais rompu entre ceux qui se sont aimés, même par la disparition de l’un des deux?
Nous en sommes toujours à nous poser ces questions devant la tombe des êtres qui nous sont restés chers, et les religions et les philosophies offriront encore pendant des milliers d’années et de siècles leurs solutions à l’humanité vivante sans que nous trouvions une réponse. Peut-être ton Yaqoub a-t-il raison quand il se contente
. . . . . . . . . . . De rendre un corps aux éléments
Masse commune, où l’homme, en expirant, rapporte
Tout ce qu’en le créant la nature en emporte
Si la terre, si l’eau, si l’air et si le feu
Le formèrent aux mains du hasard ou de Dieu,
Le vent, en dispersant ma poussière en sa course,
Saura bien reporter chaque chose à sa source?
Était-ce toi qui parlais par la bouche du Sarrasin, et ta philosophie aboutissait-elle à cette conclusion matérialiste? Nous n’avons jamais discuté là-dessus, du temps que nous vivions côte à côte, et je crois bien que les spéculations métaphysiques ne t’ont jamais troublé. La Nature, dont tu étais une des forces, selon l’expression de Michelet, et la vie réelle suffisaient pleinement à tes puissantes facultés. Ton esprit, constamment au service de ton imagination inventive et féconde, éprise du fait et de l’action encore plus chez nos ancêtres que chez nos contemporains, n’avait nul souci de l’au-delà. A force de vivre avec les hommes des siècles écoulés, tu avais, pour ainsi dire, allongé ta vie en arrière; et tu t’en tenais à cette éternité positive, laissant aux savants, aux philosophes et aux religieux les controverses, d’ailleurs inutiles, sur le principe et la fin des choses. Une fois, dans les vers qui servent de préface à Antony, tu as émis un doute sur l’âme, mais c’était moins un hommage à ta raison qu’un sacrifice à la rime, et au scepticisme qui, purement littéraire à cette époque, cherche aujourd’hui à devenir scientifique.
Si l’éternité de l’âme est douteuse, la durée de l’humanité ne l’est pas, et il faut bien passer le temps. De là les discussions. Mais la vie individuelle est si courte et ce qui vient après est si long, qu’il est tout naturel que l’homme veuille savoir de quoi ce long temps sera rempli, et son instinct étant toujours de vouloir être plus heureux pendant l’heure qui s’avance qu’il ne l’a été pendant celle qui s’éloigne, il devait fatalement, en face de la Mort qui le dépouille de toutes ses petites joies et de toutes ses petites espérances, concevoir un état où il goûterait enfin une béatitude éternelle et complète. Aussi, en revient-il toujours à cette croyance sans garanties et reste-t-il sourd à toutes les propositions philosophiques qui pourraient l’en écarter sans lui rien donner de plus certain en échange.
Ton ardent amour du travail t’a constamment tenu en dehors de ces discussions desséchantes et stériles. Quand, par hasard, cet Infini, qui tourmentait Musset, sollicitait ta pensée, tu t’en remettais, et tout de suite, à la grande Harmonie qui préside aux mouvements de l’Univers et qui nous frappe de toutes parts. Qui a créé cet Univers? D’où vient-il? Où va-t-il? Tu ne t’en inquiétais pas. A quoi bon interroger ce qui ne répond jamais? L’Univers est, et nous sommes, voilà la certitude; il nous contient en lui et il est résumé en nous; rien ne peut plus nous dissocier; notre cause et notre destinée sont communes. La Puissance, quelque nom qu’on lui prête, qui a établi ces lois de l’Univers, où il n’y a pas une faute de composition ni de mise en œuvre, ne s’est pas plus trompée quand il s’est agi de l’homme que quand il s’est agi du reste, et si elle a fait la Mort, c’est que celle-ci est indispensable à son dessein et à sa conception des mondes. Il est impossible que cette Mort, commune à tous, et le seul fait certain de la vie, ne mène pas et ne serve pas à quelque chose de mieux dans l’évolution générale. Contentons-nous donc d’user de cette vie, en tâchant de la rendre aussi douce et utile que possible à ceux avec qui nous la supportons, et que la Mort fasse ensuite de nous ce qu’elle a reçu mission d’en faire.
Pourquoi toutes ces réflexions philosophiques à propos des Trois Mousquetaires qui étaient, encore moins que toi et moi, hantés par de pareilles idées et qui s’en tenaient, en ces matières, à cette formule qui simplifiait tout: «la religion du Roy»? Parce qu’il est impossible d’évoquer le souvenir de ceux qu’on a aimés sans faire surgir et tourbillonner, comme un essaim d’oiseaux de nuit s’envolant des ruines où l’on pénètre, toutes les questions qui font, pour ainsi dire, leur nid dans ce mot: «la Mort». Et il n’est pas nécessaire que le mort ait été, comme toi, un homme illustre pour susciter ces problèmes, il suffit qu’il ait été bon, et nul ne l’a été plus que toi. Et pourquoi, ne sachant où tu es maintenant, t’adressé-je cette lettre? Parce que, quand nous avons perdu ceux que nous aimons, s’ils ne sont plus où ils étaient, ils sont partout où nous sommes. C’est à ce qui est toujours en moi de celui qui fut mon père que j’adresse ce souvenir et cet hommage qui lui parviendront où il est, si, du moment qu’il a participé à la vie matérielle, il participe désormais à l’éternelle vie sous une autre forme. Ce qui est certain, c’est qu’il ne s’est pas écoulé un jour, depuis vingt-trois ans que nous sommes séparés, sans que j’aie pensé à ce grand ami que tant de voix du reste m’auraient rappelé si, par impossible, j’en avais perdu la mémoire. Et je veux aujourd’hui profiter de l’occasion qui m’est offerte par la publication magnifique d’un de ses chefs-d’œuvre pour tenir un engagement que j’ai pris vis-à-vis de cette mémoire à une heure solennelle.
C’était au mois de décembre 1870. Nous étions chez moi à Puits, près de Dieppe. Mon père était là depuis le mois d’août, épuisé par le travail, comme son grand aïeul Walter Scott, qu’il avait tant admiré et qui lui avait montré la voie où il devait le suivre et le rejoindre. Il passait les journées à regarder silencieusement l’Océan que les pâles lueurs du soleil d’hiver faisaient se confondre avec un ciel brumeux et gris, et dont la respiration bruyante et régulière l’empêchait d’entendre la marée humaine qui nous arrivait de l’Est. Quelles pensées flottaient entre lui et cet horizon blafard? Il souriait à tous ceux qui lui tenaient compagnie, et quand je lui demandais comment il se trouvait, il me répondait toujours: «Très bien». Avait-il, sans vouloir nous le dire et nous en inquiéter, le pressentiment de sa fin prochaine ou simplement un besoin de repos égal au labeur accompli, et la sensation de bien-être que ce repos lui causait suffisait-elle à ce puissant organisme maintenant détendu? Il ne souffrait pas; il n’avait plus aucune préoccupation; il se sentait aimé et ne souhaitait pas autre chose. Après une grande journée de semailles, assis près de l’âtre, il laissait le sommeil bien gagné l’envahir peu à peu.
Un jour, comme je le faisais tous les matins, j’insistais pour le décider à se lever, la seule chose qui lui fût pénible, mais qui était nécessaire pour combattre la faiblesse, un jour, le 4 décembre, il fixa sur moi ses grands yeux si doux, et du ton dont un enfant implorerait sa mère, il me dit: «Je t’en supplie, ne me force pas à me lever; je suis si bien là.» Je n’insistai plus et je m’assis sur son lit. Tout à coup, il devint pensif et son visage prit une expression de grand recueillement et de grande mélancolie. Dans ses yeux si caressants tout à l’heure je vis briller deux larmes. Je lui demandai ce qui l’attristait ainsi. Il me prit une main, me regarda bien en face et me dit d’une voix ferme: «Je te le dirai, si tu me promets de répondre à ma question, non pas avec la partialité d’un fils ou la complaisance d’un ami, mais avec la franchise d’un vaillant frère d’armes et l’autorité d’un bon juge.
—Je te le promets.
—Jure-le.
—Je te le jure.
—Eh bien?...
Il hésita encore un moment; puis se décidant:
—Eh bien! crois-tu, me dit-il, qu’il restera quelque chose de moi?
Et ses yeux ne quittaient pas les miens.
—Si tu n’as pas d’autre inquiétude que celle-là, lui dis-je gaîment en le regardant comme il me regardait, tu peux être tranquille, il restera beaucoup de toi.
—Vrai?
—Vrai.
—Sur ton honneur?
—Sur mon honneur.
Et comme j’étais devenu d’autant plus souriant que j’avais à lui cacher mon émotion, il eut confiance. De la main qui tenait la mienne il m’attira vers lui et nous nous embrassâmes longuement. Il ne m’adressa plus la parole, comme si rien ne l’intéressait plus ici-bas. Il me regardait de temps en temps avec un remercîment dans son regard et une pression plus forte de sa main. Il s’assoupit de plus en plus. Le lendemain, 5 décembre, la fièvre le prit et, le soir, à dix heures, il mourait sans une secousse, sans un effort, sans le savoir.
Vingt-trois ans se sont passés depuis ce jour où tu m’as demandé mon opinion, et chaque jour a confirmé l’assurance que je te donnais, en toute conviction, à ce moment suprême. C’est que le monde de la pensée, y compris celui de la fiction, est régi par des lois aussi absolues et aussi infaillibles que celles de cet Univers dont j’admirais tout à l’heure l’équilibre et l’harmonie. L’homme ne se livre complètement qu’à ce qui le passionne, le charme, l’émeut, l’exalte, l’élève, qu’à ce qui le rappelle au sentiment de sa valeur et de sa dignité, de tout ce qu’il sent de supérieur en lui que le génie de l’écrivain a mission d’éveiller ou d’accroître. Il ne prendra jamais un plaisir durable au récit de ses turpitudes et de ses bassesses. Il pourra, surtout dans sa première jeunesse, sur les bancs du collège, à l’âge des curiosités à outrance, trouver quelque attrait malsain et solitaire à certaines psychologies basses, mais il se lassera et se dégoûtera bien vite de ces tableaux et il en reviendra toujours à ce qui sera sain et réconfortant. Dans le miroir que lui présentent les poètes, les dramaturges, les romanciers et les conteurs de toute espèce, il ne tient d’ailleurs pas à se voir tel qu’il est; il se connaît bien au fond, c’est un autre lui qu’il cherche, ce lui qu’il croit être ou qu’il ne désespère jamais de pouvoir devenir. Il sait parfaitement que le beau et le bien, s’ils sont plus rares, sont aussi vrais que le laid et le mal et que le vice n’a pas le monopole de la vérité. Partout où son âme et son cœur sont convoqués—et, sauf dans la religion et dans l’amour, où le sont-ils plus que dans la lecture?—il lui faut une espérance, une consolation, un appui, un idéal.
Voyez les yeux de cet homme ou de cette femme fixés sur ces pages que leurs mains tournent fiévreusement. Quelle absorption par celui qui leur parle tout bas! C’est là qu’il y a suggestion, transmission de pensée, substitution d’une volonté à une autre! Croyez-vous qu’il n’y ait que de la curiosité dans cette absorption, dans cet oubli de soi et de ce qui n’est pas le héros ou l’héroïne de l’aventure? Il y a, derrière tout cela, une conscience qui ne sait pas toujours qu’elle est en jeu dans cette affaire, mais qui veille sans cesse et dont les aspirations et les exigences ne s’arrêtent pas plus que les battements de notre cœur, même quand nous ne les sentons pas, et qui réclame sa part dans l’émotion perçue. Malheur à ceux de nous qui ne la lui font pas, car nous avons tous charge d’âmes.
Eh bien, voilà pourquoi, mon bon et cher père, j’ai pu te dire qu’il resterait beaucoup de ton œuvre, et pourquoi le temps envolé, depuis lors, a ratifié mon dire. Voilà pourquoi, avec tes héros bien portants, gais, spirituels, loyaux, intrépides, généreux, se dévouant jusqu’à la mort aux causes les plus nobles, aux sentiments les plus élevés, tu passionnes de plus en plus les foules depuis plus d’un demi-siècle; pourquoi, malgré toutes les écoles, toutes les esthétiques, toutes les discussions sincères ou non, toutes les partialités et tous les dénigrements où se débat la littérature actuelle, tu es devenu, tu restes et tu resteras l’écrivain le plus entraînant, le romancier le plus populaire, dans le bon sens du mot, non seulement de la France, mais du monde entier. Tu fais partie maintenant de ce qui soulage et console les misères humaines. Un grand chirurgien me disait dernièrement: «Tous nos malades de l’hôpital guérissent ou meurent avec un livre de votre père sous leur oreiller; quand nous voulons leur faire oublier les terreurs de l’opération à subir, les lenteurs de la convalescence, les pressentiments de la fin, nous leur ordonnons la lecture des romans ou des voyages de votre père, et ils oublient.» Tu n’es pas seulement admiré, tu es aimé, ce qui vaut bien mieux, et, dans certaines circonstances, tu es béni par ceux qui souffraient et que tu as aidés à supporter, à étourdir leurs souffrances. A force d’intéresser, de passionner, d’enthousiasmer, de faire rire ou pleurer ces grands enfants qu’on appelle les hommes, ils ont fini par te considérer comme de leur famille, et ils t’appellent le père Dumas. Il me semble te voir à côté du bon La Fontaine. Tu es l’aïeul souriant qui conte, pendant la veillée, les belles histoires des temps passés.
Depuis le jour où je te promettais cette renommée, il a été publié et vendu en France deux millions huit cent quarante mille volumes de toi, quatre-vingts millions de livraisons illustrées, et six cents de tes ouvrages ont été reproduits par des journaux de Paris et de province, sans compter les pays qui n’ont pas de traités avec nous, qui te pillent et te répandent par millions d’exemplaires dans leur idiome national. Les traités qui te concernent et que j’ai passés avec tes éditeurs me réservaient le droit de faire une grande édition de luxe de tes œuvres choisies. Elle aurait formé vingt-cinq gros volumes; je ne l’ai pas encore faite; j’ai voulu laisser le public consacrer cette œuvre et faire sa sélection lui-même. Je n’avais pas à essayer de lui imposer une préférence. Et voilà qu’aujourd’hui tes éditeurs, d’eux-mêmes, sans que je sois intervenu en rien, ont eu la bonne pensée de consacrer la renommée toujours croissante des Mousquetaires, dans une grande édition, illustrée par l’illustrateur charmant de Manon, du Voyage sentimental, des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, Maurice Leloir. Demain, ce sera le Chevalier de Maison-Rouge, illustré par Le Blant, le maître peintre des Vendéens. En m’annonçant que son deux cent cinquantième dessin était terminé, Maurice Leloir m’écrivait: «Voilà deux ans que je vis avec d’Artagnan, Athos, Porthos, Aramis et tous les personnages de cette grande épopée. Vous ne sauriez croire avec quelle peine je les quitte. Puissé-je les retrouver bientôt dans Vingt ans après!»
Cette lettre m’a rappelé le jour où je suis allé te voir, alors que tu terminais le Vicomte de Bragelonne, et où je t’ai trouvé assis tristement dans ton large fauteuil, te reposant par hasard, et les yeux rouges: «Tu as pleuré. Qu’est-ce que tu as?» Je t’entends encore me répondre: «Un gros chagrin. Porthos est mort. Je viens de le tuer. Je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer sur lui. Pauvre Porthos!»
C’est avec ces convictions et ces solidarités-là qu’on écrit des chefs-d’œuvre.
Et si de ce jour nous remontons à ceux où tu commençais ce beau livre, quel entrain, quelle joie, quelle santé dans ce travail! Je te vois encore dans ce petit logement que tu t’étais loué, dans la maison de ton appartement officiel, sur la cour, et où il n’y avait qu’une grande table de bois blanc, un canapé, deux chaises, des livres sur la cheminée et un lit de fer où tu dormais quelques heures quand le travail du soir s’était prolongé dans la nuit. C’était là que tu te réfugiais pour ne pas être dérangé par tous les importuns et tous les parasites qui assiégeaient incessamment ta porte que tu ne leur fermais pas encore assez. Vêtu d’un pantalon à pieds, en manches de chemise, ces manches retroussées jusqu’aux coudes, le cou à l’air, tu te mettais au travail dès sept heures du matin et tu y restais jusqu’à sept heures du soir, où je venais dîner avec toi. Je trouvais quelquefois ton déjeuner intact sur la petite table que le domestique plaçait à côté de ton établi. Tu avais oublié d’y toucher, et, tout en dînant, et en dînant bien, des plats qu’il t’arrivait de confectionner toi-même, pour te reposer, tu nous racontais ce que tes personnages avaient fait dans la journée et tu te réjouissais à la pensée de ce qu’ils allaient faire le lendemain. Et cela durait pendant des mois. Quel beau labeur, et toujours allègre! «Qu’est-ce que c’est qu’un art, disait Corot qui sifflotait sans cesse en peignant, qu’est-ce que c’est qu’un art qui ne rend pas gai?» Tu pensais comme lui, et plus tu donnais la vie à tes créations, plus elle abondait en toi, semblable à ces grands fleuves qui, alimentés par des sources mystérieuses, se renouvellent d’autant plus qu’ils se répandent et s’élargissent. Ah! le bon temps! Nous avions le même âge: tu avais quarante-deux ans, j’en avais vingt. Les joyeux entretiens! Les doux épanchements! Mirages du cœur et de la mémoire! Il me semble que c’était hier!
Et tu dors, depuis près d’un quart de siècle, sous les grands arbres du cimetière de Villers-Cotterets, entre ta mère qui t’a servi de modèle pour toutes les honnêtes femmes que tu as peintes, et ton père qui t’a servi de preuve pour tous les héros de courage, de droiture et de bonté à qui tu as donné la vie. Et moi que tu considérais toujours et qui me considérais aussi comme un enfant à côté de toi, j’ai les cheveux plus blancs que tu ne les as jamais eus et me voilà déjà plus vieux que tu ne l’étais quand tu nous as quittés. La terre va vite. A bientôt.
ALEXANDRE DUMAS FILS.


PRÉFACE
DANS LAQUELLE IL EST ÉTABLI QUE, MALGRÉ LEURS NOMS
EN OS ET EN IS, LES HÉROS DE L’HISTOIRE
QUE NOUS ALLONS AVOIR L’HONNEUR DE RACONTER A NOS LECTEURS
N’ONT RIEN DE MYTHOLOGIQUE
Il y a un an à peu près qu’en faisant à la Bibliothèque royale des recherches pour mon histoire de Louis XIV, je tombai par hasard sur les Mémoires de M. d’Artagnan, imprimés,—comme la plus grande partie des ouvrages de cette époque, où les auteurs tenaient à dire la vérité sans aller faire un tour plus ou moins long à la Bastille,—à Amsterdam, chez Pierre Rouge. Le titre me séduisit: je les emportai chez moi, avec la permission de M. le conservateur, bien entendu, et je les dévorai.
Mon intention n’est pas de faire ici une analyse de ce curieux ouvrage, et je me contenterai d’y renvoyer ceux de mes lecteurs qui apprécient les tableaux d’époque. Ils y trouveront des portraits crayonnés de main de maître; et, quoique ces esquisses soient, pour la plupart du temps, tracées sur des portes de caserne et sur des murs de cabaret, ils n’y reconnaîtront pas moins, aussi ressemblantes que dans l’histoire de M. Anquetil, les images de Louis XIII, d’Anne d’Autriche, de Richelieu, de Mazarin et de la plupart des courtisans de l’époque.
Mais, comme on le sait, ce qui frappe l’esprit capricieux du poète n’est pas toujours ce qui impressionne la masse des lecteurs. Or, tout en admirant, comme les autres les admireront sans doute, les détails que nous avons signalés, la chose qui nous préoccupa le plus est une chose à laquelle bien certainement personne avant nous n’avait fait la moindre attention.
D’Artagnan raconte qu’à sa première visite à M. de Tréville, le capitaine des mousquetaires du roi, il rencontra dans son antichambre trois jeunes gens servant dans l’illustre corps où il sollicitait l’honneur d’être reçu, et ayant nom Athos, Porthos et Aramis.
Nous l’avouons, ces trois noms étrangers nous frappèrent, et il nous vint aussitôt à l’esprit qu’ils n’étaient que des pseudonymes à l’aide desquels d’Artagnan avait déguisé des noms peut-être illustres, si toutefois les porteurs de ces noms d’emprunt ne les avaient pas choisis eux-mêmes le jour où, par caprice, par mécontentement ou par défaut de fortune, ils avaient endossé la simple casaque de mousquetaire.
Dès lors nous n’eûmes plus de repos que nous n’eussions retrouvé, dans les ouvrages contemporains, une trace quelconque de ces noms extraordinaires qui avaient si fort éveillé notre curiosité.
Le seul catalogue des livres que nous lûmes pour arriver à ce but remplirait un chapitre tout entier, ce qui serait peut-être fort instructif, mais à coup sûr peu amusant pour nos lecteurs. Nous nous contenterons donc de leur dire qu’au moment où, découragé de tant d’investigations infructueuses, nous allions abandonner notre recherche, nous trouvâmes enfin, guidé par les conseils de notre illustre et savant ami Paulin Pâris, un manuscrit in-folio, coté sous le no 4772 ou 4773, nous ne nous le rappelons plus bien, ayant pour titre:
«Mémoire de M. le comte de La Fère, concernant quelques-uns des événements qui se passèrent en France vers la fin du règne du roi Louis XIII et le commencement du règne du roi Louis XIV.»
On devine si notre joie fut grande, lorsqu’en feuilletant ce manuscrit, notre dernier espoir, nous trouvâmes à la vingtième page le nom d’Athos, à la vingt-septième le nom de Porthos, à la trente et unième le nom d’Aramis.
La découverte d’un manuscrit complètement inconnu, dans une époque où la science historique est poussée à un si haut degré, nous parut presque miraculeuse. Aussi nous hâtâmes-nous de solliciter la permission de le faire imprimer, dans le but de nous présenter un jour avec le bagage des autres à l’Académie des inscriptions et belles-lettres, si nous n’arrivions, chose fort probable, à entrer à l’Académie française avec notre propre bagage. Cette permission, nous devons le dire, nous fut gracieusement accordée; ce que nous consignons ici pour donner un démenti public aux malveillants qui prétendent que nous vivons sous un gouvernement assez médiocrement disposé à l’endroit des gens de lettres.
Or, c’est la première partie de ce précieux manuscrit que nous offrons aujourd’hui à nos lecteurs, en lui restituant le titre qui lui convient, prenant l’engagement, si, comme nous n’en doutons pas, cette première partie obtient le succès qu’elle mérite, de publier incessamment la seconde.
En attendant, comme le parrain est un second père, nous invitons le lecteur à s’en prendre à nous, et non au comte de La Fère, de son plaisir ou de son ennui.
Cela posé, passons à notre histoire.









