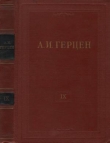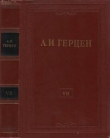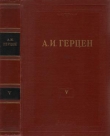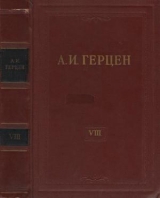
Текст книги "Том 8. Былое и думы. Часть 1-3"
Автор книги: Александр Герцен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 35 страниц)
Preface
In order to write down one’s own recollections, it is by no means necessary to be a great man, or an extraordinary villain; a celebrated artist, or a statesman; it is enough to be merely a man, to have something to tell, and to be able and willing to tell it.
Every existence is interesting; if not on account of the person, yet on account of the country, the epoch in which he lives. Man likes to penetrate into the inward life of another; he likes to touch the most delicate chord of another heart, to watch its beatings and penetrate its secrets, in order to compare, to verify, to seek a justification, a consolation, a proof of conformity.
Memoirs, however, can be tiresome, the life of which they speak can be poor, insignificant. Then do not read them; that is the heaviest punishment to be inflicted upon a book. And as to that, no special right for writing memoirs can avail. The memoirs of Benvenuto Cellini are not so interesting on account of his having been a great artist, but because the things he had to relate were most interesting.
«The right to this or that kind of words» is an expression which no longer belongs to our time, but to the time of a minority of intelligence, of the poets-laureate, of the doctors in caps, of the philosopher by privilege, of the patented learned men, and other phariseesof the academical world. In those times, the art of writing was considered sacred, the «official author», not only with the pen, but always speaking in a florid style, chose the most unnatural turning of phrases, and employed the words least used, in a word, he preached, or he sang.
For us, we speak quite plainly. We imagine that writing is an occupation fit for a layman, for any one else, a work like every other work. Here, at least, «the right to labour» cannot be doubted.
If the production can find consumers – is another question.
A year ago, I published in London, a part of my Memoirs, in the Russian language, under the title «Prisons and Exiles». This work appeared, when war had already begun, and when the means of communication with Russia had become more difficult. I did not therefore expect great success. But it happened otherwise. In the month of September, the «Revue des Deux Mondes» gave long extracts from my book, with a very flattering article about myself (although I do not share the author’s opinions). In the month of January, other fragments (likewise translated from the Russian), appeared in the «Athenaeum» of London, while Hoffman and Campe published a German translation of the work at Hamburg.
This has decided me to publish another volume.
I shall say in another place what deep interest these Memoirs have for me individually, and for what purpose I have begun to write them. I now content myself with the assertion: that there is nо country in which Memoirs can be more useful than in Russia. We – thanks to the censorship – are very little accustomed to publicity; it frightens, astonishes and offends us. It is time the imperial artists of the police of St. Petersburg, should know, that sooner or later, their actions, so well hidden by the prisons, the irons and the graves, will be revealed in the broad glare of day.
ПЕРЕВОД
Предисловие
Для того, чтобы написать свои воспоминания, вовсе не нужно быть великим человеком или видавшим виды авантюристом, прославленным художником или государственным деятелем. Вполне достаточно быть просто человеком, у которого есть что рассказать и который может и хочет это сделать.
Жизнь обыкновенного человека тоже может вызвать интерес, если и не по отношению к личности, то по отношению к стране и эпохе, в которую эта личность жила. Мы любим проникать во внутренний мир другого человека, нам нравится коснуться самой чувствительной струны в чужом сердце и наблюдать его тайные содрогания, мы стремимся познать его сокровенные тайны, чтобы сравнивать, подтверждать, находить оправдание, утешение, доказательство сходства.
Мемуары, конечно, могут быть скучными, и жизнь, в них рассказанная, бедной и незначительной. Тогда не читайте их – и это будет самым страшным приговором для книги. И в данном случае не может существовать никакого специального руководства для писания мемуаров. Мемуары Бенвенуто Челлини интересны не потому, что он был великим художником, а потому, что он затрагивает в них в высшей степени интересные вопросы.
«Право на те или иные слова» – это устаревшее выражение, относящееся к эпохе деградации интеллектуальной жизни, ко времени поэтов-лауреатов, докторов в шапочках, привилегированных философов, патентованных ученых мужей и других фарисеев академического мира. В те времена писательское искусство считалось таинством, доступным пониманию немногих избранников. «Официозный писатель» не только на бумаге, но и в жизни говорил напыщенным языком, выбирал самые неестественные обороты речи и пользовался наиболее редко употребляемыми словами, – словом, он то и дело проповедовал или воспевал.
Что касается нас, то мы говорим совершенно понятным языком. Мы понимаем писательское искусство как такое дело, которым может заняться любой человек. Для этого не надо быть профессионалом, так как это самая обычная работа. Здесь по крайней мере нельзя подвергнуть сомнению «право на труд».
То, что не всякое произведение может найти читателей, – вопрос другого порядка.
Год назад, в Лондоне, я опубликовал на русском языке часть своих мемуаров под заглавием «Тюрьма и ссылка». Эта работа появилась тогда, когда война уже началась и когда связь с Россией стала более затруднительной. Потому я и не ожидал большого успеха. Но случилось иначе. В сентябре месяце «Revue des Deux Mondes» поместил пространные выдержки из моей книги с крайне лестным отзывом обо мне самом (хотя я не разделяю мнения рецензента). В январе появились другие выдержки (соответственно переведенные с русского языка), напечатанные в лондонском «Athenaeum». В то же время Гофман и Кампе опубликовали в Гамбурге немецкий перевод этой работы.
Это побудило меня издать еще один том.
В другом месте я скажу, какой глубокий интерес для меня лично представляют эти мемуары и с какой целью я начал их писать. Теперь я довольствуюсь лишь констатацией того факта, что в настоящее время нет такой страны, в которой мемуары были бы более полезны, чем в России. Мы – благодаря цензуре – очень мало привыкли к гласности. Она пугает, удивляет и оскорбляет нас. Пора, наконец, имперским комедиантам из петербургской полиции узнать, что рано или поздно, но об их действиях, тайну которых так хорошо хранят тюрьмы, кандалы и могилы, станет всем известно и их позорные деяния будут разоблачены перед всем миром.
Ко второму изданию <«Тюрьмы и ссылки»>*Когда Н. Трюбнер просил у меня дозволение сделать второе издание моих сочинений, изданных в Лондоне, я потому исключил «Тюрьму и ссылку», что думал в скором времени начать полное издание моих воспоминаний под заглавием «Былое и думы».
Но, несмотря на то, что скоро сказывается сказка, да не скоро делается дело, я увидел, что мой рассказ еще не так близок к полному изданию, как я думал. Между тем требования на «Тюрьму и ссылку» повторяются чаще и чаще. Книжка эта имеет свою относительную целость, свое единство, и я согласился на предложение г. Трюбнера.
Перечитывая ее, я добавил две-три подробности (мою встречу с Цехановичем и историю владимирского старосты…), но текст оставлен без значительных поправок. Я не разделяю шутя высказанного мнения Гейне, который говорил, что он очень доволен тем, что долго не печатал своих записок, потому что события доставляли ему случай проверять и исправлять сказанное.
И-р.
21 апреля 1858. Путней, близ Лондона.
К третьей части
<Предисловие>*Отрывок, печатаемый теперь, следует прямо за той частию, которая была особо издана под заглавием «Тюрьма и ссылка»; она была написана тогда же (1853), но я многое прибавил и дополнил.
Странная судьба моих «Записок»: я хотел напечатать одну часть их, вместо того напечатал три и теперь еще печатаю четвертую.
Один парижский рецензент, разбирая, впрочем, очень благосклонно («La presse», 13 oct. 1856), третий томик немецкого перевода моих «Записок», изданных Гофманом и Кампе в Гамбурге, в котором я рассказываю о моем детстве, прибавляет шутя, что я повествую свою жизнь, как эпическую поэму: начал in medias res[218]218
с сути дела (лат.). – Ред.
[Закрыть] и потом возвратился к детству.
Это эпическое кокетство – совершенная случайность, и если кто-нибудь виноват в нем, то совсем не я, а скорее мои рецензенты и в том числе сам критик «Прессы». Если б они отрывки из моих «Записок» приняли строже, холоднее и, что еще хуже, – пропустили бы их без всякого внимания, я долго не решился бы печатать еще и долго обдумывал бы, в каком порядке печатать.
Прием, сделанный им, увлек меня, и мне стало труднее не печатать, нежели печатать.
Я знаю, что большая часть успеха их принадлежит не мне, а предмету. Западные люди были рады еще раз заглянуть за кулисы русской жизни. Но, может, в сочувствии к моему рассказу доля принадлежит простой правде его. Эта награда была бы мне очень дорога, ее только я и желал. Часть, печатаемая теперь, интимнее прежних; именно потому она имеет меньше интереса, меньше фактов; но мне было гораздо труднее ее писать… К ней я приступил с особенным страхом былого и печатаю ее с внутренним трепетом, не давая себе отчета зачем…
…Может быть, кому-нибудь из тех, которым была занимательна внешняя сторона моей жизни, будет занимательна и внутренняя. Ведь мы уже теперь старые знакомые…
И-р.
Лондон, 21 ноября 1856.
<Авторский перевод из XXIV главы>*Une fois, par une longue soirée d’hiver, vers la fin de 1838, nous étions assis seuls comme toujours. Nous lisions et nous ne lisions pas. Nous parlions et nous nous taisions – et en nous taisant nous continuions à nous parler. Il gelait fortement dehors, et même il ne faisait pas chaud dans la chambre. N… ne se sentait pas bien, elle était couchée sur un sofa, couverte de sa mantille; j’étais assis à côté, par terre.
La lecture n’allait pas. N… était distraite et pensait à autre chose. Elle était préoccupée, sa figure changeait. – «Sais-tu, – me dit-elle, tout à coup, – j’ai un secret à te dire. Viens ici, je te le dirai à l’oreille, – ou plutôt, devine-le». Je devinais, mais je voulais l’entendre d’elle-même. Elle me le dit alors. Nous nous regardâmes agités, les larmes aux yeux, et sans prononcer une parole de plus.
Que la poitrine humaine est puissante pour sentir le bonheur! – Si les hommes savaient s’abandonner sans arrière-pensée, sans distraction! Ordinairement le bruit extérieur, des préoccupations futiles, une anxiété puérile, une susceptibilité irascible – enfin toute cette poussière qui se dépose peu à peu, vers le milieu de la vie, sur le coeur, – empêchent l’épanchement, troublent la jouissance. Nous laissons échapper les meilleurs, les plus rares moments de bonheur – comme si nous en avions une quantité énorme devant nous. Nous pensons au lendemain, à la prochaine année, lorsqu’il faudrait, sans perdre un instant, saisir à deux mains la coupe toute pleine – et boire – et boire. – Car la nature offre sans être priée, mais n’attend pas, – et la coupe s’en va. – Penser à demain! – Mais qui a dit qu’il y aurait un demain? – Et s’il y en a un, il ne sera pas pour nous peut-être!
Il était difficile d’ajouter quelque chose à notre bonheur; et pourtant la nouvelle d’un être à venir, d’un enfant, découvrit dans notre cœur des espaces que nous ne connaissions pas, des sentiments d’une nouvelle ivresse, pleine de terreur, d’espérance, d’inquiétude et d’une attente passionnée.
C’est le commencement de la famille – car sans enfant il n’y a pas de famille. L’amour effrayé devient plus tendre, se fait garde-malade, soigne, veille. L’égoïsme à deux ne se fait pas seulement égoïsme à trois, mais résignation de deux pour un troisième. Un élément nouveau entre dans l’intimité de la vie; un personnage mystérieux frappe à la porte, un hôte qui est et qui n’est pas, mais qui est déjà complètement nécessaire, indispensable. Qui est-il? – personne n’en sait rien. – Mais qui que tu sois, inconnu, tu es heureux. Avec quel amour, avec quelle tendresse on t’attend au seuil de la vie.
Et quelles transes, quels doutes! – Sera-t-il vivant, ou non? – Il y a tant de cas malheureux. – Même cela arrive souvent. Le médecin sourit, ne veut pas dire ou ne sait pas. On se cache des autres. On n’a personne à qui demander un conseil, et on a honte.
Mais l’enfant donne ses signes de vie. – Je ne connais pas de sentiment plus pieux et religieux que celui qui remplit l’âme lorsque la main sent les premiers mouvements de la vie future qui tâche de briser ses liens, de sortir au grand jour, qui essaie ses muscles non mûrs et endormis. – C’est la première imposition des mains, par laquelle le père donne sa bénédiction à l’être futur et qui cède une partie de soi-meme.
– Ma femme, – me dit un jour un brave bourgeois, – ma femme, – et il se tourna à gauche et à droite pour voir s’il n’y avait pas dans l’appartement des femmes ou des mineurs, – elle est enfin, pardonnez-moi, mais enfin… elle est enceinte…
Oui, la confusion de toutes les notions morales est encore telle que parler de l’état d’une femme enceinte offense les mœurs. Pourtant c’est bien étrange: on exige d’un homme un respect absolu, une vénération sans bornes pour la mère quelle qu’elle soit, et on voile le mystère de la naissance, non par un sentiment de piété ou de respect, mais – par bienséance. Tout cela, résultat de la dissolution idéelle, de la corruption monacale, de cet éternel et maudit holocauste de la chair, de ce malheureux dualisme qui nous tire en deux sens opposés, comme les hémisphères de Magdebourg. Il y a deux années, j’ai lu dans un livre – écrit par un socialiste – qu’avec le temps les enfants naîtront d’une autre manière! – et de laquelle? – comme les anges. – Au moins, c’est claire.
Honneur à notre maître commun, le vieux réaliste Gœthe! C’est lui qui a osé mettre à côté des vierges du romantisme la femme enceinte, et qui n’a pas craint de ciseler les formes altérées de la mère future, en les comparant aux formes sveltes de la femme future.
En effet, la femme qui porte, avec la mémoire des transports passés, toute la croix de l’amour, tout son fardeau; qui sacrifie sa beauté, sa vie; qui souffre, qui nourrit enfin de son sein, – c’est une des plus poétiques et des plus touchantes images.
Dans les Elégies romaines, dans la Fileuse, dans Gretchen et sa prière pleine de désespoir, Gœthe a exprimé de quelle solennité exhubérante la nature entoure le fruit mûrissant, et de quelle couronne d’épines la société entoure le vase du futur.
Pauvres mères! qui doivent cacher comme une flétrissure les traces de l’amour, avec quelle inhumanité, avec quelle grossièreté le monde les persécute!.. Dans le temps où la femme a un besoin si énorme de repos, de tendresse, de bienveillance, on leur empoisonne ces moments irremplaçables où la vie faiblissante succombe sous le poids du bonheur et de la plénitude.
C’est avec horreur que la mère malheureuse découvre ce secret. Elle tâche de se convaincre que ce n’est rien… Mais bientôt le doute devient impossible; elle accompagne de larmes et d’angoisses chaque mouvement de l’enfant; elle voudrait arrêter le travail mystérieux de la nature, lui faire rebrousser chemin; elle attend un malheur comme une miséricorde, comme un pardon. Mais l’infléxible nature va son chemin. – Elle est si forte, si jeune!..
Forcer une mère à désirer la mort de son enfant, et quelquefois plus, faire d’elle son bourreau et la livrer ensuite à l’autre, ou, si le cœur féminin prend le dessus, la flétrir: – quelle organisation magnifique et morale de la société!
Et qui s’est jamais donné la peine d’étudier, d’apprécier tout ce qui s’est passé dans son cœur pendant qu’elle parcourait le chemin fatal de l’amour à la frayeur, de la frayeur au désespoir, du désespoir au crime! – c’est-à-dire à la folie: car il y a une absurdité physiologique dans l’enfanticide.
Cette femme avait sans doute des moments d’oubli où elle aimait éperdument son enfant futur, et d’autant plus que son existence était un secret profond entre elle et lui. – Elle rêvait aussi à sa petite jambe, à son sourire, à ses lèvres pleines de lait – deson lait à elle; elle l’embrassait en rêvant, lui trouvait de la ressemblance avec des traits qui lui furent si chers;… et il faut le tuer!
Oh! Certainement, il y a des pauvres malheureuses; mais, en général, les femmes – perdues – n’ont pas ces sentiments.
Les femmes perdues, – lesquelles?
Certes, il n’y a rien de plus déchu que ces lézards, ces chauves-souris qui vont et viennet dans le brouillard des nuits de Londres, en offrant – victimes de la pauvreté par lesquelles la société défend les honnêtes femmes… contre l’excès des passions de leurs adorateurs – leur corps transi de froid au passant, pour ne pas mourir de faim.
Dans cette classe, il serait bien difficile de trouver quelques traces de cœur maternel, n’est-ce pas?
Eh bien, je vais vous raconter un petit fait qui m’est arrive!
Il y a trois ans, je rencontrai une jeune fille, assez jolie et mignonne. Elle appartenait à l’aristocratie de la corruption; c’est-à-dire qu’elle ne faisait démocratiquement le trottoir, mais étaitbourgeoisement entretenue par un négociant. C’était à un bal public. Un de mes amis, avec lequel j’étais là, la connaissait. Il l’invita à prendre un verre de vin avec nous. Elle accepta. C’était un être gai, éveillé, superficiel, sans aucun souci de lendemain. Ayant fini son dernier verre, elle s’élança dans le tourbillon lourd de la danse anglaise, et je la perdis de vue.
Cet hiver, par une soirée pluvieuse, je traversais la rue pour m’abriter sous les arcades de Pall-Mall, lorsque j’aperçus sous une lanterne, une jeune femme pauvrement vêtue qui grelottait, attendant une proie. Il me semblait, que je connaissais ses traits. Elle jeta un regard sur moi et se détourna. Mais il était trop tard; je l’avais reconnue.
M’approchant d’elle, je lui demandai avec intérêt, comment elle se trouvait là. Une rougeur fébrile couvrait ses joues fanées. – Etait-ce la honte – ou la phtisie? Je ne sais pas; mais il me semblait bien que ce n’était pas le rouge végétal. Dans ces deux années elle avait vieilli de dix.
– J’ai été bien malade, et je suis bien malheureuse, – me dit-elle avec une tristesse profonde et en me montrant du regard ses vêtements passés et ternes.
– Mais où est donc votre ami?
– Il a été tué en Crimée.
– Moi qui le croyais négociant.
Un peu interdite, au lieu de me répondre, elle m’interrogea d’un air triste:
– Dites-moi, de grâce, est-ce que je suis bien changée?
– Oui, lorsque je vous ai vue pour la première fois on pouvait vous prendre pour une enfant; maintenant vous avez l’air d’avoir vous-même des enfants.
Elle rougit encore plus et me dit, stupéfaite par mon observation:
– Comment l’avez-vous deviné?
– De manière ou d’autre; mais j’ai deviné. Maintenant, parlez-moi sérieusement, que vous est-il donc arrivé?
– Rien du tout. – Seulement, c’est vrai, j’ai un petit. – Si vous l’aviez vu. Mon Dieu! Qu’il est beau; tous les voisins en sont étonnés. Je n’ai jamais vu un enfant pareil. – L’ autre il s’est marié à une femme riche, et il est parti pour le Continent. Le petit est né après, et c’est lui qui m’a plongé dans cette misère. Au commencement j’avais de l’argent; je lui achetais tout dans les grands magasins. Mais, peu à peu, tout s’en est allé; j’ai engagé ce que j’avais. – On me conseillait de placer l’enfant en nourrice dans quelque village. Certainement cela serait mieux; mais il m’est impossible de m’en séparer. Je le regarde – je le regarde, et je pense que c’est mieux de mourir ensemble que de l’abandonner à des gens qui ne l’aiment pas. J’ai tâché de trouver une place; mais personne ne veut me prendre avec l’enfant. Je suis revenue chez ma mère. Elle est bonne; elle m’a tout pardonné, et elle aime le petit; elle le caresse. Mais il y a quatre mois, elle perdit l’usage de ses jambes. – Sa maladie nous a bien coûté, et cela ne va pas mieux.Vous savez vous-même, quelle dure année… Le charbon, le pain, tout est cher. – Nous n’avons pas de vêtements, pas d’argent. – Eh bien! je… Certainement, il serait mieux de se jeter dans la Tamise. – Oh! Ce n’est pas un plaisir, allez… mais… à qui laisser le petit?..
Je lui donnai quelque argent, et, ajoutant un shelling, je lui dis: «Achetez, avec ce shelling, quelque chose au petit». Elle commença par prendre l’argent; mais tout à coup elle le rendit, disant: «Si vous avez tant de bonté pour moi et pour le petit, achetez-lui quelque chose, dans la première boutique, vous-même. Cet enfant, depuis qu’il est né, n’a jamais reçu aucun cadeau de personne».
Je la regardais tout ému – et je serrai, avec amitié, avec estime, la main de cette femme… perdue.
Les amateurs de la réhabilitation feraient peut-être mieux de sortir de ces boudoirs parfumés, où ils trouvent, sur des sophas couverts de velours et de damas, des dames aux camélias et des dames aux perles, pour s’encanailler un peu. Ils trouveraient, au coin des rues, en regardant en face la débauche fatale, la débauche imposée par la faim, la débauche qui entraîne sans merci ni miséricorde, qui ne permet ni de s’arrêter, ni de prendre haleine, des sujets d’étude un peu plus sérieux. Les chiffonniers trouvent plus souvent des diamants dans le ruisseau que dans les oripeaux de théâtre, semés de paillettes de papier doré.
Cela me rappelle le malheureux Gérard de Nerval. Dans les derniers temps, avant son suicide, il s’absentait très souvent pour deux ou trois jours. On sut enfin qu’il passait son temps dans les estaminets les plus mal famés. Là, il avait fait connaissance avec des voleurs, des rôdeurs de barrières. Il jouait aux cartes avec eux, il les régalait et dormait quelquefois sous leur égide. Ses amis le prièrent de ne plus y aller. Mais Nerval leur répondit, avec une grande naïveté: «Chers amis, je vous assure, que vous avez des préjugés étranges et injustes contre ces gens-là. Croyez-moi, ils ne sont ni meilleurs ni pires que tous les autres que j’ai connus». – Alors les honnêtes gens ne doutèrent plus de l’aliénation mentale du traducteur de «Faust».
Le jour fatal approchait, la peur devenait de plus en plus grande. Je regardais avec servilité le docteur, et, ce personnage mystérieux, la sage-femme. Ni N…, ni moi, ni notre jeune femme de chambre, nous ne savions ce qu’il fallait faire. Heureusement, une vieille et bonne dame vint, de Moscou, chez nous, et prit d’une main ferme les rênes du gouvernement. – J’obéissais comme un nègre.
Une fois, au milieu de la nuit, j’entends une voix qui m’appelle, j’ouvre les yeux; la vieille dame, en jaquette de nuit, un foulard sur la tête, un bougeoir à la main, était là: m’ordonnant d’envoyer à l’instant chercher le docteur et la sace-femme. Je mourais de frayeur – comme si c’eût été une surprise, comme si nous n’avions pas parlé des mois entiers de ce moment! Avec quel bonheur je me serais tourné sur l’autre côté, après avoir pris une dose d’opium pour dormir pendant tout le temps du danger! – Mais il n’y avait rien à faire. – Je m’habillai tout tremblant; j’envoyai le domestique, et m’élançai dans la chambre à coucher de N… – Je lui prenais les mains; j’ennuyais la vieille dame par des questions insipides et je sortais dix fois par minute dans le vestibule pour écouter si on n’entendait pas le bruit d’un équipage. – C’était une nuit chaude d’été, tout était tranquille et calme; les oiseaux commençaient à chanter; l’aurore colorait les feuilles des arbres du jardin; j’aspirais l’air fortement et je retournais dans la chambre à coucher. – Enfin, on entendit une voiture roulant sur le Pont! – Grâce à Dieu! – Ils arrivaient encore à temps.
A onze heures du matin, je tresaillis comme frappé d’un coup électrique. Le cri fort d’un nouveau-né avait frappé mes oreilles. «C’est un garçon!» – criait la vieille dame, tout en larmes elle-même, et me l’apportant sur un coussin. Je voulais le prendre; mais mes mains tremblaient si fort que la vieille dame ne voulut pas me le donner.
Toute idée de danger avait disparu (quoique très souvent ce soit alors que le danger commence). Une joie folle s’empara de moi, comme si j’avais un carillon de toutes les cloches, un brouhaha de fête à l’intérieur. N… me souriait, souriait à l’enfant, pleurait, riait; et seulement la respiration spasmodique et une pâleur mortelle rappelaient les souffrances de tout à l’heure.
Je quittais l’appartement; j’entrai chez moi, et, complètement brisé, je me jetai sur mon canapé; sans pensée déterminée, sans me rendre compte de ce qui s’était passé, je restai là – dans une souffrance de bonheur.
J’ai vu encore, ailleurs, de jeunes traits exprimant à la fois cette souffrance et ce bonheur: de jeunes traits où la mort et une joie douce et suave planaient ensemble. C’était à Rome, dans la galerie du prince C… Je les ai
Jésus vient de naître, on le montre à la Madone. Brisée, fatiguée, languissante, sans une goutte de sang dans la figure, elle sourit à l’enfant et arrête sur lui un regard faible qui se fond en amour.
Il faut le dire, la vierge-mère ne va pas du tout dans la religion célibataire du christianisme. Avec elle, dans l’éternel enterrement du monde par l’église, dans le dernier jugement et autres horreurs de la théodicée sacrée, pénètrent la vie, la douceur, l’amour.
C’est pour cela que le protestantisme ne chassa que la Madone de ses hangars de piétisme, de ses fabriques de sermons. Elle confond l’ordre divin de la Trinité; elle ne peut pas se défaire de la nature terrestre; elle chauffe l’enceinte froide de l’église, et reste, quand-même, femme et mère. Par un enfantement naturel, elle se venge de la conception miraculeuse, et elle arrache au moine ascète une bénédiction – à son ventre.
Michel Ange et Rafael ont compris tout cela avec leurs pinceaux.
Dans le Dernier Jugement de la Chapelle Sixtine, dans cette Saint-Barthélémy au ciel, nous voyons le Fils allant fêter la vengeance divine. – Il a déjà levé une main; à l’instant il donnera le signal, et les tortures, les martyres, un auto-da-fé universel commenceront aux sons terribles de la trompette. Mais à côté de lui, une femme, sa mère, tremblante, dolorosa, se presse contre lui. – Peut-être en la regardant, il s’adoucira; il oubliera sa dure parole, «femme, qu’y a-t-il entre moi et toi?», et il ne donnera pas le signal.
La Madone Sixtine, de son côté, c’est Mignon de Gœthe après ses couches. On l’a effrayée par un sort sans exemple; elle a perdu la tête.
Was hat man dir, du, armes Kind, getan!
Sa tranquillité intérieure est détruite. On lui a fait accroire quе son fils – est un fils de Dieu. Elle le regarde dans un état d’exaltation nerveuse, magnétique, et semble dire: «Prenez-le, il n’est pas à moi». Et en même temps elle le presse… de manière qu’on voit très bien que, si c’était possible, elle s’enfuirait au fond des forêts, et, loin des hommes, caresserait, allaiterait, non pas le sauveur du monde, – mais son enfant, à elle. Et tout cela, parce qu’elle est restée femme et n’a rien de commun avec dieux femelles, les Isis, les Cérès, les Dianes.
C’est aussi pour cela qu’il lui était si facile de vaincre la froide Aphrodite, cette Ninon de Lenclos de l’Olympe, des enfants de laquelle personne ne se soucie. Marie la Vierge, avec son fils dans ses bras, baissant doucement sur lui ses regards, est entourée d’une toute autre auréole de sainteté que sa rivale соquette.
II me semble que Pie IX et le Conclave ont agi avee beaucoup de conséquence en proclamant l’immaculée conception de la Vierge. Marie, née comme vous et moi, prendra nécessairement notre parti; elle représentera la pacification vivante de l’espirt et de la chair. Mais si elle, non plus, n’est pas née d’une manière humaine, qu’a-t-elle de commun avec nous? – Elle n’aura pas de pitié pour nous. Gretchen ne pourra pas lui confier sa faute. – La chair est encore une fois maudite; l’église encore une fois plus nécessaire pour le salut.
C’est seulement dommage que le Pape ait retardé d’une dizaine de siècles. C’est le sort de Pie IX: Troppo tardi, santissimo Padre! siete sempre e sempre troppo tardi!